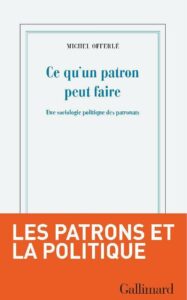
Le panorama proposé par cet ouvrage résulte de plusieurs centaines d’entretiens réalisés ces 10 dernières années auprès de patrons représentatifs de tous les profils de patrons et dirigeants. Chacun s’exprime sur son parcours, son management, son engagement et son rapport à la politique. De ce matériau, l’auteur tire des typologies claires de ce que le patron peut faire, peut laisser faire, ne veut et ne peut pas faire. Le sociologue qu’est l’auteur aspire à comprendre, au-delà des responsabilités opérationnelles et des objectifs quantitatifs des uns et des autres, comment ils contribuent à la production et à la reproduction de rapports sociaux et à la définition des frontières entre eux, l’État et les acteurs politiques. Ainsi, contrairement à d’autres travaux conduits sur ce sujet, cherchant surtout à instruire leur position dans l’élite économique et politique à partir de leurs caractéristiques sociales, de leur éducation ou de leurs réseaux, l’objectif est ici d’effectuer une prise d’informations plus concrètes et plus directement connectée à la chose politique.
Cette approche permet de dégager un « nuancier attentif » de ce qu’est « l’éthique patronale » et des critères qui la soutiennent. Ainsi se dessine une fresque où s’entrecroisent des jugements moraux sur la politique, une fierté d’incarner les valeurs de travail et de dévouement, une satisfaction de faire vivre ses employés ou une plénitude d’avoir accompli sa vie. Au sein de ces « états d’âme », l’engagement en politique suscite beaucoup de réticences, voire de déceptions pour ceux qui sont passés à l’action. Le motif le plus souvent évoqué tient à l’incompétence dont serait affligée la majorité des gestionnaires de la chose publique.
Ce cliché n’est pas partagé par l’ensemble des patrons et place dans l’ombre une fracture entre les grands et les petits. Ainsi lorsqu’ils s’expriment sur leur appartenance, ou au moins sur leur sympathie, politique. Le sens qu’ils donnent à leur engagement prend des formes diverses. Entre le militantisme assumé de quelques-uns et le don personnel ou le financement de bonnes causes facilité par une disposition fiscale de quelques autres, l’intensité de l’investissement – personnel ou institutionnel – consenti au service des autres peut atteindre des niveaux radicalement différents. Curieusement, la taille de l’entreprise joue un rôle majeur. En effet, le respect de principes « démocratiques » et la recherche de paix sociale apparaissent plus prégnants dans les organisations importantes, notamment parce qu’elles sont équipées de corps intermédiaires qui représentent mieux les diverses entités du corps social. A l’inverse, le patron d’entreprise moyenne ou petite parait plus directement confronté aux tensions, endogènes et exogènes, qui accompagnent la marche de « son » entreprise. Il se trouve fréquemment contraint de décider de manière solitaire, voire autoritaire, générant alors des frustrations et des conflits qu’il ne peut amortir, faute de dispositif ad hoc. Ce constat vaudrait explication du développement du vote Le Pen chez ces petits patrons.
A l’heure où certains anticipent un monde d’après où la guerre de tranchées entre patrons et employés, entre entreprises et Cité devrait s’apaiser, il est à craindre que les crises politique et militaire qui menacent la recherche de nouveaux équilibres économiques et sociaux issus de la pandémie, exacerbe la distance qui sépare encore les dirigeants d’une implication non-partisane dans la gestion des « communs ». Mais l’auteur ne cède pas au pessimisme et pense que ce contexte peut favoriser la formation de « coalitions réformatrices pour adapter les pratiques économiques à la question environnementale, au digital, pour relocaliser les activités essentielles. »
CE QU’UN PATRON PEUT FAIRE. UNE SOCIOLOGIE POLITIQUE DES PATRONATS – MICHEL OFFERLÉ, ED. GALLIMARD, NRF ESSAIS, 2021, 528 P., 22 €




