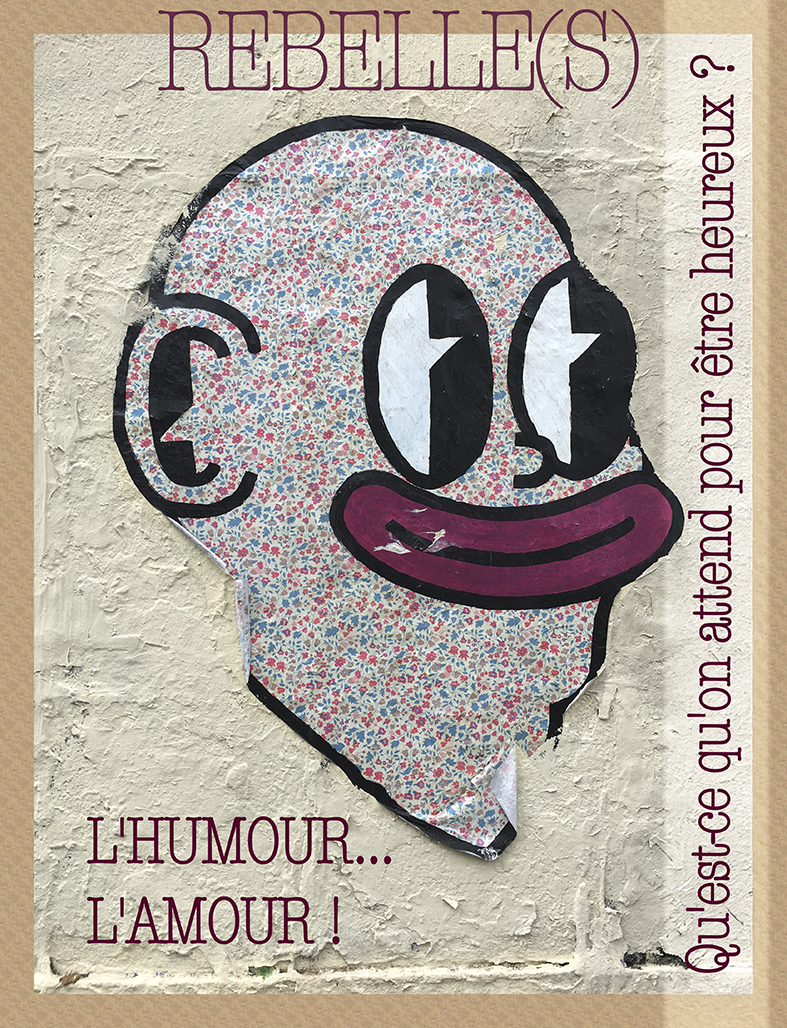François Mocaer est éditeur. Sa maison d’édition qu’il a nommée « Unicité » publie aussi bien romans que poésie, essais, histoire, théâtre et livres pour la jeunesse, rassemblés en une douzaine de collections. Une partie importante de son fond éditorial est également consacré à la spiritualité. Religions chrétienne et judaïque, islam, shintoïsme, bouddhisme zen ou taoïsme y sont présents. Fin connaisseur de l’hindouisme, François Mocaer fait paraître tant Mâ Anandamayî que Râmana Mahârshi.
L’inventaire de ses publications atteste un tropisme fort pour la poésie. Dans cet entretien qu’il nous aura accordé le 9 juillet, nous verrons la raison de cet intérêt sans affèterie. Il est un éditeur compulsif ; presque un imprimeur compulsif, son ancien métier. Son stock est situé chez lui, dans le grenier. Petite affaire, grand catalogue. En un peu plus de 15 ans, il aura publié près de 1 300 titres ! Certains dont il est légitimement fier, d’autres pour lesquels il ne cache pas que leur parution aura d’abord fait du bien à sa trésorerie. Enfin, ceux qui ne laisseront pas forcément des souvenirs impérissables mais aident les jeunes auteurs à mettre le pied à l’étrier. Il en est heureux.
Dans sa maison de Saint-Chéron où il vit avec sa femme Laurence, François accueille trois chiens et trois chats et dont un à trois pattes ; mais il n’a pas de voiture. Il part plusieurs fois par semaine en train pour Paris, chargé de sacs contenant des livres. Ils seront présentés lors des lectures-signatures de ses auteurs. Les sacs affichent 30 kilos au compteur en moyenne. Pas mauvais pour le cœur, lui a dit son cardiologue. Car François a un cœur en mauvais état, la faute aux excès de sa jeunesse. Rave-party, nuits déraisonnables dans les champs. Il ne s’est pas ménagé à l’époque avec l’ecstasy ; fidèle à son tempérament, il continue aujourd’hui avec les livres. Il va bientôt se faire réopérer. Il y a toujours un tuyau à rebrancher, un nerf à cautériser.
En ce début de juillet, les cafés ouverts à Saint-Chéron ne sont pas légion, d’autant plus que les cafés ne sont pas légion à Saint-Chéron. Chassé par la musique du café place de l’église, nous décidons de descendre à la gare où se trouve le café de la Gare.
Éric Desordre : Tu as à mes yeux une vie romanesque. Ta vie d’éditeur, ton enfance, ta famille. De quoi veux-tu nous parler ?
François Mocaer : J’ai eu une enfance heureuse, couvée par ma mère, dont la famille était très catholique, très pratiquante, très mystique ! Mon père était beaucoup plus distant, cela venait de la façon dont il avait été élevé. Tous deux étaient des Bretons du Finistère Nord. Mon grand-père maternel avait été contremaître dans une usine. Dans les années 1920 à Porspoder, ma grand-mère et lui ont ouvert un magasin pour sortir de leur condition ouvrière.
Du côté de mon père, à contrario, on ne comptait que des agnostiques ayant adhéré au Parti Radical. On y bouffait de la soutane à tous les petits-déjeuners. Mes arrière-grands-parents avaient tenu un cinéma à Landerneau. Y passant un film muet où l’on voyait un clochard qui volait la bague d’un évêque en l’embrassant, ils firent l’objet d’une campagne de boycott de la part des curés et furent traités de « pornographes ». Furieux, l’aïeul décida de ne plus aller à la messe et devint un pilier des radicaux-socialistes du coin. Cela s’est transmis jusqu’à mon père.
On a oublié cette époque mais entre l’école publique et l’école catholique, les gamins se jetaient des pierres. Deux mondes s’affrontaient, et la haine était d’autant plus virulente qu’en Bretagne, la religion avait un poids certain.
Éric Desordre : La violence à l’école ne date pas d’aujourd’hui…
François Mocaer : Mon père n’avait donc aucune idée de Dieu. A 33 ans, il dû se faire baptiser pour épouser ma mère à l’église, en 1960. Représentant en « chaussettes de qualité », papa était tombé amoureux. Ma mère m’a raconté avoir hésité entre deux hommes, prenant finalement « pas le plus beau mais le plus gentil ». Ma sœur est arrivée en 1961, et moi en 1963. Je suis né à Recouvrance, dans le vieux Brest.
Ma mère était aimante mais dépressive. Aussi allais-je souvent chez mes grands-parents, à Porspoder. J’ai été mis en pension deux ans après la maternelle, dans une école de frères religieux, ma mère connaissant bien le Frère Hervé. C’était très dur. La discipline y était effroyable. Nous étions violentés, deux ans de stress et de coups. J’en garde un traumatisme puissant… et j’ai d’ailleurs porté plainte il y a deux ans. Les humiliations étaient imposées par des gars pas très évolués qui avaient dû être élevés sur ce modèle. Un de mes copains s’est suicidé.
Éric Desordre : Quelle était la congrégation ?
François Mocaer : Les frères Lamennais, éducateurs et missionnaires. Pour te dire le niveau intellectuel de ces religieux : ils nous donnaient le droit de cracher sur les affiches de Georges Marchais, pendant la campagne présidentielle de 1974. On s’en donnait à cœur joie à la sortie de l’église. Baignés d’anticommunisme primaire, nous chantions « Giscard à la barre, Mitterrand c’est du vent ! »
Éric Desordre : C’est bien un chant de marin.
François Mocaer : Je ne croyais pas au Père Noël, mais que les Russes allaient être héliportés à Brest.
En 6ième, je suis entré au Petit Séminaire. Cela s’est joué à très peu de choses. Ne sachant pas bien ma leçon, je ne voulais pas être interrogé et prendre des coups. J’ai eu la présence d’esprit de répondre au Frère Albert que je voulais être prêtre. Je devais bien être un peu motivé, qui sait… ? Dans le doute, on se lance.
Voilà bien une pensée en action qui caractérise François. Ne s’est-il pas lancé ainsi dans toutes ses entreprises ? À mon envoi du manuscrit du Grand Catalogue des Livres imaginaires, refusé précédemment par un nombre d’éditeurs que la décence m’interdit de préciser, il avait répondu : « La préface explique bien ta démarche qui m’avait un peu dérouté. Un vrai saut dans l’inconnu et comme dirait Krishnamurti, il faut se libérer du connu. Bon allez je plonge. Parution pour mai juin ».
Plonger, enfin ! D’enthousiasme, je lui avais dans la foulée offert un chic maillot de bain.
La congrégation avait édité des bandes dessinées de propagande – c’est mon père qui me l’a fait remarquer – dans lesquelles les missionnaires en Afrique portaient une auréole bleue, devant tous les petits noirs qui priaient à genoux. Cette image m’a plu. Elle renvoyait à un imaginaire de puissance dont j’étais moi-même parfaitement dépourvu. La possibilité de domination offerte par cette vie me fascinait. Je me souviens aussi d’un grand tableau qui m’impressionnait, celui de Charles Martel qui avait arrêté les Arabes à Poitiers. Son cheval était aussi musclé que lui. Je pensais qu’il était tout seul avec sa massue à avoir écrasé ses ennemis. Quel homme ! A cet âge, dans un tel environnement, tu y crois…
Au Juvénat, en 6ième, c’était toujours violent mais beaucoup plus doux. (L’expression est bien celle de François, « plus doux » et non pas « moins violent »). Les religieux rencontrés étaient intelligents. Un des frères m’a conseillé en disant : « Quand tu devras décider de rentrer dans les ordres, on te demandera l’abstinence. Si tu ne t’en sens pas capable, il ne faudra pas y aller. » Le frère François était très efféminé, il fut le seul religieux vraiment doux avec nous, tout en étant respectueux. Pas de caresses. Ce ne fut pas le cas de certains autres… Responsable de la bibliothèque, il nous faisait lire les livres de la collection « Signes de piste », avec des illustrations de beaux scouts blonds aux traits fins, en culottes courtes. Cela devait être pour lui le summum de l’érotisme ! Il fut de ces gens qui m’ont construit, malgré tout. Finissant par prendre conscience que tout ça n’était pas fait pour moi, j’ai fini par quitter le Petit Séminaire, ce qui fut une grande déception pour ma mère.
Éric Desordre : Pourquoi tes parents t’avaient-ils envoyés dans cette école ?
François Mocaer : C’était une tradition familiale. L’école appartenait à la famille de Poulpiquet et ma tante était mariée à un « de Poulpiquet ». Vieille noblesse bretonne, traditionaliste, vieux manoir breton… Ils avaient donné des terres pour construire une école, à condition qu’elle soit catholique. Je continue à les voir, je les aime beaucoup. Petit détail, ma mère a reçu l’extrême onction avec un curé traditionaliste, ce qui n’aurait pas été de son goût si elle s’en était aperçu. Mais je n’étais pas là…
Quittant le Petit Séminaire, je suis allé à Brest, au lycée Charles de Foucauld. On ne quitte pas l’enseignement catholique comme ça ! Afin de protéger ma mère, j’avais demandé à être mis en pension.
Éric Desordre : Tu dis : « je suis ma mère ». Qu’entends-tu par-là ?
François Mocaer : Nous avons les mêmes qualités et les mêmes défauts. Impatients et mystiques. Toujours dans la nervosité.
Éric Desordre : Quelle relation ton père avait-il avec toi ?
François Mocaer : D’amour. Pas le style à faire des câlins mais il me disait toujours : « fais ce que tu aimes ». Après qu’il ait disparu, je l’ai vu en rêve me sourire lors d’une signature. Il aimait la poésie, en écrivait d’ailleurs une très naïve. Je lui ai dit un jour, « Papa, quand tu mourras, je serai très triste mais pour la poésie, ce sera un grand jour ». Il en riait sincèrement. Il avait publié deux recueils de poésie et écrivait dans la revue An Amzer qui est très connue en Bretagne. Quand il a eu son premier AVC, il était en train de réciter ses poèmes debout sur une chaise.
Avare de conseils, il m’en avait toutefois donné un : « Je préfère que tu ailles aux putes plutôt que tu mettes une fille enceinte », ce qui à l’époque m’avait choqué. Mais il faut savoir qu’un enfant sur deux en Bretagne était un enfant naturel ; et les mères les élevaient seules, quand elles les élevaient. Dans ma famille catholique, il y eu de tels cas.
Éric Desordre : Il était réaliste et soucieux du bien d’autrui.
François Mocaer : À seize ans, une peine de cœur terrible. La fille me quitte. J’étais désespéré. Je me rends rue de Siam, rentre dans la librairie Dialogue. Ne voulant pas lire de roman, je vais au rayon poésie et tire un livre au hasard. C’était Les champs magnétiques de Soupault et Breton. Choc esthétique. Je ne comprends rien mais c’est beau. Cela a changé ma vie, tout de suite.
Éric Desordre : Un chemin que tu n’aurais pas pris si tu n’avais eu cette révélation.
François Mocaer : Je me suis mis à acheter et lire de la poésie.
Éric Desordre : Tu ne savais alors pas que tu aurais une vie « littéraire », que tu serais éditeur.
François Mocaer : Je ne savais pas. Je marchais sur les mains.
L’écriture m’est venue. Est venu « Le vers de la feuille réincarnait le silence ». Un recueil édité aux éditions Saint-Germain-des-Prés, avec une préface de Per-Jakez Hélias. Je devins une petite vedette à Brest ! Mon adolescence fut plutôt perturbée… Et tant bien que mal, Première, Terminale. À 17 ans, renversé par une voiture… une greffe osseuse – tibia, péroné. Puis le Bac, ric-rac.
Ensuite, fac de Lettres. Alors que je vivais chez mes parents, j’étouffais dans le milieu familial. Je ne me voyais pas faire des études longues dans ces conditions, j’ai donc quitté la fac… et les Lettres. Une formation de chef de rayon en grande surface était proposée par la chambre de commerce ; un truc qui ne me correspondait en rien ! Puis CAP de comptabilité en huit mois, nécessaire pour être chef de rayon aussi curieux que cela puisse paraître. Casino embauchait à tire-larigot et je suis parti en formation trois semaines, à Saint-Etienne. À la suite, on était mutés où on voulait. Marseille ou Lille ? Marseille.
Éric Desordre : Connaissais-tu Marseille ?
François Mocaer : Pas du tout ! L’aventure. J’habitais dans le quartier du Panier, où les putes à 50 balles faisaient affaire sur les capots des voitures… Faut connaître l’époque…
Je me fais virer au bout de trois mois. Ce boulot ne me plaisait pas. J’ai confondu les courgettes et les concombres et ça s’est su. Pour un « adjoint chef de rayon fruits et légumes », quand-même… Il fallait bosser onze heures par jour. La grande distribution était un des derniers bastions de l’exploitation humaine ; aussi ai-je été très heureux quand on m’a annoncé que j’étais licencié. Comme, avant de partir pour Marseille, les copains m’avaient fait un shampoing à la bière, il a fallu que je leur explique pourquoi je revenais à Brest…
Retour à la case départ. Il se trouvait que le mari de ma sœur étais correcteur. Un stage de correcteur s’est présenté dans un organisme de formation parisien, géré par la CGT. Le Syndicat du Livre avait la mainmise sur toute la presse. Le stage se déroulait 69 rue Pigalle, ça ne s’invente pas ! Logé dans un hôtel au mois au 6ème étage, j’ai connu la solitude, dans une ville où je ne connaissais personne. Je me suis mis à fréquenter les bars ; et deux mondes. Celui de Pigalle et celui de Montmartre. Pigalle, c’était le sexe et le tourisme ; Montmartre la poésie et les artistes. Rue Germain Pilon, on récitait de la poésie. Je croisais des gens comme Jean-Roger Caussimon ou des figures des deux mondes qu’étaient deux transsexuels adorables, qui sont morts du SIDA. J’étais un sacré loustic !
Éric Desordre : Pourquoi dis-tu « loustic » ?
François Mocaer : Je fréquentais les endroits glauques…
Éric Desordre : Étant costaud, tu n’avais pas peur qu’on te « cherche ».
François Mocaer : À vingt ans, tu n’as peur de rien. Dans les manifs anti-nucléaires de Brest, j’étais au premier rang devant les CRS, au milieu des lacrymos. Ils pouvaient toujours essayer de m’attraper ; je courais le 100 mètres en 11,5 seconde ! Mes faits d’armes. J’ai essuyé deux charges de CRS ; c’est costaud. Il ne faut pas rester immobile…
François dit de lui-même qu’il est un « cheval fou ». C’est cet animal qui lui apparaît en premier quand il se demande à quoi il peut bien ressembler aux yeux des autres. Il faut dire que ça lui va plutôt bien.
Éric Desordre : Tu ne crains pas la confrontation physique.
François Mocaer : À Brest, personne ne la craint. Le Breton aime ça. Le plaisir de courir, de balancer des caillasses… Ceci dit, le style « casques et gourdins » sur les sites d’affrontement organisé, ce n’était pas trop pour moi. Je ne suis pas belliqueux, pas révolutionnaire.
Éric Desordre : As-tu fréquenté les milieux anarchistes à la fac de Brest ?
François Mocaer : Non, mais les milieux bretons bretonnants.
Éric Desordre : Le Front de Libération de la Bretagne ?
François Mocaer : Le FLB, ce sont les gentils ! Les groupes que je croisais étaient soit investis par l’extrême droite, soit par l’extrême gauche. Il s’est trouvé que ceux que je connaissais le mieux étaient ceux de l’extrême droite. J’ai même écrit des conneries du genre « Mitterrand, tu paieras pour tous tes crimes ». On l’avait condamné à mort par contumace, c’est dire…
Éric Desordre : Tes « trucs de jeunes » !
François Mocaer : J’ai fini par comprendre que je me fourvoyais. Il est cependant intéressant de constater que je publie aujourd’hui aussi bien des auteurs se revendiquant de l’extrême droite que d’autres de l’extrême gauche.
Éric Desordre : Il t’arrive de différencier mais tu ne discrimine pas.
François Mocaer : Je n’y arrive pas. Ce n’est pas une démarche intellectuelle mais naturelle. En tout cas, à l’époque du métier de la correction, je n’avais aucun sens politique.
Je n’ai jamais aimé ce boulot. Il fallait être patient, j’étais donc un mauvais correcteur. L’expérience fut cependant intéressante, à La Vie financière, dans le groupe de presse de Jean-Louis Servan-Schreiber où je croisais un grand nombre de journalistes qui ont fait de belles carrières. Par contre, je garde un très mauvais souvenir de la Presse de manière générale : Le Figaro, l’Agefi, France Soir, Le Canard enchaîné, La Tribune…
Éric Desordre : Pourquoi un tel mauvais souvenir ?
François Mocaer : J’étais très jeune, à 23-24 ans. Le systématisme d’extrême-gauche me dérangeait. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait « pourrir la vie des patrons », alors que nous gagnions très bien notre vie. Je ne l’ai d’ailleurs jamais aussi bien gagnée qu’à cet âge. 4000 euros en équivalent actuel pour six heures de travail par jour. Un milieu ouvrier plutôt bien loti.
J’y ai fait la connaissance d’une correctrice lors d’une fête de typographes, avec laquelle je me suis marié. Très mauvaise expérience. On a acheté une maison ; au bout de cinq ans, il m’a fallu quitter Sophie en prenant toutes les dettes pour moi. Je suis parti à la rue, SDF.
Un foyer m’a recueilli du côté de Bastille. Paradoxalement, ce furent deux années très chouettes. Dès mon arrivée, je me suis lié avec une prostituée black qui avait le SIDA. Nous avons fait une fugue tous les deux en plein mois d’août à Paris. Comme elle avait touché son reliquat de RMI, elle m’a payé le cinéma ; on a vu King Kong ! Quatre jours sur les quais, dormant à la belle étoile. On marchait la main dans la main, j’étais un peu amoureux d’elle. Sa peau était couverte des sarcomes de Kaposi. Nous ne sommes pas allés plus loin. Quand elle est partie du foyer, elle a rencontré un type qui était séropositif.
Au foyer, j’ai trouvé une place de commercial dans les Pages Jaunes.
Éric Desordre : Tu te débrouillais bien pour trouver du boulot.
François Mocaer : Je vendais des espaces publicitaires par téléphone. Ça me sauve.
Éric Desordre : Tu te sauves.
François Mocaer : Oui, puisque que je vais le chercher moi-même. Pendant neuf mois, vente « hard » ; classement par vendeur, la compète permanente. Le meilleur gagnait une 205 GTI. Cela ne me déplaisait pas. Entre temps, le foyer m’avait accordé une place de long terme, 6 rue de la Comète à côté de la rue Saint-Dominique. Les résidents étaient des « sortis de prison » et des réfugiés politiques. À l’époque, le GIA sévissait en Algérie et la France accueillait des Algériens dont la vie était en danger. Un ancien policier m’a montré ses blessures sous ses pansements ; il avait été poignardé, sa tête était mise à prix. Un de mes voisins était irakien, réfugié de la première guerre d’Irak. Fils de bourgeois, il m’a montré des photos où on le voyait jouer au water-polo ! Il avait un sale cancer, soigné par chimio. Deux ans après, j’ai appris qu’il s’en était tiré. Un autre copain, Michel Royer, était toxicomane. Lui n’a pas survécu. Je lui ai dédié mon premier roman, Corps oublié. Le manuscrit avait d’ailleurs intéressé Flammarion, mais bazardé au deuxième tour ça s’est arrêté là. Michel a compté pour moi, on s’était soutenu dans ce climat de violence. Deux ou trois fois, j’ai eu peur, sentant que ça pouvait très vite dégénérer, que les types en face de moi pouvaient déraper – moi pas.
Éric Desordre : C’est parce que tu sais te maîtriser que tu ne sortais pas de prison.
François Mocaer : Il y a eu deux morts au foyer pendant cette période. Un ex-taulard qui avait fait quinze ans de prison pour braquage s’était fait refaire les dents avec la CMU. Il en était tout content. Il s’est pendu deux jours après. Je n’ai jamais su pourquoi. L’angoisse de la liberté ? Un autre a fait une overdose ; la drogue tournait pas mal là-dedans.
Mon copain Michel étant toxico, nos rapports ont fini par s’abimer. Il ne me rendait pas l’argent que je lui prêtait, me mentait. Le drogué se comporte ainsi… Séropositif, une hépatite C, fumeur invétéré, alcoolique ; la totale. Il était d’un clan plus ou moins gitan dont je n’ai jamais compris le fonctionnement. Michel avait une fille de deux ans. Très fier, il me disait : « ma fille sera voleuse ! » J’ai fait la connaissance de celle-ci seize ans après ; elle avait voulu me rencontrer après la disparition de son père. On s’est vus avec sa tante qui était médecin et avec laquelle j’avais correspondu. Gros coup sur la cafetière, j’apprends qu’elle se drogue comme son père. Quinze, vingt joints par jour et un peu de coke. Je lui dis qu’elle va finir par passer aux « trucs sérieux ». Elle marchait sur ses traces. Elle s’en fichait.
Les mielleux qui vendaient l’héroïne, je les connaissais, eux-mêmes accros et faibles, sans énergie. A chaque type de drogue, un comportement. Un rebeu du foyer qui carburait au crack m’avait menacé : « je vais te couper la gorge ». Deux ans après, je le croise dans la rue et il me tombe dans les bras « tu as toujours été mon ami, tu es un bon gars ». On a discuté une demi-heure, il ne m’a même pas demandé d’argent. Ces gars-là sont comme ça, imprévisibles. Une fois, je suis allé avec Michel livrer de la cocaïne gare Saint-Lazare. Je n’y ai jamais touché mais je voulais le protéger. Qu’est-ce que j’étais con, on aurait pu se faire serrer…
Éric Desordre : Tu es du genre à plonger !
François Mocaer : Je plonge bien, je réfléchis après.
Dans un des poèmes de François, n’y a-t-il pas :
« L’angoisse est une reine
qui nous jette
hors les murs de notre nuit »
Toujours au foyer, toujours avec mon job de télémarketing, je travaillais à Norwich Union. Après y avoir rencontré Myriam avec laquelle je m’entendais bien, il s’est avéré que je pouvais passer superviseur, étant très bon en techniques de vente… Elle était également sollicitée pour le même poste. Il n’y avait qu’une place et management à l’anglo-saxonne oblige, il fallait nous départager. J’ai dit à Myriam qu’elle pouvait la prendre. En fait, je ne me satisfaisais pas de cette situation, je voulais vivre autre chose que de la vente par téléphone. Un samedi matin, on a regardé ensemble les petites annonces sur Minitel pour des places de correcteurs. Postulant chez l’imprimeur Desbouis Grésil, j’ai réussi. J’y suis resté 25 ans.
Rentré tout d’abord à mi-temps, je travaillais le reste de la journée comme superviseur chez Tempo, une petite boîte de télémarketing. J’y étais le roi du rendez-vous. J’avais la gniaque, disposais d’une bonne technique, savais répondre aux objections. C’est là que nous nous sommes rencontrés Laurence et moi. En 1998, enfin à plein-temps chez Desbouis Grésil, j’ai écrit mon premier roman. Le patron l’a su et m’a proposé une place de rédacteur dans le journal Saint-Maur Magazine, tiré à 35 000 exemplaires. Bonne expérience d’écriture : reportage sur un charcutier le main, l’après-midi avec une danseuse étoile de l’Opéra de Paris, interview de Robert Hossein en plein délire mystique. Il jouait Les mains sales le matin, une pièce de Shakespeare le soir. Un recueil de poésie est venu chez l’Harmattan, et lors d’une lecture j’ai rencontré Nadine Grandeau qui n’avait pas d’éditeur. Je lui ai dit que je créerai une maison d’édition pour pouvoir la publier. Quand je me suis lancé, n’ayant pas d’auteurs, il m’apparut logique de solliciter ceux sur lesquels j’avais fait des articles pour le journal. A l’instar de Nadine Grandeau, Régis Moulu et Éric Dubois sont venus.
Éric Desordre : Ton amie n’a pas d’éditeur, tu te fais éditeur !
François Mocaer : C’était l’occasion, mais j’y avais pensé auparavant. En 2009, tout est parti de là.
Éric Desordre : Qu’est-ce qui explique autant de titres ? Quels sont les livres marquants que tu as publiés ?
François Mocaer : J’ai vite compris que si je voulais en vivre, il me fallait en publier beaucoup. Et si j’en ai publié autant, c’est que je n’avais pas de ligne éditoriale. Chez Unicité, je sais qu’il y a des livres très bons, d’autres moyens et puis des « questionnables ». Je publie aussi des autistes et enfin des auteurs auxquels je veux faire plaisir, comprenant très vite ceux pour lesquels écrire est une manière d’être au monde et d’exister. Je pense à des gars au RSA. La pauvreté leur enlève un statut social, la vie les a brisés. Il ne crèvent pas de ne pas écrire, il crèvent de ne pas exister. Cette existence à travers les livres parus, je la leur offre. Certains ne sont vraiment pas bons, mais je l’ai fait consciemment et j’assume les critiques qu’on peut m’en faire. En vérité, ce n’est même pas conscient, ça fait partie de moi. Mon éducation catholique, peut-être ? On est tous conditionnés. Des braqueurs rencontrés en foyer : « Mon fils, tu seras un homme quand tu auras braqué une banque ». Alors, on peut aussi imaginer : « Mon fils, tu seras un homme quand tu auras publié un livre » !
Éric Desordre : As-tu publié des braqueurs ?
François Mocaer : Non, mais chez Norwich Union, en «appel entrant » (réception d’appels), on formait des personnes sorties de prison. Entre autres, je me suis occupé de sept ou huit braqueurs. De fait, des gens absolument adorables. Dans ce milieu, les parents transmettent les codes. C’est de famille. Le père te dit « comment se comporter dans la banque, comment se tenir, comment parler au caissier, la manière d’être violent ou pas, etc. »
Éric Desordre : Un autre exemple de conditionnement. Une transmission chaotique.
François Mocaer : Un de ces gars m’a dit « j’ai pris huit ans parce qu’avant d’aller braquer, j’avais le choix de charger mon arme ou pas, et que je n’ai mis qu’une balle. Mais une ou neuf, c’est pareil devant un juge… »
Éric Desordre : Qu’est-ce qui a compté pour toi dans la vie de ta maison ?
François Mocaer : Des prix littéraires, de beaux salons, les amitiés. J’ai rencontré Jean-Philippe Testefort au marché de la poésie, Anne de Commines était une amie qui connaissait San Juan et Ballesteros. Après qu’un de ses livres ait été publié par Unicité, nous sommes convenus qu’il serait opportun qu’elle dirige une collection. Laurence Bouvet, je l’ai connue avec Éric Dubois, Francis Coffinet est venu avec Laurence. Puis d’autres directeurs de collection sont arrivés avec lesquels les liens se sont tissés.
Éric Desordre : Ce sont des auteurs qui construisent une œuvre.
François Mocaer : D’autres auteurs de valeur m’ont proposé leurs textes. Récemment : Où vont les trains le dimanche de Dos Santos, Émarger nuit d’Affergan. Je fais beaucoup de livres avec l’Afrique, avec la Roumanie. Je ne communique d’ailleurs pas suffisamment sur ces pans importants de mon fond éditorial et leur actualité. La spiritualité est un sujet que je connais bien. Découvrant il y a bien longtemps Ramesh Balsekar dans une librairie, j’ai aimé cette notion d’absolu indifférencié. Dieu existe, tout est déjà là. Dans le christianisme, à part chez quelques mystiques, Il faut passer par la nuit sombre, la tentation, le diable, le bien et le mal… Du point de vue pratique, voici un exemple de différence entre hindouisme et christianisme : il existe une étape possible dans la vie d’un Hindou, qui peut faire vœu d’abstinence à 40 ans ; alors que quand les prêtres le font, ils sont encore quasiment des enfants ! Les prêtres avec lesquels j’en ai discuté m’ont rétorqué qu’il étaient liés au Christ jusqu’à ce sacrifice, qu’ils en étaient heureux. Attends, coco, tu as vu les 300 000 plaintes pour abus sexuels sur mineurs ? Quel piège !…
Je me suis intéressé à l’hindouisme car il répond à certaines de mes questions, sans toutefois tout résoudre. J’ai aussi pratiqué le bouddhisme zazen, Daïtishi Mari de l’école Zen Sôtô. Mur blanc, position du lotus. Tu lâches prise, ne retiens aucune idée. Stop. C’est tout.
L’idée de Dieu est là, en moi. J’en suis imprégné. Est-ce un conditionnement ?
Éric Desordre : Ce n’est pas seulement une imprégnation mais un besoin de spiritualité que chacun peut reconnaître.
François Mocaer : C’est organique. C’est l’ouverture du cœur. Pas le dogme.
Éric Desordre : Ta vie est une succession de recherches spirituelles, qui peuvent d’ailleurs se résumer en une seule.
François Mocaer : Depuis tout petit.
Éric Desordre : Tu es ta mère.
François Mocaer : Oui, ma mère mélangeait un peu tout. Elle était une pieuse catholique… et faisait tourner un pendule au-dessus des photos de ses proches. Des fois, elle m’appelait : « François… » Le pendule ne tournait pas bien autour de ma photo. Quelque chose clochait. Elle ne se trompait pas. Appelant son frère : « Michel, ta fille ne va pas bien. » Elle faisait de même avec les autres membres de la famille.
Éric Desordre : Tes parents et grands-parents sont évoqués, et tes enfants ?
François Mocaer : J’ai un fils qui a 38 ans, Béranger. Il a vu Dieu à six ans.
Éric Desordre : Ah bon, à six ans !?
François Mocaer : Il a vu une raquette de badminton.
Éric Desordre : C’est en effet une révélation !
François Mocaer : Depuis trente-et-un ans, il est toujours avec sa raquette. Il a été au niveau « élite » junior. Il a été premier joueur mondial en speedminton, un mélange entre le squash et le « bad ». De 10 à 15 ans, je l’ai accompagné en compétition. Quand le sportif de haut niveau atteint 15 ans, on ne peut plus passer beaucoup de temps avec lui. L’entraîneur devient le père. L’enfant ne veut pas faire de performance pour lui-même, mais pour faire plaisir à l’entraîneur. Je l’ai compris assez vite. Tout comme le voyant avachi dans le canapé faisant semblant de lire ses livres de cours, il m’est apparu que l’informatique l’intéressait moins que le badminton. Aujourd’hui, il entraîne les cadets dans les compétitions internationales. Il est également coach sportif, basé à Genève. Ses clients « nécessiteux » sont qataris, saoudiens…
Éric Desordre : Je comprends ; un autre monde!
François Mocaer : Plutôt ! Ma maison ne se portant pas très bien, il a fallu récemment que je trouve un boulot en plus. La compagne d’une autrice travaillait dans la sécurité ; elle m’a fait remarquer que les horaires de vacation y étaient compatibles avec une autre activité. Ma première réaction a été négative. Je ne pouvais pas exercer un tel métier ! J’ai quand même appelé. Les Jeux Olympiques étant en ligne de mire, il y avait un appel d’air pour de nouveaux salariés. Le stage de formation de trois semaines m’a plu ; on y apprend beaucoup de choses. Quels que soient ton ancien métier, ta formation, ton passé, ce qui compte dans la sécurité est uniquement le numéro de la préfecture qu’on te délivre après le stage. Casier judiciaire vierge. Pas de CV, juste un numéro.
J’ai découvert un monde très particulier, dont personne ne veut. En uniforme d’agent, mon angoisse a d’abord été de rencontrer des gens que je connaissais. J’avais une casquette et pensais pouvoir la pencher de façon qu’on ne me reconnaisse pas !
Finalement, ça ne m’a pas déplu, on y fait des rencontres très intéressantes. 98% des employés sont d’origine maghrébine ou africaine, 2% sont des Dupont. Le droit du travail est bafoué dans les rapports entre personnes mais après les invectives, on ne se formalise pas et les gens se remettent à travailler en bonne entente. Vivent ainsi des jeunes qui ne trouvaient pas de boulot ailleurs, beaucoup de vieux agents d’origine africaine, usés et plein de sagesse, des jeunes femmes en BTS de sécurité, en alternance. Oui, il existe un BTS pour ce métier ! Sécuriser dix hangars avec quarante portes, des sorties de secours, un PC, ce n’est pas trivial, quatre corps de métier sont nécessaires. Et à propos de rencontres, malgré ma casquette, j’ai bien fini par être reconnu par un ancien collègue de l’imprimerie. Il a éclaté de rire !
Éric Desordre : Encore une expérience humaine inconnue de beaucoup.
François Mocaer : Oui, et c’est un monde de solidarité. Alors que j’étais agressé par un déséquilibré mental, deux collègues algériens sont venus me porter assistance. Recevoir de l’aide immédiate et efficace m’est arrivé plusieurs fois. Le public est très gentil, toutefois sur une population de 40 000 visiteurs, tu as forcément des personnes difficiles à gérer, qui s’énervent dans les queues. On tombe de toutes façons sur des personnes agressives à un moment ou à un autre. Je cache mon uniforme dans le métro quand je « pars en sécurité », on ne sait jamais. Voir « SECURITÉ FORCE 8 » sur la veste, ça peut tenter les âmes simples et tu peux avoir des ennuis. Si tu as des bras comme ça, des tatouages partout, tu ne risques rien. Cependant, ce n’est notoirement pas mon look…
Éric Desordre : Comment arrives-tu à conjuguer ton travail de sécurité et ton métier d’éditeur ?
François Mocaer : Je publie moins. J’arrive à participer aux grands événements, ponctuels. Par contre, je ne ferai pas la sécurité dans les magasins. Tu m’imagines à l‘entrée de la FNAC ? « La poésie, c’est par là ! »
Éric Desordre : Dis-tu que tu es poète et éditeur à tes collègues ?
François Mocaer : Oui, mais je ne sais pas s’ils me croient vraiment ! Une chose notable dans ce métier, c’est que ceux avec lesquels on travaille font attention aux plus de 60 ans. Une fois lors d’un salon très dur, j’ai fait le pied de grue plus de trois heures, je ne pouvais plus parler, les mâchoires bloquées par le froid glacial. On m’a fait remplacer et mis au chaud, sans que je le demande. On me propose de m’assoir souvent, ce qui est une marque de respect certain parce qu’un client n’apprécie pas de voir un agent assis. Il faut dire qu’il y a eu des problèmes de santé dans ce boulot. Un africain de trente ans est tombé en syncope dans le froid ; Il est tombé raide comme un piquet, heureusement sur une rambarde. Vingt personnes se sont précipitées. Vingt secouristes formés.
Éric Desordre : Et comment vois-tu l’avenir à moyen terme de ta maison d’édition ?
François Mocaer : Quand je toucherai ma retraite en janvier prochain, mes directeurs de collections continueront l’activité. Je ferai moins de livres et ne m’occuperai plus des auteurs en direct. La charge de travail est encore considérable jusqu’à décembre. Mon autre travail me repose ; même si je peux être obligé de me lever à 3 heures du matin, c’est une parenthèse calme. Je suis rincé mais il n’y a pas de stress, l’ambiance est bonne. Cela me convient.
Éric Desordre : Ta vie est « américaine », rappelle celles des « clochards célestes » avec de nombreux métiers et ce fil conducteur de l’écriture, la tienne et celle des autres.
François Mocaer : Oui ! Séminariste, étudiant en Lettres, en comptabilité, en bouddhisme zen ; chef de rayon fruits et légumes, correcteur d’imprimerie, télévendeur d’assurances, rédacteur de presse locale, éditeur de poésie, agent de sécurité. La fébrilité de ma mère…
« comme dirait Krishnamurti, il faut se libérer du connu. »
L’entretien se termine. Nos verres sont vides et le soleil tape. Avant de rentrer, nous recommandons des bières. François n’a pas parlé de sa propre poésie et dans le tourbillon de son parcours, je n’ai pas eu le réflexe d’aborder ce pan discret de sa vie, pourtant prégnant. Son livre au titre énigmatique Le don du silence est le diamant du vide et dont la dédicace est offerte « à tous les « êtres » est bien celui d’un mystique qui cherche, qui se cherche. Questions.
« Alors que c’est soi-même
qu’il faut comprendre
avant que tout ne s’achève. »
Nous remontons à pied la pente vers le centre du village, vers l’église. Mon ami s’arrête tous les dix mètres, à la peine. Son front est perlé et il doit reprendre son souffle. Il fait très chaud malgré la fin d’après-midi. Saint-Chéron est cité par Péguy dans sa Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, longue pérégrination à travers ces terres à blé, traversées de vallées remplies d’arbres et d’oiseaux.
« Le pays des beaux blés et des encadrements,
Le pays de la grappe et des ruissellements…
Et coupés plus souvent par de creuses vallées
Pour l’Yvette et la Bièvre et leurs accroissements,
Et leurs savants détours et leurs dégagements,
Et par les beaux châteaux et les longues allées. »
Pour terminer cette oraison, mêlant le souvenir des évangiles à ses éblouissements d’enfant, François pourra à nouveau se tourner vers Thérèse de Lisieux, la sainte que sa grand-mère lui désignait sur le mur. Sa photo encadrée était accrochée en face du lit, où il se tenait blotti contre l’aïeule dans une douceur confiante. On est mystique toute sa vie. Cet itinéraire est familier à François, les dernières strophes du poème-pèlerinage de Péguy le lui rappelleront, dans un sourire :
« Quand nous retournerons en cette froide terre,
Ainsi qu’il fut prescrit pour le premier Adam,
Reine de Saint-Chéron, Saint-Arnould et Dourdan,
Veuillez vous rappeler ce chemin solitaire
…
Nous ne demandons rien, refuge du pécheur,
Que la dernière place en votre Purgatoire,
Pour pleurer longuement notre tragique histoire,
Et contempler de loin votre jeune splendeur. »