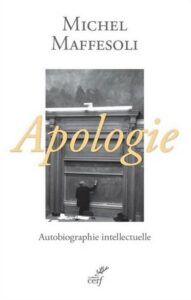
En ces temps où la doxa règne en maître, où les médias dominants nous assènent leurs vérités préfabriquées et où l’intellectuel patenté se complaît dans le conformisme logique, il est rafraîchissant de plonger dans l’œuvre d’un penseur qui ose le décalage. Michel Maffesoli, sociologue iconoclaste qui a été titulaire de la chaire Durkheim à la Sorbonne, a publié cette année Apologie – Autobiographie intellectuelle aux éditions du Cerf, un ouvrage dense et roboratif qui trace les contours d’une pensée enracinée dans l’imaginaire collectif, loin des sentiers battus du « progressisme obligatoire », selon ses propres mots.
C’est dans son bureau parisien, entouré de livres qui débordent des étagères comme autant de ferments d’effervescence, que j’ai eu le privilège de m’entretenir avec lui le 6 mai dernier. Pas de politiquement correct ici: Maffesoli parle avec la franchise désarmante d’un Dionysos contemporain, balançant entre Apollon et les forces chtoniennes. Notre conversation a exploré les écrits de ses maîtres à penser, sa critique de la modernité et ce retour au spirituel qui d’après lui anime les jeunes générations. Chez Rebelle(s), nous aimons ces voix qui se méfient de l’odeur de la meute – pour paraphraser Hannah Arendt. Voici cet échange, brut et enrichissant, qui confirme pourquoi Maffesoli déclenche tant de remue-ménage déstabilisant comme autant de bouillonnement intellectuel.
Éric Desordre : Michel Maffesoli, votre récent livre Apologie est sous-titré « Autobiographie intellectuelle ». Si vous y parlez de votre propre vie et de cette construction de la pensée dont vous avez fait une œuvre, l’on ne peut que constater qu’en matière d’inspiration intellectuelle, vous vous êtes rendu en tous lieux et en tout temps. Bien que vous vous sentiez une proximité avec de nombreux auteurs, vous vous intéressez également à ceux qui sont à contrario des opposants à vos idées et même à des personnes dont la vie et les écrits vous donnent de l’urticaire.
En vous lisant et en préparant cet entretien, ne sachant pas trop par où commencer dans ce maëlstrom de figures souvent majeures de l’histoire de la pensée, je n’ai pas voulu suivre strictement le cheminement des chapitres. Séduit par ce panthéon intellectuel malgré mon éloignement conscient ou ma propre ignorance de leurs parcours, je me suis donc inspiré des inspirateurs. Aussi ai-je commencé votre livre par la fin, par l’index. Il me semblait révélateur de la richesse du livre que nous évoquions les noms de ceux que vous citez le plus souvent. Ceux dont on peut supposer qu’ils sont pour vous des maîtres à penser, des esprits incandescents, des êtres chers. Le nombre de références est considérable, il y en a des centaines. J’ai donc distingué ceux qui se signalent par un nombre d’occurrences très supérieur à ceux des autres. Un des premiers est Dionysos. Il est cité 22 fois.
Michel Maffesoli : Tiens ! Cela est amusant. Oui, Dionysos, c’est mon petit dieu chéri – Me désignant la photographie d’un tableau – Vous voyez, le Caravage est là. Avec la treille autour de la tête. Oui, c’est bien moi, là.
Tout ce que j’ai écrit depuis 40 ans, c’est ce que j’ai appris des autres. La grande idée nietzschéenne qui a guidé tout mon travail, c’est ce balancement entre une figure emblématique qui a dominé une époque et une autre figure qui la remplace pour une autre époque. C’est Nietzsche qui dit Apollon et Dionysos. La modernité – qui est aussi un de mes dadas théoriques – a depuis le 17ᵉ siècle mis l’accent sur Apollon ou encore Prométhée. Et c’est cette direction qui va marquer toute cette modernité : Descartes, le 18ᵉ siècle, la philosophie des Lumières, les grands systèmes sociaux du 19ᵉ… et le marxisme. C’est l’ordre de la raison et la valeur travail.
Je l’ai rappelé à un président qui m’avait une fois invité à déjeuner – Sarkozy pour ne pas le nommer -, en lui disant qu’il était marxiste sans le savoir puisque c’est lui qui avait remis en valeur l’expression « valeur travail ». Maintenant tout le monde emploie cette expression, et elle est de Marx ! Donc en quelque sorte, Prométhée est invoqué. Je montre que dans le balancement des histoires humaines, cela a plutôt bien marché.
Mais les temps changent. De mon point de vue, il y a une autre figure qui est en train de naître. Celle de Dionysos, figure emblématique. J’emprunte cette expression à Durkheim, puisque j’ai occupé la chaire Durkheim pendant 35 ans. Durkheim nous dit que c’est à partir d’une figure emblématique que va se structurer une société. Et dans le fond, la figure emblématique qui s’efface désormais, celle de Prométhée, regroupe les convictions que sont le rationalisme, la valeur travail et le progrès assuré pour demain. On se réfère-là à une notion de progrès permanent. Or, je prétends que le progressisme est le grand mythe. C’est cette idée qui était déjà dans ma thèse d’État soutenue en 1978, où je faisais une critique du mythe du progrès. C’est une partie de ma thèse qui a donné un livre, intitulé La violence totalitaire. À l’époque, ce n’était pas évident de faire une critique du progrès!
À l’opposé, dans le balancement que j’évoque, on aperçoit la figure de Dionysos qui est en train de s’imposer. Il est indéniable que les jeunes générations sont imprégnées de cette figure emblématique. Dionysos est, non pas un dieu uranien, c’est-à-dire purement des idées, mais un Dieu chtonien, un dieu de la terre. La terre n’est pas un lieu purement rationnel, l’émotion y joue un rôle important. Nous entrons dans une nouvelle époque qui ne va pas mettre l’accent sur le futur, le progrès, mais sur un retour de la tradition.
Éric Desordre : Nous avons souvent parlé de lui lorsque nous nous rencontrions, l’auteur qui, dans votre livre, apparaît encore plus souvent que Dionysos. Il est le maître que vous vous reconnaissez : Gilbert Durand.
Michel Maffesoli : Ma rencontre avec lui a été fondamentale. Ce fut une réelle découverte en 1972, lorsque j’ai été nommé assistant à Grenoble. Je venais d’une tradition marxiste. Je n’ai jamais été marxiste mais j’ai par contre été influencé par des auteurs comme Georg Lukacs, qui étaient de ceux qu’on appelait marxiens plutôt que marxistes. C’est à dire non dogmatiques, non inféodés à un dogme et surtout pas à un dogme qui devrait s’appliquer. Parmi les marxiens, un que je cite en particulier est Hans Bloch qui a travaillé sur l’utopie et qui m’a beaucoup inspiré. Ses livres sont partout chez moi. J’étais imprégné par cette tradition, côtoyée à Strasbourg.
Arrivé à Grenoble, la découverte faite grâce à Gilbert Durand a été justement cette idée qu’on ne pouvait pas comprendre uniquement le monde à partir du matérialisme historique, l’économisme, mais qu’il fallait prendre en compte l’ambiance dans laquelle on vivait et l’imaginaire, c’est à dire le climat dans l’atmosphère. Durand donnait des définitions très simples, c’est-à-dire celles des rêves, des mythes, des fantasmes, etc. qui constituent un inconscient collectif. Durand, il ne faut pas l’oublier, était disciple de Jung. Cette tradition n’était alors pas très bien représentée en France. Il m’a influencé. Après tout, toute mon œuvre n’est qu’une déclinaison de cette perspective. L’Air du temps dans lequel on baigne…
Éric Desordre : Est-ce que cette proximité « jungienne » a pu éventuellement vous rapprocher de Jean-Luc Maxence, voire même d’en faire un ami ?
Michel Maffesoli : En effet, c’est ce qui nous a rapproché parce que Maxence était un des rares qui justement mettait enfin l’accent sur les découvertes de Jung que je trouve passionnantes, même si je ne suis pas jungien. Lui était un psychanalyste absolument jungien. Quand je dis que je ne suis pas du tout jungien, entendons-nous, il est certain qu’il m’a inspiré… Si vous voyiez ma bibliothèque de Jung, vous constateriez qu’elle est sinon complète, du moins très fournie. Elle n’est pas ici mais dans mon village puisqu’on est en train de faire un changement de la bibliothèque. Il y a quinze jours, on faisait la recension de tous les livres de Jung et ils occupent une place indéniable. J’étais un ami proche de Michel Cazenave, qui a fait traduire et publier l’œuvre de Jung chez Albin Michel. Lui était un jungien comme Maxence, tous deux étaient d’ailleurs très proches. À la différence de Maxence et à la différence de Durand d’ailleurs, je suis un amateur.
Éric Desordre : Une autre personne qui revient très fréquemment dans Apologie, c’est Julien Freund.
Michel Maffesoli : Julien Freund a été mon premier patron à Strasbourg. J’y étais à partir du milieu des années 60. Je venais de Lyon et je me suis inscrit avec lui. C’est avec Freund que j’ai fait ma première thèse sur la question de la technique et Heidegger. Et pour tout vous avouer, c’est lui qui m’a fait revenir en 1978 à Strasbourg en me faisant nommer Maître assistant.
Éric Desordre : Freund a donc eu un rôle non négligeable dans votre carrière.
Michel Maffesoli : Oui, tout à fait. D’abord, il a été un de mes inspirateurs. Et puis techniquement, en 1978, il m’a donné la direction de l’Institut de polémologie qu’il avait créé à Strasbourg, dans la foulée de la pensée qui était la sienne, inspirée elle-même par Carl Schmitt. L’institut était unique dans la France universitaire de l’époque à étudier la violence et les conflits. Il en existait un autre à Paris mais c’était un institut privé. Avant cela, j’ai fait ma première thèse avec lui sur la thématique de la technique, celle de la vie quotidienne. Celle qui imprègne la vie de tous les jours.
Avant d’être proche de Schmitt, Freund fut en France un des traducteurs et diffuseurs de la pensée de Max Weber. Weber est aussi un auteur qui m’a beaucoup marqué. Il est une phrase de lui que je cite souvent : « il faut être à la hauteur du quotidien ». Il l’entendait tant dans le savant que dans le politique. C’est un paradoxe que d’être à la hauteur de ce qui est « en bas » ! C’est ce qui a guidé une partie de ma carrière. Il y eu bien sûr l’imaginaire avec Durand, mais durant une partie de ma carrière, c’est le quotidien – le bas – qui m’a absorbé. Grâce à Julien Freund.
Précisons une petite nuance concernant Freund. Il a écrit un livre qui m’a beaucoup marqué, intitulé L’Essence du politique. C’était sa thèse en Sorbonne soutenue avec Raymond Aron. Il y fait référence à l’essence du politique et non pas de la politique. J’ai toujours été inspiré par cette idée-là. Le politique, c’est la polis antique, celle de la cité grecque, la démocratie de base. Freund faisait une distinction entre le politique et la politique. Critiquant la politique et mettant en avant que ce qui est important, c’est le politique. J’ai repris cette critique dans beaucoup de mes livres en montrant comment la politique était devenue politicienne, politiste, c’est à dire un truc totalement abstrait n’étant plus enraciné dans la réalité quotidienne. L’essence du politique vient de la cité, la polis antique. C’était là que se constituait les relations, au niveau du quotidien. Une pensée de Freund qui m’a beaucoup marqué démontre que dans la cité grecque, « seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune ». Une belle idée, très simple, était née.
Éric Desordre : Ne pas être « en l’air ».
Michel Maffesoli : Une personne qui savait ce que voulait dire « habiter », « manger », « s’habiller » pouvait gérer la maison commune. Et voilà mon inspiration qui vient de Freund.
Éric Desordre : Un penseur qui revient presque autant que Gilbert Durand est Martin Heidegger.
Michel Maffesoli : Je suis un homme du Midi, mais – je ne sais pas pourquoi – j’ai été fasciné par la langue et la pensée allemande.
Éric Desordre : Elle revient souvent dans vos livres et dans Apologie.
Michel Maffesoli : Un peu d’une manière lancinante, oui. Je n’avais pas appris l’allemand au lycée mais les accords franco-allemands avaient été conclus et des quantités de bourse du « Goethe Institut » étaient proposées. Pendant plusieurs années, je suis donc allé à Kassel, à Munich, etc. pour apprendre l’allemand. Au cours d’un de ces séjours en 1967, j’ai lu en allemand Être et Temps d’Heidegger. Un livre, disons… difficile, mais qui m’a ouvert des portes. Après ma propédeutique à Lyon, j’ai, à cause de ma fascination pour la pensée allemande, choisi de poursuivre mes études à Strasbourg, ville qui est plus proche de l’Allemagne.
J’y ai rencontré un professeur, Lucien Braun. Mort il y a deux ou trois ans, il est peu connu en France. C’est lui qui m’a initié plus avant à la philosophie d’Heidegger. Braun était anecdotiquement lié à Heidegger qui ne savait pas conduire, aussi Lucien Braun le conduisait avec sa voiture. De Strasbourg à Fribourg, il y a 40 kilomètres. Il m’a amené chez Heidegger. Je m’y suis rendu quatre fois, soit à son appartement, soit à sa maison de montagne. Je crois que je suis le dernier Français à l’avoir rencontré.
A l’instar de ce que je dis à mes chers collègues de ma connaissance de l’œuvre de Jung, je suis un amateur de celle de Heidegger. J’ai écrit cette thèse sur la technique chez Marx et Heidegger, soutenue en 1969. Et c’est à partir de ce moment que j’ai rencontré Heidegger. Son dernier cours date d’ailleurs du 29 mai 69. C’était l’époque où il était très violemment attaqué en Allemagne. Je le traduis de ce que disaient mes amis allemands, il était « Le mort de la Forêt Noire ». Ils me disaient : « On ne veut plus en entendre parler ! ». Il n’était pas nazi, pas un « brun » mais avait été bêtement recteur de Fribourg de juin 1933 à février 1934. Du coup, on l’a suspecté d’avoir été nazi. Il l’avait dit lui-même : « Ma grosse bêtise est d’avoir été recteur », sous-entendu, au mauvais moment. Incontestablement, iI était politiquement un imbécile et philosophiquement un génie. L’image qui me vient, c’est l’albatros de Baudelaire que ses grandes ailes, sur le bateau, empêchent de marcher.
Il s’est trouvé qu’il a influencé mon œuvre d’une manière importante, dans tous mes livres et encore maintenant. Cette idée simple de Heidegger, dont je reprends souvent l’expression, est qu’il est un « chemin de pensée ». Il refusait d’être qualifié in fine de philosophe mais se disait penseur. Il a fait une critique de la métaphysique, de la philosophie comme étant des idées venues « du haut ». Il ne faut pas oublier qu’il fut séminariste, qu’il fit un temps un noviciat chez les jésuites.
Éric Desordre : La dimension spirituelle est-elle importante chez Heidegger ?
Michel Maffesoli : La dimension thomiste. Saint-Thomas est un héritier d’Aristote, de ce qui n’était pas simplement le propre des platoniciens – c’est à dire des idées venues d’en haut – mais bien la conviction « qu’il n’y a rien dans l’intellect qui n’ait d’abord été dans les sens ».
Éric Desordre : Les présocratiques ont été flingués par Platon.
Michel Maffesoli : Oui, bien sûr. Mais Aristote qui était disciple de Platon, rompt avec lui, justement sur ce qui est purement de l’ordre des idées. Je dirais sur une « idéosophie », néologisme que je propose. Aristote et par-après Saint-Thomas mettent l’accent sur « l’habitus ». C’est la traduction de « l’existant » aristotélicien. Heidegger, par la formation qui était la sienne, était très proche de cette conception qu’on a appelé le « réalisme ». Ni l’intellectualisme, ni purement le sensualisme, mais le réalisme qui est une conjonction. Voilà ce que j’ai appris : à être méfiant vis à vis des systèmes. Heidegger a critiqué la philosophie allemande, à l’importance si considérable – Kant, Hegel, etc. mais en même temps avec cette forte pensée qui était la sienne, montrant la prééminence du réalisme. Ce que j’en retiens est ce réalisme qui n’est pas éloigné mais au contraire proche du quotidien.
Éric Desordre : Un autre auteur qui apparaît souvent est Joseph de Maistre. Vous en avez d’ailleurs déjà parlé à l’occasion d’autres entretiens.
Michel Maffesoli : De Maistre – encore une fois, je rends à César ce qui lui revient -, ce fut Durand qui me le fit connaître. De Maistre était non pas un savoyard, mais un savoisien (ndlr : de la Savoie au sens historique et politique) comme Gilbert Durand d’ailleurs. Que veut dire savoisien ? C’est quelqu’un qui met l’accent sur les racines profondes. Joseph de Maistre, en la matière, se réclamait des racines de la tradition. Toute son œuvre repose là-dessus. Une des définitions que je donne de Joseph de Maistre, ce que je suis d’ailleurs personnellement : il est un réactionnaire, pas un conservateur.
Éric Desordre : Un anti révolutionnaire.
Michel Maffesoli : Il fut anti révolutionnaire. Toutefois, il n’a pas été immédiatement hostile à la Révolution française. Chambéry n’était pas en France à l’époque, mais il été fasciné par la révolution en son début. Ce n’est que quand il a constaté que la révolution devenait intolérante qu’il l’a rejetée. Maistre va s’en écarter, devenir le contre-révolutionnaire, expression dont il se qualifie et qu’on lui attribue depuis. Dans sa définition, le qualificatif de « réactionnaire » est beaucoup plus riche. Et c’est ce que j’ai appris de lui. Il met l’accent sur la tradition. Là encore, on revient sur cette idée que « ce qui a été donné, on le transporte ». Pas simplement le mythe du progrès, mais aussi cette tradition.
N’oublions pas, on ne l’a peut-être pas dit assez: de Maistre était franc maçon et est resté d’une maçonnerie proche de certains maîtres de Lyon. Cette maçonnerie mettait l’accent sur l’importance de ce dont on hérite. Non pas simplement une maçonnerie progressiste mais aussi une philosophie progressive. Je lis quasiment chaque jour une page des Soirées de Saint-Pétersbourg. Il y a dans cette dimension-là, un enracinement qui n’est pas forcément conservateur.
Éric Desordre : En nous parlant comme vous le faites de ces penseurs, vous nous éclairez sur votre travail et sur l’œuvre de ces personnes-là. Sans proposer une exégèse de la pensée de chacun, cela donne des pistes aux lecteurs.
Michel Maffesoli : Il s’agit d’une autobiographie intellectuelle. Outre le fait que tout au début j’y parle de mon enfance – ce qui est pas l’essentiel -, je parle de ces auteurs que j’ai rencontrés à partir de 1964 puis en 1967 à Strasbourg, et puis à partir de 1981, quand j’ai été nommé ici, à la Sorbonne. J’avais 37 ans, ce qui était jeune pour un prof à l’époque. Le hasard a fait que j’ai eu la chaire de Durkheim, ce qui m’a valu beaucoup d’ennuis et d’ennemis dans le milieu sociologique. J’étais lié à des professeurs qui étaient de la génération d’avant la mienne. Ma génération est arrivée après. C’est cette situation qui m’a amené à rencontrer Lévi-Strauss, Michel Foucault, Deleuze, Lyotard.
Éric Desordre : De grands personnages de la pensée.
Michel Maffesoli : On avait obligatoirement chaque mardi un déjeuner au Port-Salut, rue Saint-Jacques ! C’étaient les professeurs qui se devaient s’y retrouver, les maîtres assistants n’en étaient pas. On se rassemblait entre gens opposés.
Éric Desordre : Un bouillon de culture.
Michel Maffesoli : Ça papotait, ça discutait, ça échangeait. Nous appliquions en termes très concrets ce qu’est la disputatio.
Éric Desordre : C’est l’Agora.
Michel Maffesoli : Oui, c’est l’Agora. Je préfère pour ma part utiliser le terme disputatio puisque c’est en 1258 que la Sorbonne a été créée. On a d’ailleurs pu dire qu’à l’époque Paris était l’Athènes du moment. Et c’était vrai à plus d’un titre. Cette vieille tradition de disputatio a existé. Lévi-Strauss et moi n’étions pas d’accord sur bien des points mais il avait lu mon livre Le temps des tribus et nous avons ensemble pratiqué la disputatio. Il y eu bien sûr Michel Foucault qui me recevait rue de Vaugirard où je me rendais souvent. Voilà des évènements anecdotiques mais qui m’ont formé. Et si vous vous référez à Bernard de Chartres, qui était de la grande école du 12ᵉ siècle, nous sommes des nains, hissés sur les épaules de géants. Je le répète parce que j’y crois. Je pense en effet qu’on ne part pas de rien. On est obligés. On se situe par rapport à des gens qui nous ont précédés, ce qui nous permet de transmettre par-après.
Éric Desordre : L’autre personnage qui est très important dans votre parcours intellectuel, c’est Saint-Thomas d’Aquin.
Michel Maffesoli : Oui, bien sûr. C’est curieux, cette histoire. Cela est dû ma formation. Quand j’étais jeune, j’étais fasciné par la vie monastique. Peut-être aurais-je dû être moine ; ma vie eut été plus simple. Je suis resté sur cette idée de la Lectio Divina qui est le fait de ruminer. Et il s’est trouvé que dans cette tradition-là, j’ai fait paraître mon premier texte en 1966. C’était L’union de l’âme et du corps chez Saint-Thomas d’Aquin.
Alors que j’étais à l’Université d’État de Lyon où je faisais ma propédeutique – appelé plus tard le « DEUG » -, j’étais aussi inscrit à la Faculté, à l’Institut catholique de Lyon. Il était d’ailleurs interdit d’utiliser le terme « Faculté » ou « Université ». Ces grandes et belles universités, les instituts Catholiques de Lyon et Paris n’avaient pas le droit de s’appeler universités et s’appelaient « instituts ». Je gagnais alors ma vie comme pion dans un collège mariste. Un des profs du collège m’a amené à l’Institut catholique de Lyon. J’y ai rédigé un mémoire intitulé Baccalauréat de philosophie scolastique, résultat de deux ans d’études sur la philosophie scolastique… et Saint-Thomas ! L’union de l’âme et du corps, le réalisme thomiste. Vous voyez, là, à côté de moi, j’ai la somme théologique de Thomas. Je la lis chaque jour. Afin d’aller au-delà du dualisme qui a prévalu chez nous en France avec Descartes, avec la distinction entre le corps et l’âme. Saint Thomas, au contraire, montre l’étroite liaison qu’il y a entre l’âme et le corps. Mystère de l’incarnation. Saint-Thomas va développer tout au long de sa carrière cette idée d’incarnation.
Toute mon œuvre a bien montré qu’on ne pouvait plus être simplement idéaliste ou idéosophique, mais qu’on ne pouvait comprendre, que ce soit la vie sociale et chacun d’entre nous que dans « l’entièreté de l’être ». Maintenant on dit « holisme », mais ça revient à ça. Le fait qu’il n’y a pas de séparation, pas de coupure mais au contraire une liaison constante, une interaction. Le mot qu’il faut retenir : réalisme.
Éric Desordre : Et puis enfin, mais vous en avez déjà parlé, Max Weber.
Michel Maffesoli : Juste un mot quand même, à propos d’un livre de Max Weber, vous voyez, qui est là, relié derrière chez moi, un livre que je prends en main : Le savant et le politique. C’est quelque chose d’important. Moi, je n’étais pas politique, je voulais être savant à l’encontre de tous mes chers collègues sociologues qui étaient de gauche. On dit « sociologue de gauche », c’est un pléonasme ! Moi justement, non, je n’ai pas à dire si je suis de gauche ou de droite. Comme ce qu’on peut dire du journal Rebelle(s), je n’ai pas envie d’être « ceci » ou « cela ».
Éric Desordre : Qu’on vous place dans une catégorie vous déplait. Vous ne voulez pas être assigné.
Michel Maffesoli : Je ne vais jamais rentrer dans une catégorie de cet ordre et Weber m’a aidé là-dessus. Le savant et le politique fait une distinction nette et claire.
Éric Desordre : Comme vous le rappelez en citant peut être Hannah Arendt : « Je n’ai pas l’odeur de la meute. »
Michel Maffesoli : Ah oui, c’est vrai, ça… Mais Anna Arendt avait une phrase plus chic. C’est une qualification qui m’avait été attribuée par un de mes collègues.
Éric Desordre : Je la trouve magnifique.
Michel Maffesoli : Oui, elle est bien. Hannah Arendt disait plutôt en anglais quelque chose comme « I don’t fit ».
Éric Desordre : Je cite rapidement d’autres inspirateurs : Aristote, Emile Durkheim, Georges Simmel.
Michel Maffesoli : On va évacuer le premier Durkheim. Le curieux, c’est que je n’étais pas fasciné par Durkheim. Mais le hasard de ma carrière a fait que j’étais nommé à la chaire Durkheim.
Éric Desordre : Bon…, ça oblige.
Michel Maffesoli : Oui ! Je me suis senti obligé. Malgré que le positivisme durkheimien ne soit pas mon genre.
Éric Desordre : Bien sûr, sans parler d’Auguste Comte…
Michel Maffesoli : En même temps, j’ai trouvé dans l’œuvre de Durkheim des éléments fort intéressants. Pour tout vous avouer, j’ai fait une grosse préface aux Formes élémentaires de la vie religieuse, qui est un des classiques qui est paru ainsi en poche. Il y a eu plusieurs éditions dans Le Livre de poche, puis ça a été repris aux éditions du CNRS. J’ai également fait quatre ou cinq préfaces à des petits livres de Durkheim. Alors on ne peut pas parler d’un accord immédiat, plutôt d’une réticence vis-à-vis du positivisme et en même temps, je me suis rendu compte que Durkheim était bien plus riche que le Durkheimisme.
Éric Desordre : Ce qui est généralement le cas.
Michel Maffesoli : On pourrait en effet le dire aussi de Descartes, plus riche que les cartésiens. Grâce à Freund à Strasbourg, j’ai eu la chance de rencontrer le doyen qui avait été en 1918 le dernier assistant de Georges Simmel. Ce jeune universitaire d’alors est devenu professeur à l’université et je l’ai connu comme doyen de la faculté de philosophie et de théologie protestante. C’est lui qui m’a initié à Simmel. La pensée française, cartésienne qu’elle était par essence, a toujours eu une méfiance vis à vis de la Lebensphilosophie. Cette philosophie de la vie qui était, disons, celle de Nietzsche, de Weber, de Simmel enfin qui a été mon inspirateur. Simmel a écrit des textes en 1912 sur la mode, sur le corps. Des sujets qui, à l’époque, étaient considérés comme étant anecdotiques, frivoles même ! Il montrait que c’était ça qui était l’essentiel, parce que c’était une composante de la vie quotidienne.
Éric Desordre : Dans les lettres de Nietzsche à sa sœur, à sa mère, il y a cette dimension très pratique, très anecdotique.
Michel Maffesoli : C’est quand on lit des quantités de choses de Nietzsche qu’on le comprend véritablement. Cet attachement au quotidien lui a valu des ennuis de la part de ses chers collègues aussi. N’oublions pas, que ce soit à Bâle ou après, que la classe philosophique l’a rejeté pendant longtemps, parce qu’il s’occupait justement de ces choses de la vie. C’est de lui que vient cette Lebensphilosophie, non pas une philosophie désincarnée, mais bien le contraire, une philosophie de la vie.
Éric Desordre : Autres inspirateurs : Carl Schmitt, Edgar Morin, Jean Baudrillard.
Michel Maffesoli : L’étude de la pensée de Carl Schmitt, je la dois à nouveau à Freund. Il m’a reçu chez lui où l’on a beaucoup bu ; il était un grand buveur de vin du Rhin ! Je buvais du vin d’Alsace, mais on a échangé véritablement ! C’est Freund qui avait traduit La théorie du Partisan, il ne faut pas l’oublier. Schmidt, lui et à la différence de Heidegger, avait véritablement été nazi, au moins jusqu’en 36. Il s’est ensuite fait éjecter du parti bien qu’ayant été le théoricien antisémite qu’on connaît. Mais au-delà de ça, Schmidt, catholique pratiquant et traditionaliste, a montré la liaison du corps et de l’esprit, le bien et le mal. On n’est pas simplement du « bon » côté, il y a aussi la part d’ombre… et tout ce que j’ai écrit, si un de mes livres s’appelle justement La part d’ombre, c’était pour montrer qu’on est composé aussi de cette ombre, qu’un homme sans ombre n’existe pas, pas plus qu’une société sans ombre.
Edgar Morin. Oui, bien sûr. Il vient dîner chez moi la semaine prochaine. 103 ans. Jusqu’à La Méthode, il a été celui qui faisait disruption par rapport à la bien-pensance, aux lieux communs de la sociologie. Les premiers de ses livres abordaient la sociologie de la mort, celle de l’imaginaire rendant attentif à ce que j’appelais tout à l’heure « l’entièreté », le holisme. On se fréquente depuis toujours en échangeant sur cette idée holistique. Tout son propos, qui va culminer dans ces sept tomes de La Méthode renvoie essentiellement à cette perspective-là. Maintenant, il est devenu une forme de canonicité mais est toujours un rebelle. Petite anecdote : en 45-46, communiste, il est lieutenant dans l’armée française d’occupation en Allemagne. Le secteur qui est donné à l’armée française est Fribourg. Et c’est lui qui va sauver Heidegger. Il rencontre Heidegger, discute avec lui, tout communiste qu’il est. Il va faire en sorte avec le général en charge de la région que Heidegger ne soit pas exclu de son université.
Éric Desordre : Cela peut paraître anecdotique mais c’est très éclairant.
Michel Maffesoli : C’est éclairant par rapport à ce qu’Edgar Morin était politiquement.
Éric Desordre : L’honnêteté intellectuelle.
Michel Maffesoli : En reconnaissant l’importance d’Heidegger…
Le dernier que vous avez cité est Jean Baudrillard, un ami intime. J’ai fait sa connaissance quand j’étais assistant à Grenoble à l’Institut d’urbanisme. Par extraordinaire, on avait des sous parce que le maire de la ville aimait bien cet institut. J’avais donc un budget non négligeable. Et c’est là, en 72-73, que j’ai fait venir Edgar Morin et Jean Baudrillard. Cela a été le début d’une longue amitié avec Jean. Pour une raison simple. Il était une espèce d’exception, un apax dans la sociologie marxisante du moment. Il était germaniste et a traduit L’idéologie allemande de Marx et Engels pour les éditions sociales, éditeur dans le giron du Parti Communiste Français.
Éric Desordre : L’éditeur des trois tomes du Capital.
Michel Maffesoli : Jean Baudrillard a été comme moi de cette vieille tradition ouverte. Il n’a jamais été membre du Parti communiste, et à l’université se comportait en rebelle. Restons encore sur cette idée, sur ce mot qui est important. Il s’inscrivait non pas dans le conformisme qui régnait à l’époque, mais au contraire dans quelque chose d’ouvert, proche des situationnistes, proche d’Henri Lefebvre dont il a été l’assistant.
On a eu des discussions passionnantes. J’habitais à Grenoble et quand je venais à Paris, je logeais chez lui. Nous vivions des moments de complicité qui démontraient bien le type d’accord intellectuel que nous avions. C’est grâce à lui que j’ai quitté ou abandonné ce qui était le propre en principe de l’intellectuel, c’est à dire l’attitude critique. Depuis fort longtemps, à cause ou grâce à Baudrillard, j’ai dépassé la critique. Il n’avait pas la formation grécisante qui est la mienne mais je lui ai rappelé que « krinein » est le trébuchet du juge, l’acte d’évaluation qui dit le bien et le mal. Nous avons convenu, en accord avec ma formation wébérienne, que l’attitude intellectuelle n’avait pas à être judicative ou normative, non pas critique mais radicale. Voilà le glissement, de la critique à la radicalité. La radicalité, c’est la racine des choses. Ce que m’a appris Baudrillard est cette idée de radicalité.
Éric Desordre : Vous citez Sartre trois fois seulement. Au-delà de votre rejet de son œuvre, ou de la méfiance instinctive pour sa vie dont l’exemplarité n’est pas le fort, pensez-vous que Sartre connaît aujourd’hui une éclipse autant qu’il a été longtemps une référence incontournable dans le milieu intellectuel français ou même mondial ? Et pourquoi cette éclipse, si toutefois vous êtes d’accord avec ce terme d’éclipse.
Michel Maffesoli : C’est difficile! J’étais à Rio de Janeiro le jour de sa mort et les journaux locaux me questionnaient. Ils voulaient faire un entretien avec moi. J’ai refusé et indiqué que je ne pouvais pas, à l’étranger, dans un journal, dire ce que je pensais de Sartre, c’est-à-dire que du mal !
A l’époque où je commençais à publier quelques articles, Sartre avait reniflé que j’arrivais dans le paysage. Simone de Beauvoir et lui m’invitèrent à deux déjeuners. Ils voulaient savoir qui était celui-là, qui était ce truc ?
Éric Desordre : « The New Guy in Town ».
Michel Maffesoli : En effet ! Ce ne fut pas très intéressant. Son premier livre en 1936 est sur l’imaginaire. Un des suivants, en 1940, sur l’imagination. Dans ces livres-là, il reprend la vieille idée – que l’on a attribuée à Descartes mais est de Malebranche – : « L’imagination, c’est la folle du logis ». Autrement dit, seule importe la Raison, il faut se méfier de l’image, de l’imagination, de l’imaginaire, etc. Or j’étais disciple de Durand à l’époque. Au cours de notre discussion, Sartre est resté avec cette conception étroite qu’il faut se méfier de l’imaginaire. De surcroît, je ne lui attribue pas une qualité intellectuelle énorme. Il est le prototype de ce que sont devenus les BHL, Onfray ou Glucksmann, des pseudo philosophes qui sont ceci et cela, et, entre autres, philosophes. Et pourquoi pas danseur de claquettes? Il écrit en effet L’Être et le Néant, puis des romans, du théâtre, etc. Il a ce côté médiatique très superficiel. Sartre se diffracte dans toute une série de choses sans être véritablement un philosophe, même s’il dit avoir été en son début influencé par Heidegger. La Lettre sur l’humanisme de Heidegger est une réponse au pseudo philosophe Sartre.
Éric Desordre : Je note parmi les personnes que vous citez, un nombre considérable de philosophes, mais aussi une présence très importante des poètes. Quelques noms : Bataille, Baudelaire, Breton, Char, Chateaubriand, Chrétien de Troyes, Dante, Goethe, Hölderlin, Lautréamont, Lucrèce, Mistral, Nerval, Péguy, Rimbaud, Virgile. En fait, ce n’est pas du « Name Dropping », cela ressemble à un panthéon esthétique.
Michel Maffesoli : Oui, l’expression me convient bien. J’ai toujours refusé l’enfermement. De ma grand-mère : « Il n’y a que les cornichons qu’on met dans des bocaux ». Le propre même de l’Universitas, dans son sens étymologique, est cette dimension plurielle. Il s’est trouvé que j’ai fait une thèse de philo et une thèse de socio et qu’en même temps, j’ai été influencé par la pensée poétique. Heidegger, pour ne pas le nommer, a écrit deux livres sur Hölderlin. Je considère qu’il y a dans la poésie une cristallisation de ce qu’est la vie quotidienne, la vie de l’imaginaire. Dans mon propos et mes écrits, la poésie occupe une place non négligeable, la philosophie non moins, la théologie pareillement. Je considère ce sens de cristallisation tel que Stendhal l’utilise, surgissant de la vie dans laquelle nous baignons.
Éric Desordre : Alors vous répondez en partie à la question suivante. A la lecture de votre livre et à l’évaluation des poids relatifs de ces grands personnages, je me suis demandé, comme d’ailleurs j’avais été tenté de le faire à la lecture d’autres de vos ouvrages, si le seul qualificatif de sociologue vous convenait totalement. Vous vous présentez et votre éditeur vous présente ainsi, alors que la philosophie est si importante dans vos écrits et dans votre pensée. Mon sentiment est que vous êtes plus un philosophe que seul sociologue. Est-ce que vous rejetez totalement cette impression ?
Michel Maffesoli : Je ne la rejette pas. En effet, j’ai été titulaire de la chaire de sociologie générale pendant 35 ans. On va dire que c’est un peu le hasard. J’avais deux thèses, il fallait gagner sa vie.
Éric Desordre : Bien sûr, il fallait remplir le frigo !
Michel Maffesoli : Eh oui ! Il s’est trouvé qu’était proposé un poste d’assistant de sociologie à Grenoble, puis j’ai été maître assistant à Strasbourg, ensuite professeur à la Sorbonne. Mais mon propos a toujours été de faire une conjonction, une coincidencia oppositorum. On compte trop de choses apparemment opposées. Pour tout vous avouer, ça a été une des critiques fortes qui a été faite à mon égard par mes chers collègues, en particulier par ceux qui était dominants à l’époque, c’est à dire les Bourdieu et les bourdieusiens. Un Bourdieu et ses thuriféraires que Morin appelait méchamment « les Bourdivins ». Lors de la discussion que j’ai eue avec Bourdieu ici, place de la Sorbonne au cours du seul déjeuner que nous eûmes ensemble, il me reprocha ma « philosophie sociale » ! Ce qui fut sa préoccupation, lui qui était agrégé de philo, était de montrer que la « science » sociologique n’avait rien à voir avec la philosophie. Il a critiqué à plus d’un titre la philosophie sociale. Je n’ai pas envie d’avoir un titre, j’ai eu ce titre de sociologue et on continue à le dire maintenant constamment.
Éric Desordre : Vous êtes, pour beaucoup de gens qui ne vont pas chercher très loin, dans une case.
Michel Maffesoli : Et moi je dis non ; ce sont les cornichons que je mets dans des bocaux. J’essaie d’être plutôt en renifleur social, c’est à dire plutôt un penseur. S’il y a un mot qui me conviendrait et en tous cas que je revendique, c’est plutôt cette idée de penseur qui n’est pas inféodé, qui n’est pas encastré.
Éric Desordre : Hannah Arendt : « I don’t fit ».
Michel Maffesoli : Oui, bien sûr. Les pensées qui continuent à me marquer sont celles de Baudrillard, ou d’Edgar Morin, de Gilbert Durand, qui était anthropologue, philosophe, sociologue. Peu importe. Au-delà des qualifications, il me paraît important d’avoir cette dimension ouverte. C’est ça, la pensée.
Éric Desordre : Je voudrais revenir à une autre dimension de votre vie, de votre être qui est la spiritualité. Vous avez réalisé des retraites spirituelles dans un monastère. Vous y fûtes même aspirant moine, postulant. Vous avez donc été tenté par les ordres. Je vous lis, en page 159 : « Après plus de trente années d’enseignement en Sorbonne et de nombreux échanges avec mes étudiants, je continue à recevoir et à discuter avec les nombreux jeunes gens ayant lu tel ou tel de mes livres, se retrouvant dans le cheminement que je propose. Accéder du visible à l’invisible, du temporel à l’intemporel » ; ce qui est, on le comprend aisément, la spécificité de la démarche imaginale. On est loin de la seule sociologie. Cette dimension spirituelle qui vous caractérise me plaît particulièrement puisque je suis moi-même en recherche spirituelle, je dirais avant tout comme poète. La spiritualité étant différente de la notion de religion. Cette démarche imaginale, l’aviez-vous déjà au moment où vous étiez tenté par les ordres ou en tout cas par la retraite ?
Michel Maffesoli : C’est toujours difficile à dire. J’ai voulu rappeler ces origines, que tout jeune j’ai fréquenté ces monastères. Je raconte même comme anecdote que je suis peut-être un des seuls français à être rentré dans la Grande Chartreuse sans avoir été moine, ce qui ne se faisait pas à l’époque. Le hasard de ma vie a fait qu’un ami de mon collège était du même hameau que Ferdinand Vidal, le grand prieur de la Grande Chartreuse. Je lui ai écrit et j’y ai passé une nuit. C’était une préoccupation importante. Je trouve que c’est une des spécificités de la postmodernité. Pour autant, soyons clairs, il n’y a pas lieu de cracher dans la soupe. La modernité avait en quelque sorte – je vais encore être wébérien -, désenchanté le monde. Le rouleau compresseur du grand rationalisme avait abouti à cela. On voit comment, au contraire, actuellement, on assiste à ce retour du spirituel, divers et multiple.
Je suis plutôt attiré par le catholicisme traditionnel, celui de ma jeunesse, mais je suis amené à constater que chez ces jeunes générations, il y a quelque chose qui va dépasser le matérialisme historique ou l’économisme. Ou encore ce que Marx appelait l’infrastructure, la superstructure étant pour lui secondaire. Je crois qu’il y a une conjonction des deux, c’est tout. On a parlé de Saint-Thomas, c’est quelque chose de cet ordre. De mon point de vue, une des spécificités de la postmodernité est bien de saisir le visible à partir de l’invisible. Toute la dimension spirituelle qui nous anime fortement. Et tout au long de ce livre, je montre que c’est une de mes constantes depuis ma jeunesse. Je considère que c’est ça qui est prospectif.
Éric Desordre : Alors, curieusement, vous ne faites pas apparaître fréquemment Bernanos, alors que je serais prêt à parier que vous avez des préoccupations et des convictions communes. Vous aimez bien les hérétiques, vous êtes très clairs dans le chapitre en guise d’ouverture. Vous dites l’affaiblissement politique, la décadence notoire qui pour vous est liée à la sécularisation. Vous fustigez le mythe du progrès. Est-ce que l’œuvre de Bernanos, qui intéresse beaucoup de nos lecteurs, vous a marquée ?
Michel Maffesoli me désigne les livres posés à côté du canapé. Ils sont de Bernanos.
Michel Maffesoli : J’ai tout lu de Bernanos mais je n’en ai pas fait état dans ce livre. De ses romans ou ses essais qui me sont une lecture constante, je ne peux pas dire qu’ils m’aient inspiré, mais ils m’ont marqué. Aussi bien en tant que romancier qu’en tant qu’essayiste, il est un esprit libre qui correspond tout à fait à ce que j’essaie de faire à ma manière.
Éric Desordre : En ce qui concerne la religion, vous opposez le catholicisme, qui a votre préférence, au protestantisme. Max Weber qui est un laudateur du protestantisme apparaît dans cette analyse, vous faisant souligner l’importance de ce que vous lui devez dans votre parcours intellectuel. Or, votre analyse fait penser que la réforme a en quelque sorte abimé la société. Vous parlez à propos des protestants de « mahométans européens » et vous appelez de vos vœux une sorte de refondation d’un catholicisme médiéval qui est un polythéisme raisonné. Est-ce que c’est aussi rapide que ça ? Le protestantisme doit-il être fustigé tel que du moins j’ai l’impression que vous le faites rapidement dans le livre ?
Michel Maffesoli : Dans plusieurs de mes derniers livres, j’ai critiqué la protestantisation de l’Église catholique, ce n’est donc pas nouveau. Vous le savez peut-être, je suis marié avec une protestante luthérienne depuis cinquante-six ans exactement. J’ai aussi un baccalauréat de théologie protestante. Je crois donc être un peu un connaisseur du sujet et je continue à lire beaucoup de choses sur Luther. Calvin par contre ne m’intéresse pas ; le calvinisme est un autre problème. Alors en effet, ma critique devient de plus en plus forte vis à vis du protestantisme qui a en quelque sorte déchiré la tunique sans couture du Christ. Avec la réforme protestante va se faire la perte de l’Europe. Je crois que toutes les guerres qui ont eu lieu ou ont commencé en Europe, 1870, Première et Deuxième Guerres mondiales ont été la suite du protestantisme. Avant, il y avait des conflits de taille limitée. Carl Schmitt parle des « conflits justes » qui étaient des oppositions de principautés, d’entités de petites dimensions jamais susceptibles d’embraser l’Europe.
Éric Desordre : C’était une des réflexions de Charles de Gaulle, que la Première Guerre mondiale puis la Seconde n’avaient jamais été que la suite de la guerre de Trente Ans.
Michel Maffesoli : Ensuite – et cela apparaîtra dans de nouvelles préfaces dans les rééditions de certains de mes livres -, un de mes leitmotivs est la critique de l’individualisme. L’individualisme est la marque de la modernité. Cet individualisme, « Sola Fide », vient de Luther. On traduit le texte sacré en langue profane puis Gutenberg le diffuse. Il n’y a pas nécessité d’un corps ecclésial puisque tout un chacun a accès à son Dieu grâce aux textes sacrés, entraînant le « libre examen » qui est la grande idée protestante et luthérienne en particulier. C’est ce qui marque la modernité. Vous avez cité Weber et l’éthique protestante. En effet, L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme de Max Weber ne fait que redire cela, en montrant l’importance morale du travail, celle de l’argent et le lien des deux avec le capitalisme. C’est la modernité.
De mon point de vue, on est en train de dépasser ce processus de modernité et donc d’individualisme, avec le tribalisme, le « nous » à la place du « je », etc. Voilà pourquoi je critique le protestantisme. Je le fais en connaissance de cause, je n’ai rien contre les protestants mais m’oppose à ce que le protestantisme représente.
Éric Desordre : J’ai été frappé par la notion de « nouveau Moyen Âge » que vous appelez de vos vœux. Vous citez Orwell et ses dénonciations de la mort de la tradition et de l’hygiénisation de la vie sociale. A contrario de la vie communautaire, de l’être ensemble, d’un renouveau postmoderne. Quel est ce nouveau Moyen Âge dans ses dimensions de relations entre les êtres et de philosophie de la vie ?
Michel Maffesoli : Je vais le dire avec prudence, parce qu’il me faudra faire quelque chose d’un peu plus fouillé dans un prochain livre. Je reprends l’idée de Nicolas Berdiaev. C’est lui qui a écrit le Nouveau Moyen Âge. Il le fait à sa manière et je ne vais pas le copier mais je le complèterai. Le grand siècle moderne est le 19ᵉ, où se constituent les grands systèmes qui tirent les conséquences des lumières du cartésianisme. La vraie modernité et ses institutions s’élaborent au 19ᵉ siècle ; Michel Foucault l’a bien montré.
Éric Desordre : On pense à Surveiller et punir.
Michel Maffesoli : Voilà. La doxa qui a prévalu au 19ᵉ, et Michelet en était le grand prêtre, c’était « l’obscurantisme » du Moyen Âge. Tout ce qui précédait la modernité était suspect et obscurantiste.
Éric Desordre : Et quel talent pour le dire.
Michel Maffesoli : Bien évidemment, on n’a rien à y redire. Rousseau dont je relis actuellement Les Confessions s’inscrit dans cette grande perspective là, promue et en quelque sorte solidifiée par Michelet. Or le Moyen Âge, aux 12ᵉ et 13ᵉ siècles, ce sont Saint-Thomas, Abélard qui est un de mes maîtres, Saint-Bonaventure, Albert le Grand, etc. Quand je passe place Maubert, je n’oublie pas ce que veut dire « Maître Albert ». Il y avait là, en particulier à Paris, cette espèce d’éblouissement de la pensée.
Éric Desordre : Pierre Le Vénérable.
Michel Maffesoli : Exactement tout ça, tout cette perspective-là, on va dire les 12ᵉ, 13ᵉ et 14ᵉ siècles ont été des moments de créations très importantes, tant dans le domaines des idées que du point de vue sociologique. Dans la vie sociale régnait une vraie organicité de solidarité. Bien sûr, le seigneur était là mais il devait protéger les serfs, les paysans, etc. Il y avait un vrai processus de solidarité et d’entraide, une solidarité organique.
Éric Desordre : Voulez-vous dire qu’il n’y avait pas encore une société de classe ?
Michel Maffesoli : Il n’y avait en tout cas pas cette séparation. Il n’y avait pas ce qui vient de la verticalité du service public mais au contraire quelque chose qui s’élabore à l’horizontalité de la vie. De mon point de vue, c’est ce qui est en gestation dans la postmodernité.
Mon image, c’est la spirale. On voit revenir des caractéristiques de ce moment de l’histoire. Quand je parlais du tribalisme, il s’agissait de montrer ce qu’étaient les « tribus » classiques : vivre la solidarité, lutter contre l’adversité végétale, animale, celle des autres tribus, etc. Dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles, le besoin se fait sentir, Internet aidant, de retrouver des formes de solidarité, d’entraide, de partage. C’est pour ça que j’avais employé le mot « tribu ». Ce qui sera la postmodernité est le retour à un autre niveau de ce qui a été la solidarité organique. La grande différence avec Durkheim, c’est que dans sa thèse prévalait la solidarité organique moderne contre la solidarité mécanique du Moyen Âge. J’ai inversé ça dans un de mes livres, La Violence totalitaire, en montrant qu’à l’encontre de Durkheim, je pense que nous sommes en train de retrouver une solidarité organique médiévale.
Ce qui est le fondement un peu inconscient de l’intelligentsia française, c’est la grande idée hégéliano-marxiste du dépassement. On va dépasser la maladie, la mort, les dysfonctionnements, etc. On continue à fonctionner sur cette idée.
Éric Desordre : C’est l’idée mortifère d’homme augmenté. Vaincre la mort. Le transhumanisme n’est jamais qu’une continuation de cela.
Michel Maffesoli : L’idée du progrès permanent. A l’opposé de ça, il y a un mot difficile à traduire de Heidegger qui est « Verwandlung » qui peut en français être représenté par trois termes : reprise, distorsion, guérison. Cela reprend les éléments médiévaux : l’idée de « reprise ». Puis « distorsion » : on les tord, ce n’est pas la duplication à l’identique. Enfin : « guérison » avec la guérison du corps social. On reprend, on tord, on guérit et dans le fond c’est ce que j’appelle l’idéal communautaire, l’idéal qui va dépasser l’idéal démocratique.
Hannah Arendt a montré comment s’est élaborée dans la modernité l’idéal démocratique. Pour moi, il est fini, il est saturé et on le voit de diverses manières, la crise actuelle en est une expression. Par contre, cet idéal communautaire est en train de revenir, ce que je propose d’appeler – je copie Hannah Arendt qui a parlé d’idéal communautaire -, un idéal communautaire en gestation. Idéal : ce vers quoi on tend. C’est-à-dire la reprise d’éléments qui étaient organiques, les solidarités. Il est amusant de voir qu’internet aidant, apparaissent les mots archaïques que sont « partage », « échange », « solidarité », « entraide », « écoute », « respect ».
Pas de précipitation. Il faut du temps à cette sensibilité pour s’élaborer contre la pensée commune, contre le conformisme. Je ferai peut-être un second tome des Mémoires, plus personnelles probablement, en faisant référence bien sûr à toute une série de gens que je n’ai pas cités mais que j’aimerais évoquer.
Merci à Michel Maffesoli pour cet échange vivifiant. Son livre est un antidote au conformisme. Dans les replis de cette conversation, j’ai vu émerger un monde où les idées ne sont pas des chaînes, mais des ailes. Lisez-le, quand bien même vous ne partagiez pas toutes les convictions qui y sont exprimées ; et rejoignez les rebelles. Chez Rebelle(s), nous continuons à tracer cette voie, sans urgence non plus, car le temps est notre allié contre ce que la doxa du moment peut avoir d’asséchant pour nos neurones.
Apologie – Autobiographie intellectuelle, de Michel Maffesoli – Les éditions du Cerf, 2025, 24,90€




