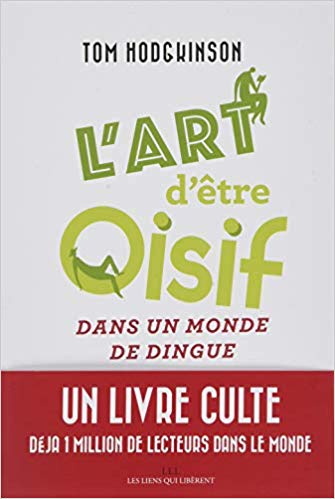Les jardiniers de la folie est paru il y a près d’un quart de siècle. À sa sortie, le livre fit sensation auprès du corps médical et connut un grand retentissement public. Il reste très largement d’actualité, l’auteur Édouard Zarifian, psychiatre, ayant anticipé ou entrevu les évolutions constatées depuis lors. Par sa dimension humaniste, l’ouvrage est devenu un classique à l’instar des grands textes sur la folie de Michel Foucault, quand bien même il n’eut pas une semblable ambition philosophique et qu’il ait été l’œuvre d’un médecin, d’un praticien.
Le psychiatre tente tout d’abord de distinguer le normal et le pathologique, ce qui s’avère très difficile car interroger la maladie, c’est interroger la norme dont le caractère conjoncturel est avéré. Un exemple : « Que penser des délires mystiques qui, selon le contexte, l’interlocuteur ou l’époque, conduisent à la sainteté ou à l’asile ? » Édouard Zarifian essaie dans la foulée de définir ce qu’est une guérison, ce dont on comprend qu’elle est une notion également fort délicate à clarifier. On rentre ainsi page après page dans l’analyse du monde complexe, obscur, changeant de la folie qui nécessite une approche thérapeutique ne pouvant être isolée mais devant prendre en compte « l’homme dans sa globalité physique, psychique et sociale ».
Nous est ensuite proposé le panorama le plus complet possible des approches du traitement de la folie : les médicaments, les approches thérapeutiques, les institutions, les grilles d’analyses, etc. Succès, avantages, limites, excès de chaque approche, de chaque institution sont examinés, décortiqués, mis en perspective.
Nous apprenons sans surprise qu’aucune n’échappe à une recherche d’exclusivité pour traiter la personne souffrante. Aucune n’évite non plus la fragmentation en obédiences multiples, à l’intérieur desquelles les querelles de chapelles s’épanouissent ; ce qu’on peut penser s’accomplir au détriment du malade…
Pour ce qui est des structures d’accueil, par exemple, il est des institutions hiérarchisées niant les libertés et considérant le malade comme un objet inférieur soumis à l’autorité des « sachant ». On trouve également des institutions incorporant le malade au tissu communautaire, où le mythe égalitaire efface les repères « dans une fraternité fusionnelle », toutes aussi coupées du monde extérieur. Ces deux modèles extrêmes qui ont encore leurs thuriféraires « assurent au malade une chronicité lénifiante de son mal-être. »
Les capacités respectives de chaque approche sont exposées : capacités explicatives des symptômes, capacités descriptives des symptômes, capacité de suppression des symptômes. Aucune approche ne s’avère suffisante pour prendre en compte la totalité des situations, la totalité des souffrances.
On lit que la psychanalyse reste le meilleur système descriptif du psychisme et des manifestations de l’inconscient mais ne guérit pas la schizophrénie ou l’autisme infantile.
S’il interroge de façon critique les effets thérapeutiques de la cure psychanalytique, le psychiatre dénonce toutefois les confrères manipulateurs qui sortent les écrits de Freud de leur contexte en citant puérilement celui-ci : « L’avenir attribuera probablement une importance plus grande à la psychanalyse comme science de l’inconscient que comme moyen thérapeutique ». Il considère qu’une telle attitude ne favorise pas le progrès. Il renvoie dos à dos les idéologies, elles-mêmes obligeant les familles des malades à épouser la doctrine de leurs soignants. « C’est un acte de foi qui leur est demandé ». En effet le pouvoir ne se partage pas.
Quant aux traitements médicamenteux, ils peuvent dans certains cas être très efficaces mais n’ont été découverts que par hasard et « aucune stratégie neurobiologique n’a permis, jusqu’à ce jour, une véritable innovation… l’industrie pharmaceutique n’est en rien innovante… la sur-médication poussée par le système est des plus dangereuses ». De plus si les antidépresseurs sont irremplaçables et gomment les symptômes de la dépression, ils ne guérissent pas. Ils ne redonnent pas une image valorisée de soi ni ne permettent une autonomie sociale.
Le courant sociologique, lui, nie la folie en soi. « Ce n’est pas l’individu qui est déviant mais la société qui est malade. » C’est le courant qui a donné naissance aussi bien à l’antipsychiatrie qu’aux thérapies familiales. Les groupes sociaux, les corps constitués représentent le Surmoi social qui engendrent avec l’individu des rapports de force c’est-à-dire d’inégalité dont l’individu conditionné peut se retrouver la victime. La victime est le malade fabriqué par le groupe, le malade désigné par le groupe, le fou. Sont convoqués Claude Lévi-Strauss et Michel Foucault qui ont pour l’un identifié les structures naturelles inconscientes des sociétés et pour l’autre découvert la nécessité pour une société de définir ce qui la limite, donc ce qui définit sa norme, donc ce qui lui est étranger. Donc le fou.
On peut interroger le caractère absolu de cette approche. Pour ma part, coincé dans le diagramme de Bourdieu entre le whisky et la salade, entre les échecs et le tennis, je ne savais pas le caractère inéluctable et définitif de mon conditionnement social. J’ai pu noter avec le temps qu’il était plus facile de se passer du tennis que de renoncer au whisky. À défaut de devenir fou, on pourra donc constater, malgré des tentatives à demi réussies d’affranchissement vis-à-vis des injonctions sociales, que les découvertes des sociologues et ethnologues ont bien une part de vérité.
Si Zarifian trouve beaucoup de limites et quelques vertus à chaque champ d’observation spécifique des maladies mentales, il sait se mouiller et ne verse pas dans le consensus mou. Il distribue les mauvais points mais le fait seulement après avoir examiné en détail le champ en question. « L’homme est un animal bio-psycho-social, vouloir séparer un des éléments du tripode est une faute grave ». En fait, plutôt que hiérarchiser les thérapies par mérite croissant, aux positions imprécatoires l’ouvrage oppose les positions pragmatiques. Mettre le malade au centre de tout et garder ce qui s’avère efficace, quelle que soit la méthode.
La vérité s’il y en a une est bien dans une psychothérapie indépendante de la méthode utilisée mais très dépendante de la personnalité du psychothérapeute : quelqu’un de proche de la détresse des autres, disponible, patient, tolérant, de bon sens… et compétent dans son domaine, quel qu’il soit. On pourrait finalement appliquer ce raisonnement à toutes les thérapies, avec profit ! L’auteur n’a peut-être pas été le premier ni le seul à examiner les grands courants explicatifs des troubles mentaux. Cet homme, ce psychiatre à la fois assumé et interrogatif se signale néanmoins par son intérêt pour l’exhaustivité et son choix délibéré de la largeur du champ d’observation.
Par sa pondération, l’expression scrupuleuse de ses doutes et de ses interrogations, son attention permanente au malade, Édouard Zarifian n’est-il pas au fonds le représentant d’un humanisme qu’on enterre à intervalle régulier mais qui revit sous la forme de ce qu’il est convenu d’appeler l’honnête homme ? Cet honnête homme qui ne prétend pas être Montaigne mais nous aide à trouver notre chemin par nous-même. Il n’excommunie pas, il ne tonne pas. Il écoute, il soupèse, il compare. Il ne trouve pas toujours mais il cherche. N’est-ce pas ainsi, pour quelque sujet qui nous préoccupe, que nous pouvons espérer entrevoir une vérité ? Alors, faut-il vouer toute la psychiatrie aux gémonies ? Jeter tous les psychiatres à la poubelle ? Allons ! Un peu d’adultitude, un peu d’altitude.
Mon père fut sauvé, ce sont ses propres mots, par le Dr Édouard Zarifian, son thérapeute, son médecin. Par sauvé, on entendra sauvé de la souffrance indicible, sauvé du suicide qui lui semblait — avant de comprendre son état et d’accepter un traitement psychiatrique — la seule porte de sortie de l’enfer de la dépression, vécu dès avant 40 ans. Mon père ne fut certes pas guéri définitivement, il resta dans un état dépressif latent tout le reste de sa vie. Il arriva cependant qu’elle lui soit douce. Mon père quitta ce monde en paix relative avec ce dernier comme avec lui-même, à l’âge respectable de 82 ans, en toute conscience.
Merci Docteur.
Éric Desordre