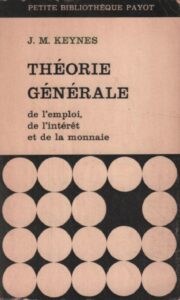 À quelques encablures de l’élection présidentielle, on peut supputer que l’économie devrait, comme à chaque échéance électorale nationale, nourrir programmes et débats et donner à ses experts l’occasion de nous asséner des cohortes de chiffres et de tendances pour l’avenir… et de tenter de nous convaincre de la fiabilité de leur travail. Pas gagné! Surtout si l’on évalue leur contribution à l’aune de la mission qu’ils sont censés assurer : analyser les faits économiques dans leurs dimensions financières, politiques, sociales et culturelles, afin de fournir des repères susceptibles de guider la décision par la compréhension du passé, la maîtrise du présent et l’anticipation de l’avenir, dans le respect de la rareté des ressources et dans la perspective d’une répartition équitable des richesses.
À quelques encablures de l’élection présidentielle, on peut supputer que l’économie devrait, comme à chaque échéance électorale nationale, nourrir programmes et débats et donner à ses experts l’occasion de nous asséner des cohortes de chiffres et de tendances pour l’avenir… et de tenter de nous convaincre de la fiabilité de leur travail. Pas gagné! Surtout si l’on évalue leur contribution à l’aune de la mission qu’ils sont censés assurer : analyser les faits économiques dans leurs dimensions financières, politiques, sociales et culturelles, afin de fournir des repères susceptibles de guider la décision par la compréhension du passé, la maîtrise du présent et l’anticipation de l’avenir, dans le respect de la rareté des ressources et dans la perspective d’une répartition équitable des richesses.
Lors du premier choc pétrolier, je me souviens d’avoir assisté à une conférence sur la conjoncture mondiale, à laquelle les béotiens en économie, très nombreux à l’époque, s’intéressaient de plus en plus. Au cours des travaux, un économiste de renom affirma que si le baril de pétrole atteignait le prix de 30 $, les économies du monde entier seraient en faillite. Ce diagnostic effarant résultait de la hausse brutale que le tarif (nominal) du baril venait de subir, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs, passant entre 1970 et 1973 d’un peu plus de 3 $ à presque 5 $ ; ce quasi-doublement en 3 ans, pour qui se souvient qu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale le baril se payait aux environs de 2 $, justifiait que l’on parle d’un «choc» et qu’on le craigne fatal. Il n’en fut rien, comme l’a montré la «résistance» relative des économies à la série de hausses qui ont propulsé les prix au-delà des 30 $ fatidiques, jusqu’à flirter avec les 90 $, comme ce fut le cas en 2008 et 2014.
Plus récemment, on a pu constater l’impuissance des économistes à anticiper la crise des «subprimes» de 2008. Il arriva également que les économistes du FMI (Fond Monétaire International) émissent de sérieux doutes sur ce qu’ils recommandaient hier : la libre circulation des capitaux et les politiques d’austérité… On attend toujours l’économiste qui sera capable de faire un bilan «neutre» de l’effet des 35 heures sur la création d’emplois et sortir ce thème des querelles récurrentes que droite et gauche se plaisent à entretenir…
Ces exemples de fourvoiements, que les économistes reconnaissent difficilement, illustrent la difficulté des experts à instruire la réalité et à anticiper l’avenir. La France en est une bonne illustration qui collectionne les Prix Nobel de la catégorie(1) et les tirages records de manuels consacrés à la chose économique(2), alors qu’elle peine à obtenir le niveau de performance de pays comparables.
Une influence croissante, mais une crédibilité contestée
La mondialisation et la libéralisation financière ont vu l’influence des économistes s’amplifier considérablement. Entre ceux qui parlent à l’oreille des gouvernements et des institutions et ceux qui galopent de plateaux de télévision en colloques pour répandre leur «bonne parole», ils sont nombreux à occuper les premiers rangs des experts de la marche du monde, d’où ils ont chassé au passage sociologues, historiens et autres philosophes. En dépit de cette influence et de cette visibilité, la crédibilité de la profession est régulièrement contestée. Cette remise en cause traverse même la famille des économistes et contribue à épaissir le brouillard qui altère la perception de leur action.
En 2010, plusieurs économistes(3), avaient signé un «Manifeste des économistes atterrés» dénonçant l’hégémonie de «l’analyse orthodoxe», celle qui recourt essentiellement aux mathématiques. En 2017, le débat resurgit avec la polémique qui opposa les «orthodoxes»(4), tenants d’une science économique «dure», à ceux qui militent pour une pensée économique pluridisciplinaire, plus «molle», intégrant davantage la complexité et l’irrationalité de «l’homo-œconomicus».
En s’intéressant à l’histoire de l’économie, on constate que ces affrontements théoriques couvaient dans l’œuf depuis fort longtemps. Pour les premiers économistes, la question de base était d’identifier les modes de création et de partage des richesses. Au Moyen Âge c’est la nature, et elle fait l’objet de prédations développées par les populations de «chasseurs-cueilleurs». Au fil des grandes avancées qui ponctuent l’histoire de l’humanité, la richesse se diversifie: développement du commerce entraîné par la découverte de nouveaux territoires, apparition de la monnaie papier rendue possible par l’invention de l’imprimerie… Au fur et à mesure que l’activité humaine s’étend au-delà de l’élevage et de la culture, les théoriciens élargissent leurs champs d’investigation à l’organisation du travail, à la relation entre l’offre et la demande, à la fiscalité, à la croissance, à la crise… Progressivement, à l’aide des mathématiques et de la statistique, s’élaborent les concepts qui deviendront les piliers de l’économie moderne.
Au tournant des années 70, cette emprise des sciences dites «exactes» est critiquée, notamment par ceux qui découvrent que le développement de la concurrence perturbe l’équilibre social. Ils appuient leurs positions sur le manque de fiabilité de l’information dont disposent les acteurs pour comprendre et anticiper les variations de l’activité et des comportements des consommateurs. Ils favorisent ainsi le passage de relais entre la macro-économie et la micro-économie. Ils ne nient pas l’utilité de la statistique, mais ils promeuvent la prise en compte de facteurs de pondération tels que l’histoire, le droit, la sociologie… Derrière ces évolutions, il apparaît que les économistes interviennent, plus ou moins ouvertement, sur des enjeux idéologiques, défendant pour les uns une économie administrée et planifiée, tandis que d’autres militent pour une économie ouverte et libérale.
Un débat ancien, loin d’être clos
Le débat, qui n’est donc pas nouveau, est loin d’être clos. Mais il justifie que l’on se rebelle contre les économistes. D’une part pour leurs «faillites» passées, d’autre part pour leurs difficultés patentes à maîtriser les perturbations générées par les diverses crises mondiales que ni le libéralisme ni le keynésianisme n’arrivent à endiguer. La première de ces perturbations résulte de l’attention croissante portée par les agents économiques à la dimension «sociétale» des affaires. L’exemple de VOLKSWAGEN en atteste qui, pour avoir falsifié des systèmes de contrôle de pollution de 11 millions de véhicules diesel aux États-Unis, perdit près de 40 % de son cours de bourse en 3 jours, sans compter les coûts de remise à niveau des véhicules défaillants, de compensation de la perte de valeur des véhicules concernés, des amendes issues des poursuites pénales, d’indemnisation des 22000 salariés dont le Groupe décida de supprimer les postes, sans parler des pertes induites de clients, et des dégâts d’image…
À cette tendance montante, il convient d’ajouter les impacts de la révolution numérique. «Elle bouscule les entreprises, l’emploi et la société entière. Elle estompe les frontières entre le loisir et le travail, le gratuit et le payant, l’amateur et le professionnel. Les outils traditionnels de mesure ont du mal à la capter.»(5) La digitalisation des échanges entraîne déjà plusieurs types de ruptures dont les effets sur l’économie sont difficiles à évaluer: quelle est la valeur d’une réponse quasi individualisée à la demande (offres d’AirBnb…), quelle est la valeur de la suppression des intermédiaires (livraisons d’Amazon…), quelle est la valeur de la tâche accomplie par l’acheteur, souvent bénévolement (attribution des notes de TripAdvisor…) Le repère du «prix du marché» vacille, surtout si l’on considère que la diffusion d’un service numérique est quasi-gratuite.
Les nouveaux modèles économiques («business models») qui découlent de ces ruptures remettent profondément en cause les fondamentaux de la statistique: «l’expérience client vantée par les champions du marketing est plus difficile à jauger qu’un kilo de pommes de terre» moque Charlie BEAN, ancien Économiste en chef de la Banque d’Angleterre.
De même, la finance se trouve fragilisée par les nouveaux risques que font courir les pirates de la sphère numérique. Le cas de VINCI illustre ce danger; en 2016, la valorisation boursière du géant du BTP fondit de 7 milliards € en quelques minutes, suite à la publication d’un faux communiqué annonçant le licenciement du Directeur financier de l’entreprise convaincu d’importantes erreurs comptables.
La première des victimes de ces évolutions risque bien d’être le sacro-saint PIB (Produit Intérieur Brut), totem des références de la mesure de l’activité et du développement économique. Il apparaît aux États-Unis lors de la dépression des années 30 et sert à évaluer les effets de la crise et les ressources nécessaires à l’effort de guerre, puis à la reconstruction des pays impliqués. À partir de données physiques – tonnes de céréales, nombre de logements, kilomètres d’avion parcourus… – les statisticiens calculent la valeur de la production d’un pays. Au fil de la sophistication de l’activité économique, ils ajoutent progressivement à leurs formules des données plus dynamiques, liées par exemple à la réduction de la consommation des moteurs ou à l’amélioration des performances de certaines machines. Mais, sous les coups de boutoirs des crises, le dispositif montre ses limites. Les critiques sont nombreuses. La plus récurrente pointe que le PIB n’intègre pas suffisamment de données «qualitatives», celles concernant l’éducation, la formation, la santé, le bien-être… alors qu’elles ont de plus en plus d’impact sur la valeur des économies. Andrew McAFEE, Co-Directeur de «L’initiative MIT sur l’économie numérique», pose par exemple la question: «Où est Wikipédia dans le PIB?». D’autres critiques portent sur la fiabilité du PIB en démontrant qu’il peut être manipulé; en effet, il évalue la richesse d’un pays à partir de sa production et non de ses ventes; en stimulant la production, un pays peut donc gonfler ses stocks et faire apparaître une richesse «virtuelle», qui ne se réalisera que lorsque ces excédents de production seront vendus. Enfin, certains objectent que le PIB est incapable de mesurer l’impact des économies souterraines, informelles, mafieuses, des diverses formes de trafics, qui pourtant prolifèrent.
Ces contestations ont entraîné une demande de remplacement du PIB par un BNB (Bonheur National Brut) prenant en compte non seulement des indices du développement économique, mais des références sur l’état de la culture, de l’environnement et de la gouvernance des pays. En 2013, la très sérieuse ONU va jusqu’à commanditer un classement des pays en fonction de leur BNB, qui place le Danemark en tête, devant la Norvège, et la Suisse, la France occupant le 21e rang.
Des défis de taille
Ce contexte confronte les économistes à un large questionnement. Quel est l’économiste qui a pu prédire qu’un des plus performants mastodontes mondiaux du secteur automobile serait mis en péril par la prise en compte de sa «responsabilité sociétale»? Quel est celui qui est capable de mesurer l’impact des nouveaux critères de décision des acteurs économiques, du citoyen-consommateur à l’investisseur, que sont le respect de l’environnement, de l’égalité, de la parité, de la mixité? Quel sera l’économiste qui pourra évaluer les risques multiformes portés par la numérisation galopante de l’économie? On voit bien qu’aux motifs de se rebeller contre les fourvoiements passés des économistes, viennent s’ajouter ceux qui découlent de leurs difficultés à maîtriser les changements en cours et à venir, conduisant les plus sévères des observateurs à se demander si «les économistes peuvent encore se rendre utiles ?»(6).
Les défis sont de taille et les réponses à apporter ne coulent pas de source. Faut-il s’émanciper des chiffres ? Faut-il se distancier des idéologies ? Quelles méthodes, quels outils, quelles données
pour mesurer le changement ?… Le maquis de la «littérature économique» foisonne d’éléments de réponse. Bernard MARIS (7) écrivait en 2017 que «les lois établies par les économistes des XIXème et XXème siècles ont été invalidées et il n’en est plus d’applicables au plan mondial». Claude MOUCHOT (8) pose quant à lui que «l’économie ne sera jamais «science normale» ; l’unification des théories économiques ne se réalisera jamais, au moins dans une société démocratique; il faut abandonner la référence à la physique et déterminer à nouveau frais le statut épistémologique de notre discipline».
Jacques GENEREUX, membre des «Économistes atterrés» ajoute que «le fait est qu’une large partie de nos élites intellectuelles soutient des raisonnements économiques parfaitement absurdes. À partir de là, soit vous supposez qu’ils sont tous des hypocrites qui soutiennent à dessein de faux raisonnements pour manipuler l’opinion, soit, comme je le fais, vous prenez plus au sérieux l’hypothèse qu’ils croient vraiment aux bêtises qu’ils racontent. Même des prix Nobel peuvent s’entêter dans l’erreur. Par conséquent, il nous faut comprendre la bêtise des intelligents» (9).
John Maynard KEYNES, l’un des papes des économistes, proposait : «le parfait économiste doit posséder une rare combinaison d’expertises. Il doit atteindre un niveau élevé, dans plusieurs disciplines différentes et doit combiner des talents qui ne sont pas souvent détenus par une même personne. Il doit être mathématicien, historien, homme d’État, philosophe. Il doit étudier le présent à la lumière, du passé pour les besoins de l’avenir»(10). Cette sagesse explique sans doute que Daniel COHEN, Directeur du Département d’économie de l’École Normale Supérieure, ait suggéré «qu’un nouveau KEYNES ne serait pas de trop»(11).
Quoi qu’il en soit, il est urgent que le travail de l’économiste retrouve un peu de son sens perdu, en contribuant plus vaillamment à la lutte contre l’explosion des inégalités et à la redistribution de la prospérité et de l’harmonie sociale.
1. Le «Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel » dit «Prix Nobel d’économie » a été remis à 4 reprises à des français: 1983, 1988, 2014 et 2019.
2. « Le Capital au XXème siècle » de Thomas Piketty paru en 2013 aux Éditions du Seuil, a été vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde, « record quasi-absolu» pour un essai volumineux de ce type.
3. Philippe Askénazy, André Orléan, Henri Sterdyniak et Thomas Coutrot.
4. Cahuc et Zylberberg http://www.lesechos.fr/idees-debats/ livres/0211265259999-le-pamphlet-qui-relance-la-guerre-entre-economistes-2026035.php?Bqd4JjBeuM0fe2JH.99.
5. «Une économie de plus en plus difficile à mesurer » Les Échos, 18.02.16.
6. Le Nouvel Économiste, Philippe PLASSART.
7. Les limites des théories en économie in Pour la science, juin 2007, extraits.
8. Professeur émérite d’épistémologie économique à l’Université Lumière Lyon 2
9. «Stop à l’ânerie économique », Libération, 30.11.16, Jacques Généreux est auteur de La Déconnomie, Jacques Généreux, Éditions le Seuil, 2016
10. «Alfred Marshall, 1842-1924 », The Economic Journal, 1924
11. Le Monde, 9.10.16




