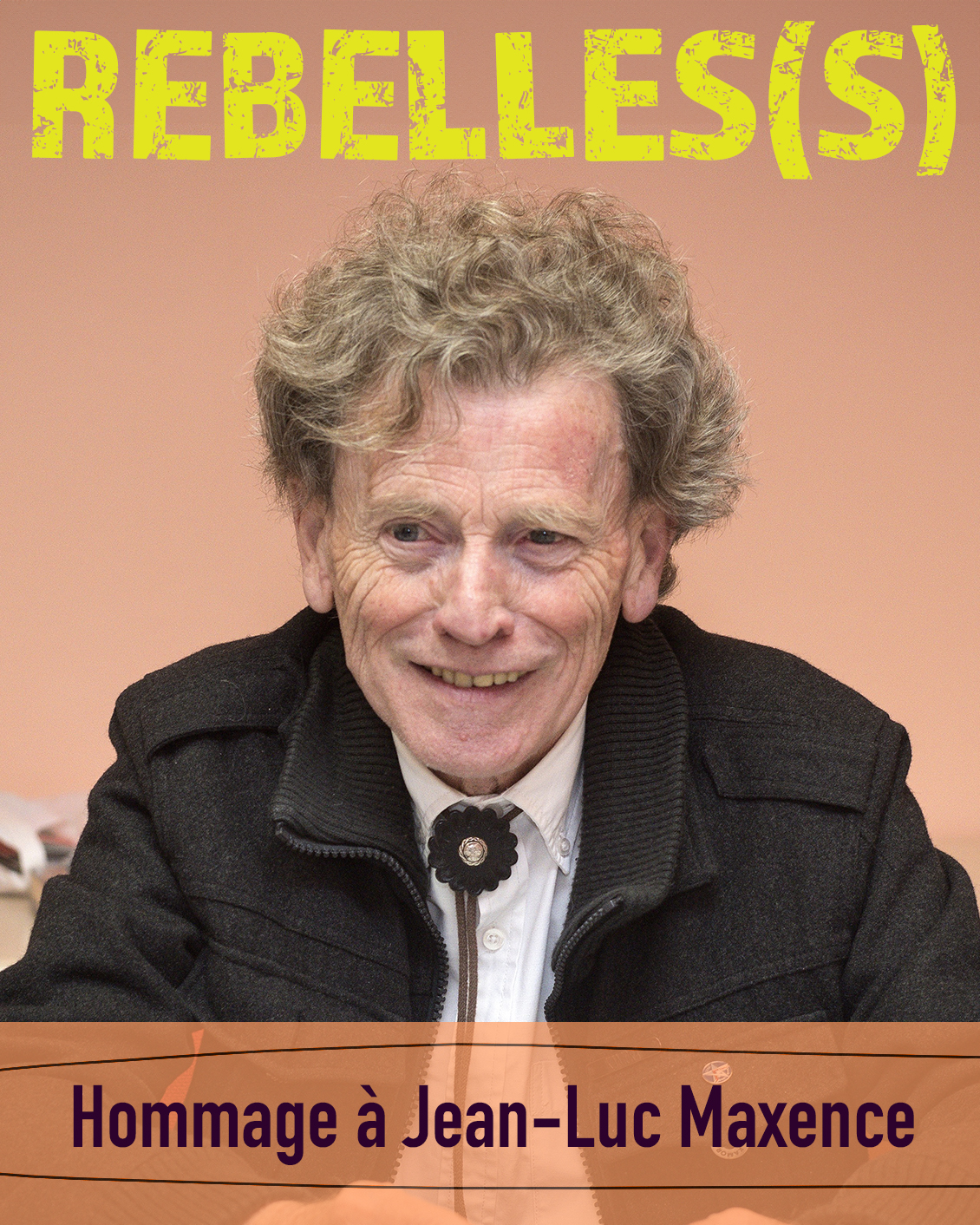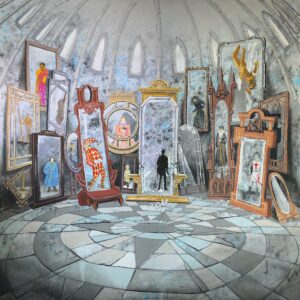
Publié dans Rebelle(s) N°25
« Je crois qu’il n’y a pas de différence entre les gens d’autrefois et ceux qui viennent de naitre ; ils sont réincarnés. Je crois que je suis Ève. J’adore les pommes et personne n’est jamais d’accord avec moi. » Ce sont les mots que l’irlandais Bernard Shaw met dans la bouche de la jeune Savvy dans sa pièce En remontant à Mathusalem. Réincarné ou pas réincarné ? Là est la question. La réponse, elle, n’est pas des plus aisées. Certains diront qu’ils se rappellent leurs incarnations passées. De ceux-là, d’autres diront qu’ils s’illusionnent, voire qu’ils sont fous. Mais le fou, c’est toujours l’autre. Celui qui pense trop minoritairement pour qu’on soit d’accord avec lui. Ainsi, là où les tenant de la réincarnation sont majoritaires, le fou est-il celui qui pense qu’on ne vit qu’une fois.
Qu’en disent les différents courants de pensée, religieux ou philosophiques, qui ont marqué la question depuis trois ou quatre mille ans ? C’est un exercice difficile que d’en faire un tour d’horizon, tant les positions sont diverses, les courants variés et les interprétations légions. Certains diraient qu’il nous faudra naviguer entre ces différents courants, d’autre qu’on s’y noierait, je vais tenter humblement d’y nager : c’est la réincar-natation, sport délicat voire dangereux.
Résurrection versus réincarnation
Entendons-nous bien, tous ceux qui pensent que l’âme est immortelle ne croient pas en la réincarnation. Les chrétiens « mainstream » d’aujourd’hui, qu’ils soient catholiques, protestants ou même témoins de Jéhovah, croient majoritairement (ou doctrinalement) en la résurrection, concept tout à fait différent de la réincarnation. La résurrection des morts, pour simplifier, c’est le fait de revenir à la vie après la mort, mais corps et âme. Cela se produira à la fin des temps, avant le jugement dernier, et il n’est pas question de butiner de corps en corps, vie après vie. Laissons donc la résurrection de côté, et posons-nous la question de la réincarnation dans le christianisme.
C’est Origène, l’un des Pères de l’Église, qui est souvent cité comme un théologien favorable à la croyance en la réincarnation. Dans son traité contre Celse (un païen !), il écrivait : « N’est-il pas conforme à la raison que chaque âme soit introduite dans un corps en fonction de ses mérites et de ses actions antérieurs ? N’est-il pas logique que les âmes dont le corps a servi à faire le bien aient ensuite droit à des corps qualitativement supérieurs aux autres. » Certains diront qu’on parle bien là de réincarnation. D’autres réfuteront l’idée qu’un Père de l’Église put même y croire : querelles idéologiques sans fin, encore d’actualité aujourd’hui, 1800 ans plus tard. Mais au-delà d’Origène, de nombreux courants chrétiens, ou christiques comme certains les appellent, ont cru et croient à la réincarnation. Le courant des gnostiques chrétiens, par exemple, dont les textes sont surtout connus depuis la découverte en 1945 de la bibliothèque de Nag Hammadi, en Egypte, considéraient que nous sommes des âmes d’origine divine, emprisonnées dans des corps, appelées à renaître encore et encore dans un but de perfection et de libération. Les gnostiques, dont le christianisme semble avoir été grandement influencé par les platoniciens, ont beau compter parmi eux de grands personnages de ce qu’on appelle le christianisme primitif (1er et 2e siècle de notre ère), ils furent considérés comme hérétiques par une grande partie de l’orthodoxie chrétienne.
Les Grecs et les Romains
On dit que nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, mais on ne peut pour autant nier l’influence de l’antiquité gréco-romaine sur notre manière de penser. Et chez les Grecs et les Romains, nous sommes nombreux à croire à la réincarnation. Dans Menon, Platon écrit « Il est dit que l’âme de l’homme est immortelle, et que tantôt elle quitte la vie – ce qu’on appelle mourir – tantôt elle y revient, mais qu’elle n’est jamais détruite ; il faut donc pour cette raison mener sa vie le plus pieusement possible. » Il est loin d’être le seul à poser le postulat de la réincarnation. Empédocle lui, traite ceux qui n’y croient pas de « Fous — car ils n’ont pas de pensées étendues — qui s’imaginent que ce qui n’était pas auparavant vient à l’existence, ou que quelque chose peut périr et être entièrement détruit. Car il ne se peut pas que rien puisse naître de ce qui n’existe en aucune manière, et il est impossible et inouï que ce qui est doive périr. » Cicéron parle des vies antérieures comme d’une évidence et renvoie à Pythagore, l’homme du fameux théorème mathématique, qui lui aussi enseigne la réincarnation, et qui était, d’après la légende, un initié des Mystères grecs, dont Orphée, fils d’un roi et d’une muse, est la mythique source.
A Rome, Plotin par exemple, enseignait que : « Quel homme sensé, après avoir considéré ainsi la nature de l’âme, pourrait encore douter de l’immortalité d’un principe qui ne tient la vie que de lui-même et qui ne peut la perdre? » Il considérait nous étions une âme réincarnée, distincte du corps et amenée à se libérer, ou pas, du piège de la vie des sens. Avant lui, avant eux, à quelques brasses de là, les Indiens…
L’Inde
Lorsqu’on évoque la réincarnation, la première image qui nous vient à l’esprit est souvent liée à l’Inde et à ses myriades de sectes religieuses (j’emploie ici le mot secte sans connotation péjorative). Car oui, en Inde, la minorité, c’est celle qui ne croit pas à la réincarnation. D’ailleurs, celui qui n’y croit pas peut être facilement considéré comme un amnésique… S’il semble que les premiers textes des Védas (les hymnes de l’hindouisme qui furent composés il y a au moins 3500 ans) ne soient pas très clairs sur le sujet de la réincarnation, dès les Upanishad (un peu plus récents) la messe est dite : nous sommes des âmes qui nous réincarnons de corps en corps, de vie en vie, et la voie de sortie passe par une pratique assidue du Yoga (ou d’un yoga, car il en existe de nombreuses formes). La réincarnation passe parfois par un système complexe qui comprend des voyages sur la lune (en tant qu’âme, pas avec une fusée), des réincarnations dans des formes de vie animales ou végétales, voire dans des formes éthérées supérieures, le tout étant lié au Karma, bon ou mauvais, accumulé au cours des vies successives. Dans la Baghavad-Gita, qui semble avoir été écrit quelques centaines d’années avant l’an 0 (les avis divergent), Krishna s’adresse au guerrier Arjuna lorsqu’il faiblit à l’idée de devoir combattre ses ennemis, car ceux-ci sont de sa propre famille. Pour faire simple, il lui remonte les bretelles, et lui rappelle que quoi qu’il fasse, il ne pourra tuer l’âme immortelle de ses adversaires. Et au diable leurs corps : « Ainsi que le seigneur de cette dépouille mortelle y éprouve tour à tour l’enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même les éprouvera-t-il dans les incarnations futures. Celui qui est convaincu de cette vérité ne peut jamais être troublé, quoi qu’il lui arrive. »
Le jainisme, autre religion de l’Inde que l’on connait surtout à travers ses ascètes se déplaçant avec un masque pour ne pas avaler d’insectes (ce serait un meurtre) et balayant devant eux pour ne pas en écraser (mais en réalité, nombres de jaïns ne sont pas aussi zélés dans leur pratique), croit aussi à la doctrine de la réincarnation. L’objectif des réincarnations successives pour le jaïn, est comme pour le bouddhiste (nous y arrivons), la fin du cycle des naissances et des morts. C’est par la méditation que le jaïn y parvient et par la conduite éthique, toutes deux brulant le karma qui maintient l’être dans ce cycle.
Le bouddhisme est une question délicate. Si pour de nombreux bouddhistes la réincarnation est une affaire entendue, il existe un interminable débat intellectuel ou spirituel sur la nature des enseignements du Bouddha sur le sujet. Les textes appelés Jakata, dont l’orthodoxie est parfois contestée selon les courants (il n’existe pas un mais de nombreux bouddhismes), racontent les vies antérieures du Bouddha. Ce dernier est censé se les être rappelées sous l’arbre de la Bodhi, où il a atteint l’illumination. Mais le Bouddha a aussi développé la doctrine de l’anatman (le « non-soi ») par opposition à celle de l’atman (le « soi ») hindou. Et là, toutes les interprétations existent. Certains diront que cela signifie que rien ne persiste, et donc pas même un « soi » qui passerait de corps en corps, d’autres disent que cette théorie signifie en fait que les attributs de l’égo sont une illusion, et que cela ne remet pas en cause l’immortalité d’un soi qui n’a pas d’existence égotique, et ainsi de suite. Pourtant, en Orient, les bouddhistes sont majoritairement convaincus de vivre de nombreuses vies successives.
Le taoïsme
C’est d’ailleurs un bouddhiste zen bien connu, D.T. Suzuki, qui dans son introduction aux œuvres de Tchouang Tseu, l’une des grandes figures du taoïsme, interprétait la doctrine des fagots et du feu comme suit : « les fagots sont censés représenter le corps, et le feu, l’esprit qui l’anime. Le corps meurt et disparait comme les fagots sont dévorés par le feu. Mais le feu peut se transmettre à d’autres fagots et c’est ainsi que l’esprit peut transmigrer et exister encore ailleurs. »
Lao Tseu, dont Tchouang Tseu était le disciple, n’a pas semblé réellement se préoccuper de l’existence ou non de la réincarnation. Certes il a écrit dans le Tao-Te-King : « Le Divin atteint, il est uni au Tao et se trouve au-delà des périls. Rien ne peut le surprendre. Rien ne peut l’émouvoir. Rien ne peut le toucher, pas même la mort (…) La vie est la porte de la mort, la mort est celle de la vie », mais les avis sont partagés sur la question. Doit-on en conclure qu’il croyait à la réincarnation ? Je laisse chacun s’emplir de la sagesse du maître et, s’il y arrive, se faire son propre avis. Moi, je nage déjà en direction de l’ancêtre du christianisme…
Le judaïsme
Dans le judaïsme, il nous faut nous tourner vers les grands mystiques juifs pour trouver des références à la réincarnation. Le Zohar, grand livre de la Cabbale (mystique juive) est assez clair sur la question : « Aussi longtemps qu’une personne ne parvient pas à atteindre ses objectifs dans ce monde, le Saint, Béni soit-Il, la déracine et la replante autant de fois qu’il faut. (…) Toutes les âmes sont sujettes à la réincarnation; nul ne connaît les voies du Saint, Béni soit-Il! Les gens ne savent pas qu’ils sont présentés devant le tribunal avant d’entrer dans ce monde et une fois qu’ils l’ont quitté; ils ignorent qu’ils doivent subir beaucoup de réincarnations et de travaux secrets et que, complètement dépouillés, de nombreuses âmes et une infinité d’esprits errent dans l’au-delà sans pouvoir pénétrer sous le voile du Palais du Roi. » Au XVIIe siècle, le rabbin portugais Menasseh ben Israel a écrit Nishmat Hayyim, un ouvrage contenant une explication complète sur la réincarnation. Le « Guilgoul haNeshamot » (le cycle des âmes, la réincarnation) avait déjà été entièrement traité par le rabbin Isaac Ashkenazi Louria au XVIe siècle, dans son enseignement (qu’on connait grâce aux compilations de l’un de ses disciples). De nombreux juifs hassidiques croient aussi aux vies antérieures. Le fondateur du judaïsme hassidique lui-même, Ba´al Shém Tôv, pensait être le « Gilgoul » de Saadia Gaon, célèbre rabbin du 10e siècle.
L’islam
C’est aussi chez les mystiques qu’il faut chercher si l’on veut découvrir la croyance des musulmans en la réincarnation. De nombreuses branches du soufisme croient en l’immortalité de l’âme et ses incarnations successives. Certains voient même dans certains vers du grand poète soufi Rumi la reconnaissance de la transmigration de l’âme. « Sache que l’Âme est la source, et toutes les choses créées, des ruisseaux. Tant que demeure la Source, s’écoulent les ruisseaux. Chasse le chagrin de ton esprit, bois l’eau de ce ruisseau; Ne crains pas que l’eau tarisse, car elle est sans fin… » Ainsi poétisait-il. Nasafi, maitre soufi iranien du 13e siècle, écrivait à propos de la réincarnation : « c’est là une doctrine immémoriale qui a cours depuis des milliers et des milliers d’années parmi les hommes ». Mais pour lui, « l’âme individuelle prend successivement la forme du végétal, celle de l’animal et celle de l’homme ».
Plusieurs courants de l’islam, ou plus ou moins issus de l’islam ont aussi conservé cette croyance en la transmigration des âmes. C’est par exemple le cas des druzes, qu’ils soient du Liban ou d’Israël ou d’ailleurs. Leur doctrine (que certains considèrent être une branche de l’ismaélisme, elle-même une branche du chiisme, tandis que les druzes trouvent cette idée réductrice) est secrète, mais quiconque rencontre un druze peut le lui demander directement et obtenir une réponse claire : Les druzes croient en la réincarnation et savent qu’ils ont vécu d’innombrables vies auparavant et en vivront de nombreuses après celle-ci. C’est aussi le cas des yézidis, des alévis et d’autres courants du Moyen-Orient.
La scientology
Plus près de nous, dans des eaux moins antiques, la scientology elle-aussi considère les vies passées et futures comme un fait. Dans le corpus scientologue, l’être, c’est-à-dire le « je », vous, moi, est un esprit dont les caractéristiques sont les suivantes : il n’est ni matière, ni énergie, ni temps, ni espace, mais a la faculté de créer et de percevoir, il est une « unité consciente de conscience ». De là découle la vie. Cet être (vous, moi), est immortel et se réincarne (même si le terme « réincarner n’est pas employé) de corps en corps, de vies en vie. C’est en augmentant son aptitude à communiquer, à éprouver de l’affinité et à être en accord où désaccord avec l’univers matériel et tout univers, ce qui revient à augmenter sa faculté de compréhension, qu’il se libère de ce cycle que les bouddhistes appelaient le cycle des renaissances et des morts.
Pour conclure
J’ai prétendu nager, j’ai survolé. Chacune de ces religions ou philosophies mériteraient bien plus qu’un léger survol de circonstance. Et en survolant, je risque à la fois de fâcher ceux qui trouveront que mon approche est réductrice, ceux qui m’en voudront de ne pas avoir parlé d’eux, et ceux qui m’accuseront d’une interprétation erronée. Et il est bien possible qu’ils aient tous raison. Mais il est intéressant de noter que la considération que l’on ne vit qu’une fois n’est pas forcément majoritaire dans les croyances, les pensées et les visions de l’humanité. Et elle n’est pas aussi l’apanage de l’athée. En effet, finalement l’orthodoxie chrétienne, qu’elle soit réellement orthodoxe, catholique, protestante ou mormone, ne croit pas en des vies successives sur cette terre : on y vit qu’une fois. Le reste de la vie éternelle se passera au ciel, ou en enfer. A l’inverse, ils sont nombreux nos semblables à penser qu’ils sont déjà venus, et qu’ils reviendront. Il est bien probable que le plus important soit pourtant de s’entraider ici et maintenant, quelles que soient nos croyances. Comme le disait le Bouddha : « Une seule bougie peut en allumer des milliers, et la durée de vie de la bougie n’en sera pas écourtée. Le bonheur n’est jamais diminué du fait d’être partagé. »