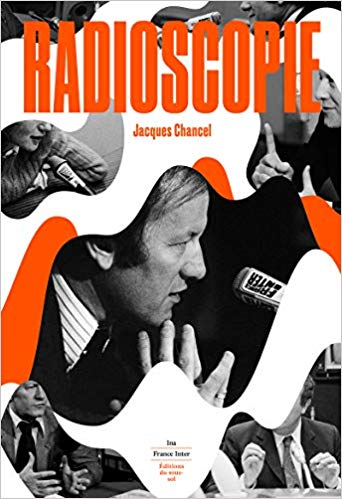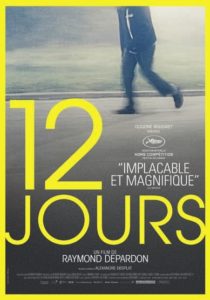
Le film 12 jours est sorti en 2017. Raymond Depardon a déjà tourné à plusieurs reprises dans les hôpitaux psychiatriques, y réalisant deux premiers grands documentaires, San Clemente en 1980 et Urgences en 1987. Avec 12 jours, ces documentaires représentent la part la plus déchirante de l’œuvre du cinéaste. Hôpital de San Clemente à Venise, Hôtel Dieu de Paris, centre hospitalier de Bron. Cette « trilogie de la psychiatrie » est une plongée secouante dans le quotidien des malades et du personnel soignant. Violence des dialogues, des situations, des rapports de force. Écoute aussi, compréhension, persuasion. Aucun malade n’est suivi par le documentariste pendant toute son hospitalisation, ce serait trop long. L’équipe de tournage reste en moyenne un mois et demi sur place. Bien trop court pour voir les guérisons, s’il y en a, bien trop court pour savoir finalement si ces personnes blessées de l’âme arrivent à s’en sortir.
Depuis la loi du 27 septembre 2013, les patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques doivent être présentés à un juge des libertés et de la détention avant 12 jours puis tous les six mois si nécessaire.
Centre hospitalier Le Vinatier de Bron, près de Lyon. Un long plan séquence nous met lentement dans l’ambiance, la caméra nous promène dans des couloirs presque vides. La scène suivante se répétera une dizaine de fois tout le long du film : le juge des libertés, le patient interné, son avocat. Ils sont assis de part et d’autre d’une table. On entend sans le voir un greffier taper les minutes de l’audience. Champ-contre-champ, chacun prend la parole, dans l’ordre le juge, le patient, l’avocat. Assis derrière, flous, des costauds en blouse blanche. Spectateur, on ne se dit pas « tiens, ce sont les prisonniers d’un système terrifiant », on assiste à une mise à nu de la douleur.
On apprend au cours de l’entretien les agressions morales ou physiques subies ou perpétrées, les tentatives de suicide, le meurtre. À chaque audience, la première tension ressentie est physique : c’est l’extrême attention que chaque patient porte à l’exposé liminaire du juge qui indique la recommandation que le médecin psychiatre vient de faire quant à leur possibilité de sortie de l’hôpital.
Les juges ont une plus ou moins grande empathie. Ils disent d’abord le Droit. C’est leur boulot, ils ne sont pas médecins, ne commentent pas les diagnostics, vérifient seulement la présence de ceux-ci dans le dossier. Les avocats donnent leur avis sur la régularité de la procédure : les médecins qui sont exclus de l’audience sont tenus de justifier les mesures prises de restriction des libertés à l’encontre des malades. Aucune des sept audiences filmées ne se conclura par la « remise en liberté » des patients.
Le documentaire n’est pas à charge ou à décharge de l’institution, hospitalière ou judiciaire. Il est difficile de se faire une opinion si tant est qu’il soit nécessaire de s’en faire une. L’immense empathie qui ressort du film vient du regard du cinéaste, de l’ensemble des images, chacune neutre et sans pathos, mais qui cumulées et montées sans effet nous émeuvent infiniment. Interrogé sur son film, Depardon dit : « Le monde psychiatrique est un autre regard sur la ville. » Il explique qu’on apprend beaucoup de choses en écoutant les infirmiers, les internes. Un matin, ils disent « Hou la la, il fait très beau, on va avoir plein de suicidés ». Car ce ne sont pas les jours de pluie mais au contraire lors de week-ends d’été — plein soleil — que les gens tentent d’en finir. « On sent tous que ça pourrait être nous, on sait qu’on est aussi en bordure. Dans un hôpital psychiatrique, on s’y voit.
« C’est un autoportrait… J’espère qu’on ne juge pas les gens, on a une opinion, mais ces gens souffrent et on ne sait pas quoi faire… Il faut les écouter. Les psychiatres n’ont pas beaucoup d’écoute, ils ont tellement à faire… » Dans un sourire étonné, l’auteur nous apprend que l’équipe médicale lui a confié que le tournage les avait aidés à s’améliorer, à s’apercevoir qu’ils pouvaient mieux écouter. « Ça se passe bien quand vous êtes là, on va vous regretter ».
Éric Desordre