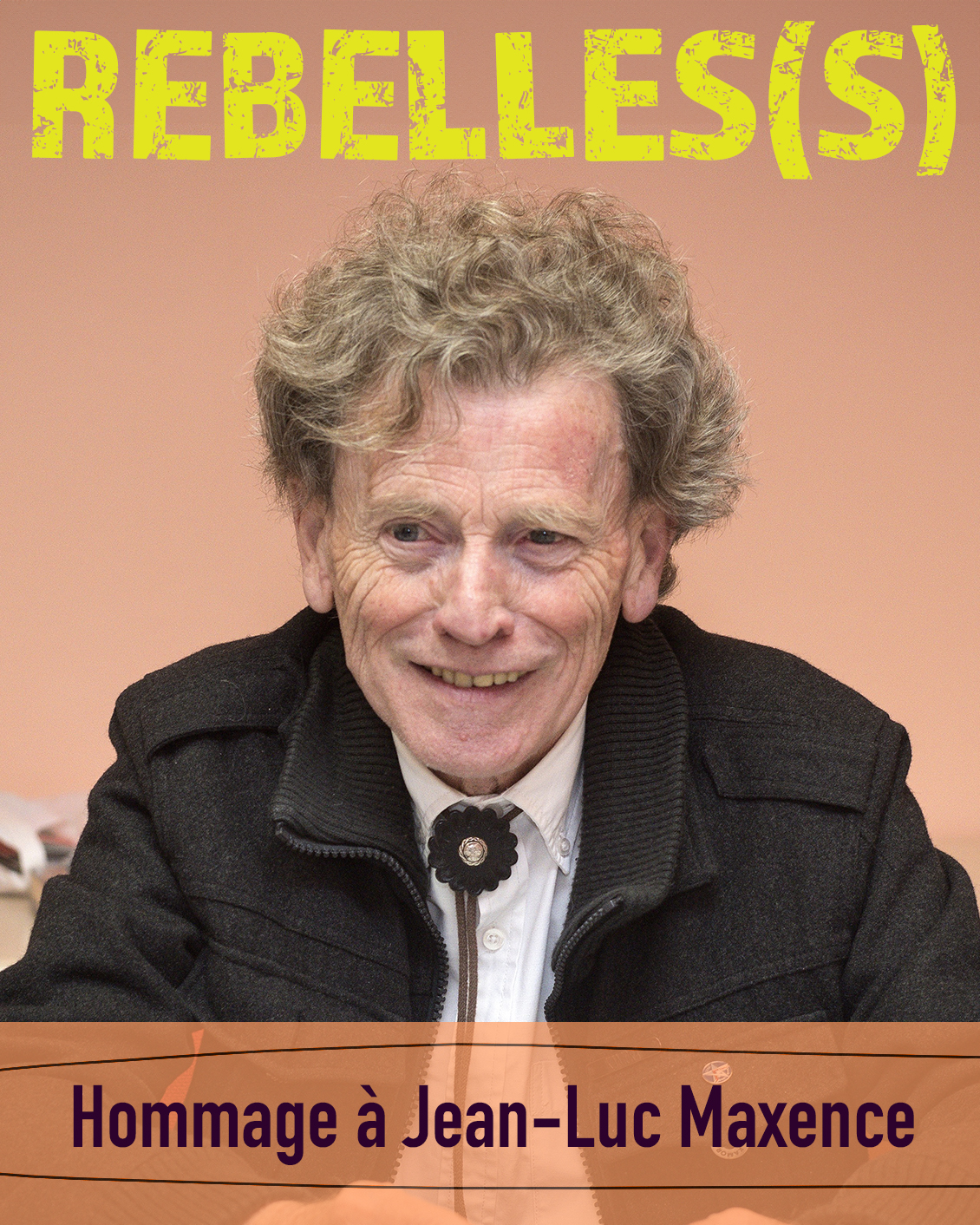L’article ci-après rédigé pour la revue La GRAPPE (n°107) est né de la relecture de l’essai de Czeslaw Milosz (1911-2004) : La Pensée captive. Alors que j’étais en train de feuilleter l’édition Folio Essais de 1953, je tombe sur une des pages finales du livre, page 308. Je l’avais survolée il y a une quinzaine d’années sans m’y arrêter, mais cette fois le mot UKRAINE me saute aux yeux.
En 1940 l’auteur fuyant l’envahisseur allemand échoue dans une gare d’Ukraine où s’entasse une foule chaotique. Témoin accablé, il réussit à nous décrire l’ambiance effroyable de cette gare, et malgré le vertige qui le saisit devant une tragédie annoncée, il découvre soudain une famille humaine. Il nomme ainsi l’ultime espoir qu’elle symbolise à ses yeux, qui lui communique une bouleversante émotion, et que tel un messager revenu de l’enfer, il veut nous faire partager en quelques lignes inoubliables.
Dans le sombre contexte que nous vivons, le message de Czeslaw Milosz m’a atteint, m’a étreint. Ayant obtenu l’autorisation de sa publication par les éditions Galimard, j’ai voulu m’approcher de cette famille humaine que le poète a célébrée toute sa vie durant, et au gré de mes relectures, faire partager la méditation qu’elles m’inspirent…
Jean-Jacques Guéant, décembre 2023
Czeslaw Milosz à Odessa -1940
Au commencement de la deuxième guerre mondiale, dans le chaos de la fuite devant les Allemands, il m’est arrivé d’être pendant quelques jours en Union soviétique. J’attendais le train dans la gare d’une des plus grandes villes de l’Ukraine. C’était un bâtiment immense. Les murs étaient couverts de portraits et de bannières d’une laideur indescriptible. La foule épaisse, couverte de peaux de mouton, d’uniformes, de bonnets de feutre à oreilles et de châles, remplissait chaque espace libre et écrasait sous ses pieds une couche de boue qui cachait le sol. Les escaliers de marbre étaient plein de miséreux endormis ; à travers leurs haillons on voyait leurs jambes nues, et il gelait. Au-dessus d’eux les haut-parleurs mugissaient leurs slogans de propagande. En passant, je me suis arrêté frappé par quelque chose. Contre le mur il y avait une famille de paysans : le mari, la femme et deux gosses. Ils étaient assis sur des paniers et des ballots. La femme nourrissait son petit. Le mari, au visage noirci, ridé, avec des moustaches noires tombantes, versait du thé dans un gobelet à l’aîné. Ils parlaient entre eux, à voix basse, en polonais. Je les ai regardés longtemps, et soudain j’ai senti des larmes sur mes joues. Qu’ils aient attiré mon attention dans la foule et provoqué en moi cette émotion violente venait de ce qu’ils étaient tellement autres. C’était une famille humaine, comme une île dans cette foule à laquelle manquait ce qui fait la vie quotidienne des hommes. Le geste de la main versant du thé, la façon délicate, attentive, de tendre le gobelet à l’enfant, les mots d’affection que j’ai devinés aux mouvements des lèvres plutôt qu’entendus, leur isolement à tous quatre, leur vie privée dans la foule, voilà ce qui m’a bouleversé. J’ai compris alors quelque chose qui échappa aussitôt à l’étreinte de mon esprit.
Czeslaw Milosz In La pensée captive © Éditions Gallimard, 1953, Autorisation n°12365
Une famille humaine au cœur des ténèbres
Cette page m’obsède. Je continue de la lire, de la relire, car elle me plonge dans l’antichambre de nos guerres actuelles, nos tragédies du XXIe siècle, où la haine sans limite enfle entre les hommes. J’exagère ? Je n’en suis pas sûr. Il y a certes des femmes des hommes bienveillants, et nous en connaissons tous, lucides, utopistes, qui nourrissent l’espoir d’atteindre ou d’habiter un monde pacifié avec leurs enfants. Mais convenons-en, nous vivons actuellement comme l’écrivain Milosz, dans le hall symbolique d’une gare gigantesque, anxieuse salle d’attente où s’affichent les désastres annoncés…
Si ce sentiment me gagne, se propage peut-être, c’est que les désordres du monde ne cessent de s’accumuler au vu de tous. Nos voisins, nos connaissances diverses avec ou sans l’appui des réseaux sociaux, nous alertent des graves dérives, sans pour autant vouloir nous décourager de vivre, au contraire… Mais comment vivre ou survivre en humanité ?
C’est la question que le poète polonais Czeslaw Milosz s’est posée dès 1940 au milieu d’une vaste débâcle (1). Il avait atteint l’âge de trente ans et le ghetto de Varsovie était déclaré « zone de contagion ». Il n’oubliera jamais ces moments décisifs, et publie La Pensée captive en 1953 un essai pionner, l’une de ses œuvres les plus connues qui décrit la place des dissidents au sein des « logocraties populaires ». Il obtient alors l’asile politique en France, s’établit à Brie-Comte-Robert (77). Mais après dix années d’accueil glacial – la gauche d’alors n’aime pas les dissidents -, il s’installe aux États-Unis où vingt-ans plus tard il obtient le prix Nobel de littérature en 1980. La page ci-contre figure à la fin de La Pensée captive, signal d’alarme lancé au milieu de la guerre froide.
Le temps des impostures…
Milosz, écrivain polonais qui parle français, anglais et russe, a été le grand témoin de ces fulgurants temps de dérive. Son poème à propos d’un printemps de Varsovie fera date, tandis que le souvenir de la sinistre gare d’Ukraine le poursuit inlassablement. Milosz avoue être un poète “catastrophiste” et s’en explique au fil de ses nombreux ouvrages. Loin de lui l’idée de s’afficher comme un dandy condamnant la noirceur du monde et s’en accommodant au quotidien. Mais résistant, exilé exceptionnel, après avoir traversé le régime nazi, le régime communiste et le régime libéral, il se permet de dénoncer ce qu’il appelle les impostures du XXème siècle.
Il interroge sans concession la vision scientiste du monde, ses bienfaits supposés, la formalisation à outrance des sciences, tandis qu’un nihilisme radical se répand (2) et laisse prévoir après la mort de Dieu, “la mort de l’homme” (Michel Foucault, Les mots et les choses). Il cherche à comprendre comment l’émancipation du sacré a produit en occident la première civilisation athée de l’histoire. Poète, Milosz voudrait dire “OUI” à notre existence sur terre, mais cette terre est couverte de douleur, et nous y pataugeons jusqu’aux genoux. Ses méditations sur la religion le rapprochent du courant de pensée “catastrophiste” qui l’aide à décoder l’ordre du monde, inacceptable à ses yeux.
Sans tomber dans un dualisme réducteur, il voudrait trouver un rempart contre le mal, la violence en boucle qui se diffuse autour de nous. Depuis Hiroshima la violence tient en respect la violence… mais elle prospère plus que jamais, se déploie et nourrit les guerres pour une apocalypse annoncée.
Qui ose, aujourd’hui, dessiner une fenêtre d’espoir ? Qui peut contredire Milosz ? ou croire Hölderlin en son temps : « Là où est le danger, là est ce qui sauve ?”
Une famille humaine…
A Odessa en 1940, Milosz est seul dans le hall d’une gare au cœur d’une foule et d’un immense chaos. Il y découvre une île qu’il ne peut oublier : une famille humaine. Cette famille survit par ses seuls liens humains patiemment tissés entre adultes et enfants, par leurs gestes simples tendres, leurs murmures partagés. C’est là, pour le poète, le dernier signe d’espoir possible dans le désastre de la folie humaine… ce qui préserve l’homme de la
désintégration et de la soumission à la violence.
Bien que prix Nobel de littérature, Milosz reste méconnu. La poésie est pour lui primordiale, il en dresse des bilans ou des fresques inimitables (3) grâce à l’étendue de sa culture et de ses connaissances jusqu’à 95 ans. Codifiée par les symbolistes français, il constate que la poétique moderne et son esthétisme, creusent un abîme entre le poète et la grande famille humaine. La séparation de l’art et du public s’accomplit (il cite Mallarmé) tel un malentendu, un rétrécissement des sources vivifiantes d’une culture. Les poètes sont menacés d’isolement, la poésie devient incompréhensible du grand public, témoignant d’un antagonisme essentiel entre l’Art et le monde (4).
On comprend pourquoi Milosz se sent un poète égaré dans son lugubre XXe siècle. Hanté par les violences du siècle il cherche passionnément à comprendre le sens du divorce, de l’exil, la révolte, l’aliénation même des poètes d’aujourd’hui (5). Il voudrait conclure, au soir de sa vie et défendre l’espoir du poète : faut-il payer le prix de l’unification de la planète ? Résister à la victoire de la désintégration, au vacarme des mots et des images qui n’ont qu’un but : contraindre à penser dans des catégories quantitatives.
Un humaniste dissident ?
En 1953 et jusqu’à la fin de sa vie, Milosz honore la famille humaine. Toutefois des critiques observent que cinq années plus tôt la “Déclaration Universelle des droits de l’homme” (1948) cite ostensiblement la famille humaine dès la première ligne… et à leur suite les détracteurs l’apparentent au droit-de-l’hommisme, c’est-à-dire à un trivial humanisme désincarné. Milosz l’exilé désapprouverait évidemment. Son humanité vient de loin, après avoir vécu de près les promesses messianiques de l’homme nouveau, du bonheur assuré, du consommateur englué.
Au-delà du cynisme, du nihilisme que faut-il souhaiter ? Pour Milosz intervient le principe de l’espoir : il est à l’œuvre chaque fois qu’on prévoit un cataclysme mettant fin à l’ordre existant pour qu’apparaisse une nouvelle réalité, une réalité interroge-t-il purifiée par la révolution ? le déluge ou un crash climatique ? sans contradiction ajoute-t-il : entre attente joyeuse et attente anxieuse. Le poète rappelle que rien ne vaut le chant d’un enfant, promesse de la grande famille humaine. Cet automne l’écrivain Jean Birnbaum lui répond avec le titre de son dernier livre : « Seuls les enfants changent le monde ».
(1) Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l’invasion de la Lituanie par l’Armée rouge, Czeslaw Milosz rejoint la résistance polonaise à Varsovie.
(2) Milosz cite pour exemple le nihilisme de S. Beckett.
(3) Témoignage de la poésie, PUF, 1987. Milosz cite des poètes admirés : Goethe, Baudelaire, Emerson, Mandelstam, Akhmatova, Whitman.
(4) C. Lambert, L’opposition du poète et du public est le signe d’un conflit plus
vaste, celui de l’humanisme classique et du nouvel humanisme planétaire –
Trésor de la Poésie Universelle, Gallimard, 1987.
(5) Ibid., p. 20.