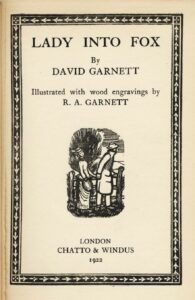
« Le vrai bonheur ne se trouve que dans le don de soi » (Garnett, Lady into Fox).
Cela pourrait ressembler à un conte, mais un conte pour adultes, trop étrange et cruel pour des enfants.
Cela pourrait ressembler à une parodie cynique des paroles qui scellent l’engagement du mariage, qu’il soit religieux ou civil, ce serment d’assister l’autre dans les épreuves de la vie, dans la santé, dans la maladie. Car quelle religion imposerait à l’époux d’aimer encore sa conjointe si elle devenait une bête ?
C’est pourtant cette preuve d’amour absolu que donne Mr. Tebrick à sa femme Silvia changée soudain en renard au cours d’une promenade. Au lieu de s’interroger sur le sens que prend désormais sa relation avec elle, le mari aimant ne songe qu’à une seule chose : comment protéger son épouse devenue si fragile ? Aussitôt il tue ses chiens excités par l’odeur de leur maîtresse devenue renarde, congédie ses domestiques et s’enferme avec elle dans sa demeure. Avec elle, quelle que soit son apparence, il n’a besoin de personne. Par la suite, bien que Silvia s’animalise toujours davantage jusqu’à avaler tout cru un lapin, l’amour de Tebrick ne faiblira jamais : « Si changée que vous puissiez être, mon amour ne change pas » déclare-t-il à sa renarde de femme.
La leçon est claire, et le lecteur est même un peu déçu de la trouver exprimée, fût-ce de façon désinvolte (car nous préférons toujours les fables dont la morale reste implicite, dont les portes n’ont pas de clef, nous laissant libres de chercher nous-mêmes les pistes d’interprétation possibles).
Ainsi, par plaisanterie, l’auteur nous défie de trouver meilleur exemple de fidélité conjugale : « Qu’il était différent de ces maris qui, leurs femmes devenues folles, les enferment dans un asile et s’abandonnent au concubinage »
Mais ces mots étaient inutiles ; on avait déjà deviné le sens de l’apologue : comment aimer encore l’autre quand son apparence, part si importante de son charme et de son identité, a changé, s’est dégradée, avilie, au point de compromettre toute communication dans le couple, toute possibilité de contact avec les autres, ne laissant d’autre perspective de vie que la claustration à deux, loin des humains ?
On pense en effet d’abord à la folie, ou à la dépression, la toxicomanie, des addictions détériorant la rationalité, monnaie d’échange des rapports sociaux – ou à certaines maladies, certains accidents de santé qui peuvent transformer le corps, l’esprit, la parole – on pense aux infirmités de la vieillesse, physiques ou mentales. Ou bien encore, de façon plus légère, la renarde rusée, ce peut être le mensonge, l’infidélité, une double vie cachée, la dispersion amoureuse, une gourmandise sensuelle soudaine, animale, qui viennent perturber la vie du couple, et que l’amant parfait accepte sans sourciller…
Le petit livre de Garnett est paru en 1922. Quelques années plus tôt, en 1915, Kafka publiait La Métamorphose. Ici pas de morale explicite. Pas d’amour inconditionnel non plus : la famille du pauvre Gregor Samsa transformé en énorme cloporte le regarde (l’évite plutôt) avec horreur et dégoût, et cherche bientôt un moyen de se débarrasser de « lui ». Point commun entre les deux récits : le héros, face à l’irruption du fantastique au cœur de la vie quotidienne, ne s’étonne pas outre mesure mais conserve toujours sa raison logique et pratique, réfléchit aux moyens de faire face à une situation radicalement nouvelle. Mr. Tebrick se soucie désormais de protéger sa femme devenue renarde des chasseurs et des chiens. Gregor Samsa, devenu un insecte monstrueux, s’évertue à se justifier auprès de sa famille, de ses supérieurs, à réparer l’incident par des paroles rassurantes.
Le récit de Garnett procure un charmant moment de lecture, grâce au ton léger, à la complicité spirituelle avec le lecteur, à ce délicieux humour anglo-saxon qui n’est pas si éloigné de l’ironie voltairienne : c’est une manière de conte philosophique.
Mais il ne saurait accéder à la profondeur existentielle, psychique, sociale où nous plonge La Métamorphose. L’intensité dramatique, les enjeux, l’implication de la personnalité tourmentée de l’auteur sont ici d’une autre échelle. Kafka met en scène l’horreur du Corps, de son impureté, l’effroi de vivre sous le regard des autres, l’effroi de vivre tout court – et selon son ami Max Brod, cet insecte immonde met en scène la condition du Juif soustrait à la communauté des hommes, condamné à vivre en ermite, tout comme Karl Rossmann dans Amerika, chassé par ses parents, qui doit s’exiler vers l’Amérique, tout comme Joseph K., le héros du Procès que Kafka vient d’écrire, arrêté sans raison, qui se lance dans une plaidoirie inutile devant un auditoire hostile.
Cette pauvre vermine embarrassée pour parler par la faute de son corps dépourvu de bouche humaine, c’est encore l’innocent condamné par les apparences, incapable de se défendre (on se rappelle la chemise du soutier, autre accusé impuissant, qui pend lamentablement dans Amerika), malgré toute sa verve, son exubérance oratoire : personne, ni famille ni chef venu de la maison de commerce ne peut saisir un mot de ce qu’il baragouine. Il n’a plus de voix humaine.
Revenant à Garnett, on conseillera aux lecteurs qui ont goûté aux aventures de sa renarde et de son époux à l’amour indéfectible, un petit roman du même auteur, où l’on retrouve à la fois son imagination narrative audacieuse et sa leçon morale, plus tacite, plus légère et souriante : Un homme au zoo.
Lors d’une promenade au Jardin Zoologique de Londres, un jeune homme se querelle avec sa fiancée aux sentiments devenus indécis et qui lui lance, par dépit et agacement : « On devrait vous enfermer et puis vous exhiber ici, au Zoo, avec le gorille d’un côté et le chimpanzé de l’autre » Piqué au vif, il prend ces mots au pied de la lettre et propose au directeur du Zoo de l’exhiber au Palais des Singes, comblant ainsi une lacune regrettable puisque l’espèce humaine est le seul mammifère important non représenté dans la ménagerie. On juge l’idée excellente. Le voici bientôt exposé dans une cage entre le Chimpanzé et l’Orang-Outang, avec un écriteau : HOMO SAPIENS. On n’en dira pas davantage…




