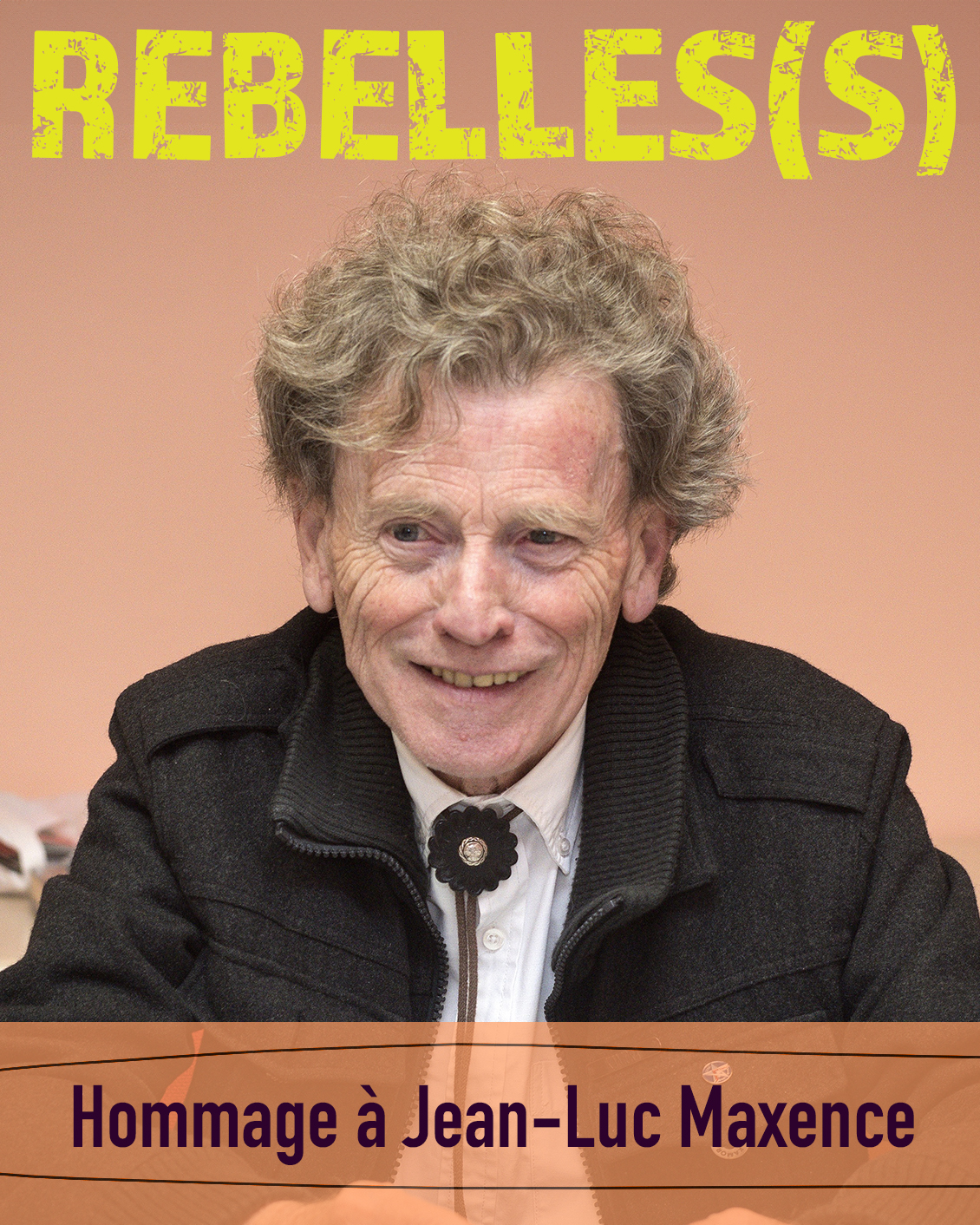Représenter l’irreprésentable
“Pourquoi la bombe n’est-elle pas un moyen ? (…) Parce qu’elle est absolument trop grande. Que signifie : “elle est absolument trop grande”? Cela signifie que le plus petit de ses effets – si on l’utilisait – serait plus grand que n’importe quelle fin (politique ou militaire) quelle que soit sa grandeur, définie par les hommes ; que son effet transcende toute fin (…) C’en serait fini du principe moyen-fin en tant que tel.” (Günther Anders, L’Homme obsolescent).
Comment représenter l’irréprésentable ? Comment donner une idée du changement d’échelle absolument hors-norme que fut l’invention de la bombe atomique ? Et surtout : comment montrer au cinéma les conséquences dévastatrices de son utilisation, dont Anders déplorait non seulement qu’elle ait eu lieu, mais qu’elle ait eu lieu deux fois ? Car la catastrophe d’Hiroshima s’est bel et bien répétée : à Nagasaki. Deuxième fois qui fut fatale, au peuple japonais, d’une part ; à l’humanité tout entière, probablement pour toujours, d’autre part. Ce qui fut inventé avec la bombe atomique, c’est la menace permanente qui plane au-dessus de nos têtes. Menace impensable. Impensable, parce que la possibilité de notre disparition, par des causes qui n’ont plus rien de naturel (si ce n’est que la technologie s’appuie, comment pourrait-il en être autrement, sur des lois de la nature), possibilité omniprésente, mais en creux, partout, à tous les niveaux, dans tous les aspects du monde d’après 1945, n’est plus tout-à-fait de l’ordre du discursif, du rationnel, de l’explicable, bien que derrière l’arme atomique se cachent, comme toujours, des rivalités économiques, des intérêts hautement stratégiques, des rapports de force entre Etats se partageant l’échiquier mondial. On entre là dans un ordre qui excède proprement la pensée humaine. C’est ce qu’Anders baptisait de l’appellation quelque peu métaphysique : “dépassement prométhéen”, en couplant sa réflexion sur le nucléaire d’une méditation sur l’objet technique de façon plus générale et de quelques anticipations visionnaires sur le développement de la robotique, de l’informatique, voire même de l’intelligence artificielle, en dépit de l’évident anachronisme de ce genre de considérations.
Double énigme
Certes, les grands films sur les victimes des bombardements atomiques ne manquent pas : j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer le magnifique “Pluie noire” d’Imamura, par exemple. Christopher Nolan, lui, propose de renverser la perspective, de retourner la caméra par une rotation à cent-quatre-vingt degrés : du côté des utilisateurs de la bombe, et même mieux, des inventeurs de la bombe. Plutôt : de l’inventeur : s’il n’y a qu’un nom à retenir, en effet, c’est bien celui de Robert Oppenheimer, physicien américain dont le souvenir est resté définitivement associé au projet Manhattan. Par ce geste, Nolan fait coup double. Il nous ramène au ras du sol, dans le quotidien et la psychè (vaguement tourmentée) d’un scientifique de génie : “Oppenheimer” se présente donc comme un “biopic” retraçant les étapes de la vie d’un homme, qui, comme n’importe qui, a été amoureux, s’est marié, a eu des enfants, des amis, a vécu des moments de joie, de surprise, d’ennui, a connu la gloire, subi des trahisons, des revirements du sort, avant de plonger dans un oubli relatif, tout en recevant de multiples hommages (saluons au passage la performance saisissante de Cillian Murphy). Le décalage entre une existence qu’on pourrait presque qualifier d’ordinaire n’en est que plus grand avec le destin qui l’accompagne, la naissance de cette “chose” monstrueuse qui défie l’intellect et a fait de l’Homme l’unique espèce animale capable d’anéantir toute vie sur terre. Ce ne fut pas une vie d’aventurier, de mercenaire, de conquérant magnifique, ni même de perdant magnifique : ce fut une carrière scientifique qui s’est pour l’essentiel déroulée dans des laboratoires. Première énigme.
Ensuite, en se tournant vers les concepteurs de la bombe atomique, Nolan nous laisse forcément avec cette question torturante : qui est, qui fut, responsable de l’utilisation de la bombe atomique ? Et la seconde énigme est dans la réponse : personne. Personne n’est responsable de la bombe atomique, parce que l’objet est décidément trop grand pour être imputable à qui que ce soit. Etrange patrimoine que nous ont légué là les “pères fondateurs” américains de l’ère atomique.
Frankenstein dépassé
Mais la bombe, c’est quoi, au juste? telle pourrait être la troisième énigme. La bombe… n’est qu’une bombe, justement. Nous savons tous ce que c’est qu’une bombe, l’objet nous est familier, on en a vu dans les films, et l’on a toujours tendance à s’imaginer le petit boulet de canon à la mèche enflammée, ou bien une pendule qui fait tic-tac sous un siège. Le plus frappant dans le film de Nolan, est la relative déception que peut susciter l’objet quand il se présente enfin à nos yeux : ses dimensions sont modestes, pas même celles d’un être humain. Il ressemble vaguement à une fusée (ce qu’il est aussi, par ailleurs). Son fuselage est lisse et arrondi. Ce qui est impensable ici, c’est la disproportion entre l’objet, la bombe, et ses effets. Nolan réussit le tour de force de nous suggérer cette disproportion, de nous la faire comprendre, au-delà de l’image. D’abord par ce plan saisissant, ce face-à-face tant attendu entre l’inventeur et l’invention, le créateur et la créature : face-à-face qui, cela ne nous aura pas échappé, fait allusion, mais en en inversant la signification, à la célèbre fresque de la Création du Monde par Michel-Ange. Sauf qu’il s’agit ici de sa destruction. Oppenheimer, qui se fantasme bien misérablement en “destructeur des mondes”, ne peut rivaliser avec sa propre invention. Celle-ci lui oppose un regard sans âme, une cécité de Sphinx divinatoire. Elle n’a pas de mains. Cette créature sans vie signe la fin du règne humain : à présent, c’est elle qui domine le créateur.
Mais il faut attendre le moment où l’on procède aux essais pour que la bombe révèle sa puissance apocalyptique. Le mot “Apocalypse” signifie en grec “révélation”. Nolan nous fait éprouver ce choc, comme si on y était. Et alors se produit l’incommensurable : on reste incapable de faire le lien entre le petit objet exposé quelques plans auparavant, et la vaste déflagration qui semble s’éterniser, cet immense éclair blanc aveuglant le désert de Los Alamos, ce soleil frappant en plein coeur de la nuit. Le cinéma atteint alors au “sublime”, dans le sens très exact que Kant donnait à ce mot : la saisie d’une disproportion entre une grandeur donnée dans la réalité et les facultés dont nous disposons, disproportion qui rend cette grandeur impossible à appréhender comme un tout. Mais désormais, ce n’est plus la nature qui nous apparaît sublime : c’est la technique humaine, au-delà de l’être humain. Quoi de mieux, pour en donner la meilleure approche, que le cinéma lui-même, l’art le plus technique qui soit ?
Mais revenons à nos deux énigmes. L’énigme Oppenheimer, d’abord. Qui était-il au juste ? L’énigme se renforce du constat qu’Oppenheimer n’avait rien d’un cynique ou d’un monstre. C’était un homme capable d’aimer. Et d’entretenir, paradoxalement, des amitiés très à gauche : on apprend qu’il fréquentait de militants communistes, par exemple ; il entretenait d’ailleurs plus que des fréquentations communistes : une liaison amoureuse, qui tourna court avec le mariage d’Oppenheimer. On découvre alors un personnage étrangement naïf, dont les préoccupations politiques ont pour centre névralgique l’obsession du nazisme en Europe et le danger que représente Hitler pour les Juifs et le monde (tout particulièrement pour l’Union Soviétique). Oppenheimer ne s’inquiète pas seulement de la possibilité que l’Allemagne soit en mesure de construire une bombe atomique : il nourrit l’espoir que son invention mettra fin à la Guerre ; à toutes les guerres… On pourra certes penser que ses amis communistes, et surtout sa petite amie, auraient eu là l’occasion rêvée de lui faire un cours de philosophie politique accélérée : hélas, il semble bien qu’eux-mêmes aient été bien plus naïfs et idéalistes que lui. Le fait est que le Parti Communiste américain a soutenu l’effort de guerre américain sans émettre beaucoup de réserve. Assez vite, il s’avéra que le principal adversaire que la bombe A devait terroriser, c’était plutôt l’Union Soviétique que l’Allemagne nazie. Aussi les USA étaient-ils engagés dans une course contre la montre : utiliser la bombe avant que les Soviétiques ne mettent la main dessus.
La biographie détaillée d’Oppenheimer n’éclaircit pas le mystère, loin de là. Les plus grands esprits ne sont pas les plus clairvoyants, on en conviendra. Mais il ne s’agit pas seulement de cela. Oppenheimer semble avoir formulé le principal problème en confiant un jour que s’il n’avait pas inventé la bombe, quelqu’un d’autre l’aurait inventée de toute façon, à partir du moment où on comprenait les conséquences et les applications possibles de la mécanique quantique. Comme s’il y avait là un destin écrit en filigranes dans les lois profondes de la nature, dans ses replis les plus secrets, un destin sur lequel nous n’aurions plus prise.
Réaction en chaîne
Ce qui nous ramène à la deuxième énigme. En quel sens la bombe atomique rend-elle caduque l’idée même de responsabilité humaine ? Cette question est au coeur de la pensée de Günther Anders, et l’on sait que le film de Nolan lui doit beaucoup. La réponse est du côté de la notion de chaîne causale. Toute action, naturelle ou humaine, s’inscrit dans une chaîne causale impliquant de multiples facteurs. La chaîne de commandement, à la guerre, par exemple, suit les règles relativement simples de la hiérarchie militaire. Concernant la bombe, peut-on hiérarchiser les responsabilités en suivant la chaîne causale, de l’homme qui appuie sur le bouton, un simple employé, au président des Etats-Unis, en passant par l’inventeur chargé du bon déroulement et de la coordination des essais, la hiérarchie militaire sous la juridiction de laquelle il se voit placé (excellement incarnée par Matt Damon en gradé faussement ingénu), l’état-major central de l’armée américaine? On voit tout de suite que non. Malgré les déclarations du président Truman, qui assume toute la responsabilité à lui tout seul, il se trouve que tout le monde est responsable, et donc que personne ne l’est. Et cette dé-responsabilisation est au coeur de l’arme atomique : son usage même suppose une coordination de toutes les instances, une répartition des tâches, qui a pour résultat de rendre anonyme celui qui accomplit l’action décisive (car, ici, toutes les actions sont décisives, de la première à la dernière). On a ainsi l’impression que “la chose se fait toute seule”. L’action, dès lors, est déshumanisée : c’est un acte sans sujet. D’autant plus que les utilisateurs de la bombe ne verront pas leurs victimes. Dès lors, les seuls “sujets” humains, dans l’histoire, ce sont justement les victimes, celles qu’on ne verra jamais dans le film (pas même en documentaire), parce que les protagonistes du projet Manhattan ne les ont jamais vues. Certes, quelqu’un donne l’ordre, Truman en l’occurrence. Mais cet individu est lui-même un élément parmi d’autres, un rouage de l’appareil d’Etat complexe de la première puissance militaire du monde. Les scientifiques eux-mêmes sont, dès l’accomplissement réussi des premiers essais, dépossédés de leur invention au profit exclusif de l’armée. Et finalement, Oppenheimer se verra dépassé par ses propres élèves, lorsqu’ils se tourneront vers une technologie plus prometteuse et plus meurtrière que la bombe A : la bombe à hydrogène. Etats et individus mettaient ainsi le doigt, et plus que le doigt, dans un engrenage qui les contrôlerait bien plus qu’ils ne le contrôlent, dissimulant fort mal sous le principe de “dissuasion nucléaire” le nouveau type de menace qui venait de se mettre en place (en ce sens, la vraie menace nucléaire serait à dater de l’invention de la bombe H : celle-ci contraignait d’ailleurs les Américains à un changement de stratégie militaire et à concevoir la bombe comme une arme de dissuasion, et non plus comme une arme d’attaque ; pour autant, on voit que c’est l’innovation technique qui définit les choix stratégiques ; ce quitte-ou-double signe, du reste, la fin de toute stratégie, de tout “art de la guerre”). Günther Anders déclarait au sujet de la technologie moderne, que c’est désormais l’utilisateur qui est le moyen utilisé par la machinerie technique, et non l’inverse. Le rapport fin/moyen s’en trouve dépassé et perverti (en termes dialectiques : “aboli”).
De façon significative, ce processus de déshumanisation d’une action par une chaîne causale qui la réduit à un engrenage imparable est à l’image même du mécanisme de la bombe atomique, qui se caractérise justement par une “réaction en chaîne” : la fission de l’atome a pour effet de libérer des neutrons, qui vont à leur tour déclencher la fission des autres atomes, lesquels libéreront d’autres neutrons, et ainsi de suite.
Qui a tué le chat de Schrödinger ?
Il a fallu, pour découvrir cette technologie, que de nouvelles lois fondamentales de la nature soient formulées (ce fut fait grâce à Bohr et Heisenberg). Un des aspects de la théorie quantique qui posait le plus de problème à Einstein, notamment, c’était le recours aux probabilités : l’école de Copenhague en avait proposé une lecture résolument indéterministe, ce qu’Einstein a toujours refusé. Cet enjeu sous-tend les quelques entrevues (très furtives, et taraudées par le malentendu) entre Einstein et Oppenheimer, lorsque celui-ci soumet les conséquences potentiellement dévastatrices des tout premiers essais nucléaires. Le risque d’embrasement de l’atmosphère avait été jugé non nul selon les calculs. Faut-il tout arrêter ? Oppenheimer incarne ici un type de rationalité qu’on pourrait qualifier de “pragmatique” : si la probabilité d’une catastrophe est infime, elle peut être tenue pour négligeable (mais que signifie “infime” ? ce terme est-il susceptible d’une interprétation scientifique rigoureuse?) Einstein, en revanche, maintenait que dans l’univers réel, une porte doit être ouverte ou fermée (“ça passe ou ça casse”) : les probabilités n’existent pas objectivement dans la nature, elles ne sont qu’un expédient utilisé par l’esprit humain pour produire des modèles et formuler des hypothèses prédictives, en l’absence de connaissances plus exactes. Dans la réalité, soit nous sommes vivants, soit nous sommes morts. Il n’y a pas d’entre-deux.
Avec l’Ecole de Copenhague et l’enracinement dans la culture scientifique de sa philosophie entièrement tournée vers le succès expérimental des théories, une boîte de Pandore fut ouverte. La voie était dégagée, qui s’offrait à un pragmatisme visant à adapter les moyens à des fins sans cesse réorientées en fonction des problèmes qui se posent et des succès obtenus, au gré des circonstances. Einstein lui-même reprochait à l’Ecole de Copenhague l’absence de principes fermes au fondement de sa théorie : l’indéterminisme ne saurait tenir lieu de philosophie. Il lui opposait, tout en prenant acte des découvertes et des lois dont on sait aujourd’hui qu’elles régissent la matière, un réalisme robuste, ancré à la fois dans le sens commun et la conception d’une réalité causalement déterminée. Faute d’une philosophie qui prenne en considération ce réel que nous n’avons pas créé, la recherche risquerait de se laisser enfermer dans une démarche qui néglige les conséquences les plus lointaines au profit de la simple “faisabilité” d’un projet. Le scientifique ressemble fort, dans ces conditions, à l’expérimentateur de Schrödinger, décidant si le chat est vivant ou mort par le simple geste d’ouvrir la boîte (de Pandore, donc). Comme l’admettait Oppenheimer : si c’est faisable, alors quelqu’un le fera. Mais à quel prix ?