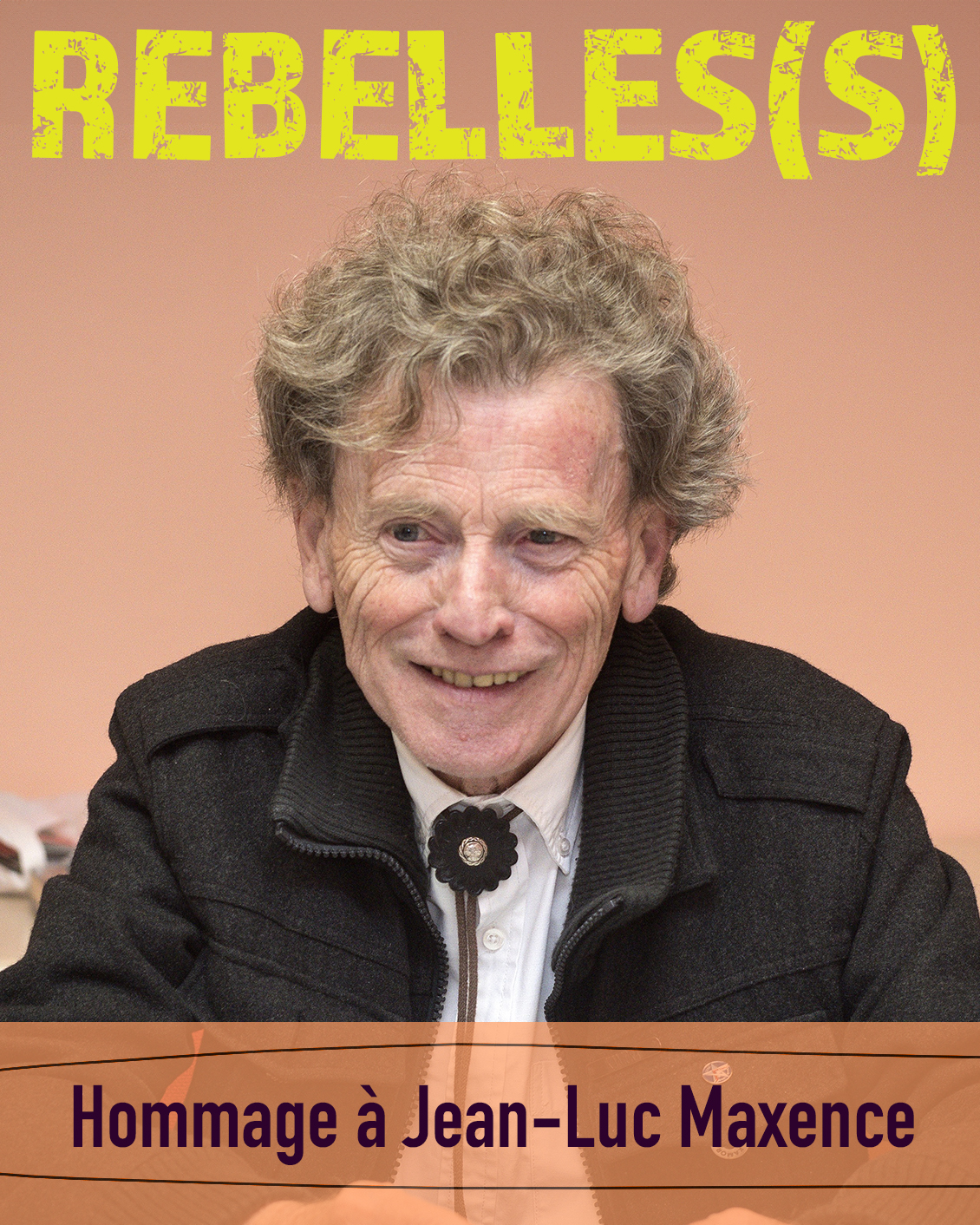Quel con ! Qui ? L’autre, évidemment. Le mot «con», vulgairement employé de nos jours dans les pays francophones comme injure majeure ou du moins des plus répandues, partage avec le mot «fou» l’emploi presque exclusivement transitif: le «con», comme le «fou», est toujours l’autre. Exceptées bien sûr les expressions auto-ironiques ou amusantes qu’un sujet adresse à l’égard de lui même et dont la fiction est évidente. Le fou est celui ou celle que l’on ne comprend pas, tout comme le con n’est souvent rien de plus ni de moins qu’une personne qui nous contrarie. En ce sens «con» est employé comme signifiant passe-partout: il veut tout dire et c’est précisément pour cela qu’il ne dit rien ou trop peu.
Pourtant, une certaine dose de connerie concerne tout un chacun, une dose pouvant même se faire pathologique et dangereuse tant pour le sujet en question que pour son entourage et pour la société entière. Les puissants qui gouvernent le monde ne sont-ils pas la plupart du temps en overdose de connerie? La question essentielle, véritablement «thérapeutique» à se poser serait donc avant tout: «quelle est ma dose de connerie?». Car à partir du moment où le petit d’homme transcende sa nature d’infans pour acquérir la faculté du langage verbal, il ne cessera de se raconter des histoires sur son propre compte comme sur le monde. L’homme a été créé à image et ressemblance de Dieu, la femme n’a pas d’âme, les peuples indigènes sont inférieurs, la Terre est au centre de l’univers, les animaux n’éprouvent aucune souffrance morale…
«Moi, mon papa, il a un vélo» récitait l’immense Fernand Raynaud renvoyant ainsi la connerie non seulement à ses débuts, mais également à ce Moi dont la psychanalyse, contrairement au discours psychologique et psychothérapeutique, a su souligner la nature imaginaire et aliénante. Il semblerait pourtant trompeur de penser que notre discours serait valable pour l’enfant tandis qu’il ne le serait point pour l’adulte. Si tel était le cas la psychanalyse ne se serait pas développée. L’adulte n’est souvent qu’un enfant un tout petit peu plus développé, surtout camouflé. La psychanalyse ne consiste-t-elle pas précisément en une expérience finalisée à la prise de conscience des couches de connerie recouvrant l’inconscient ? Assurément, un tel résultat n’est ni sûr, ni aisé à obtenir.
L’expression populaire «en tenir une couche» prend ici tout son sens.
Même en analyse, il ne s’agit souvent que de la substitution de mots par d’autres plus érudits et d’attitudes ingénues par d’autres plus raffinées. L’ingénu Kaspar d’Herzog rencontrant pour la première fois la sphère de la haute société s’en enfuit de suite en courant. Il affirmera même préférer la prison où il vécut toute son enfance à la fausseté des paroles et des manières qui entoure le monde des hommes… Atteindre le cap de la «parole pleine» relève d’une conquête dont il est à se demander si la connerie y est véritablement évacuée ou si elle n’a fait que changer de forme. Car l’homme apprend vite à savoir y faire avec sa connerie. Il y développe même, parfois, une forme particulière d’intelligence, peut être même un art.
Savoir y faire avec sa connerie, tout comme savoir y faire avec ses symptômes, ne serait-ce pas là le résultat majeur que l’on puisse attendre d’une analyse bien menée, résultat à relier en quelque sorte avec ce que Lacan nommait «l’avènement du Je social»? Si tel était le cas, la science de l’inconscient bouleverserait la conception d’une sagesse non plus inspirée par des vérités sublimes, mais dérivant de la lucidité de se voir en se regardant et de s’entendre en parlant. En d’autres termes, ne jamais se prendre trop au sérieux et ne jamais quitter des yeux le clown qui demeure en nous et qui participe à cette grande comédie humaine, la foire aux conneries. Que la fête continue !