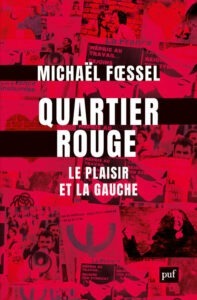
Pour celles et ceux qui ont vécu Mai 68 de l’intérieur, enfin plus souvent dans les amphis de la Sorbonne, à l’Odéon ou au milieu des fumigènes des flics que calfeutré chez soi devant la télé, le « jouir sans entraves », un des slogans les plus populaires du moment, tombait sous le sens. Sans doute parce qu’il participait du rejet global d’une société où, entre autres, le sexe était un des tabous les plus robustes et parce qu’en même temps, ces mots nommaient une voie de libération des contraintes et interdits qui l’entourait. Il était donc intimement lié à la gauche multiforme et joyeuse d’alors. Car il parlait à celles et ceux qui vivaient encore dans la hantise de la grossesse non désirée, de l’avortement encore clandestin, de l’assignation à assumer le rôle de mâle dominant. L’auteur rappelle que certains ont pourtant vu dans ce slogan « le Cheval de Troie libidinal du néolibéralisme ».
Depuis, le panorama a changé. Le sexe est devenu tout à la fois un terrain d’émancipation, d’épanouissement, tout autant qu’une matière à débat et une source de violences économiques et physiques, un registre « intégralement formaté par le capitalisme ». La gauche quant à elle a oublié les chariots d’espoirs et de rêves qui l’ont amené au pouvoir, abandonnant en route son intimité avec les plaisirs : celui de la liberté, celui du collectif, du partage… Sans doute parce que ses têtes pensantes ont progressivement préféré la jouissance des victoires électorales au renouveau de la dimension subversive et politique du plaisir.
L’auteur, usant à de nombreuses reprises de références au cinéma – à sa gauche Claude Sautet, à sa droite Michel Audiard – revendique « un essai de philosophie consacré au plaisir », car il est « urgent de réfléchir sur la dimension émancipatrice du plaisir ». Il désapprouve ceux qui considèrent que le plaisir ne serait pas une question pertinente en période « d’économies de la rareté » et fustige l’écologie « punitive ». Il lui préfère une « réélaboration », et non un abandon, du concept d’abondance, privilégiant « le partage égalitaire, sans lequel il n’y a ni pensée, ni pratique de gauche ».
Il convoque des exemples chez Émile Zola et Simone Weil, selon lesquels « le plaisir n’attend pas ».
Il emprunte au premier la stupéfaction du héros de Germinal, patron circulant au milieu de ses mineurs en grève, « galants qui allaient, la bouche sur la bouche prendre du plaisir derrière les murs (…), des filles culbutées au fond de chaque fossé, des gueux se bourrant de la seule joie qui ne coûtait rien », dont il enviait « cet unique bonheur de s’aimer ».
Il rappelle la « joie », rapportée par Simone Weill, des ouvriers de 1936 occupant leurs usines, dont les « corps avaient trop plié et trop encaissé », dont l’audace était « joyeuse car elle suspendait la peur dont est tissé l’essentiel de la vie des pauvres. »
Cet essai met en lumière la mauvaise réputation dont pâtit le plaisir chez un grand nombre de partisans de la transformation sociale, réitérant sa conviction que le plaisir, « loin d’être le ressort de l’individualisme consumériste, n’advient qu’en étant échangé ».
L’auteur nuance les points de vue de ceux qui militent d’un côté pour la sobriété, de l’autre pour l’ascèse. Pour lui, c’est le respect des écosystèmes qui doit motiver les nécessaires modifications à apporter aux pratiques alimentaires et non les règles dogmatiques des apôtres d’une ascèse végan. Michael Fœssel critique cette dernière approche, parfois partagée par la gauche, « vecteur d’individualisme puissant », incarné par le profil de « l’hédoniste conservateur ». Il dénonce l’injonction à rendre chacun individuellement pur dans un monde qui ne l’est pas, qu’il considère rédhibitoire pour toute ambition collective. Il montre que la polémique entre Voltaire partant en guerre contre l’austérité moralisante de Rousseau, préfigurait ce débat, tout comme le goût pour la bonne chère et pour les femmes de Danton s’opposant à la vertu sacerdotale de Robespierre. Ainsi le philosophe suggère que « la défense politique du plaisir a clairement viré à droite, à moins que la droite ne soit devenue voltairienne et dantoniste ».
L’auteur ne s’exonère pas d’une réflexion sur la sexualité, qui occupe « une place à part dans l’analyse du statut politique du plaisir ». Il pointe les partisans du « on jouissait mieux avant », porté par les contempteurs du mouvement Metoo qui aurait entrainé une suspicion généralisée, par les tenants d’idées égalitaires devenues folles telles que la PMA et la GPA ou par les promoteurs de la pornographie virtuelle, responsable de la misère des corps.
En conclusion, Michael Fœssel souhaite que son ouvrage soit une brèche dans la croyance mortifère selon laquelle chacun est revenu de tout, non seulement en matière de plaisirs, mais également en matière politique et que le temps est venu de « la gestion de l’existant ». L’enjeu ne se résume pas à un choix résigné entre « la domestication des corps » et « une protestation ascétique contre un monde injuste ». Plutôt que d’accuser un « imaginaire » de gauche qui serait en panne, il sous-entend que c’est l’articulation entre « les imaginaires de justice et les expériences concrètes » qui doit prouver qu’une autre organisation de la société est possible. Dans ce contexte, il octroie au plaisir une « place centrale » et réfute le recours à la jouissance d’un « Moi satisfait ». Il recommande de préférer « les éclats de rire, le jeu ou tout autre forme d’allégresse » susceptibles de convaincre que « malgré tout, la fête n’est pas finie ».
« Quartier rouge, le plaisir et la gauche », Michaël Fœssel, Ed. PUF, 02/22, 204 p., 17 €




