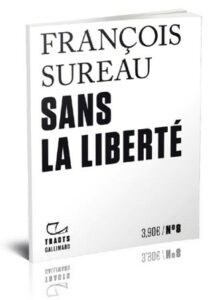
Sans la liberté
Éditions Tracts Gallimard, septembre 2019, 56 p., 3,90 € –
La Collection « Tracts » propose de « faire entrer dans le débat » les femmes et les hommes de lettres « en accueillant des essais en prise avec leur temps mais riches de la distance propre à leur singularité ». Cette promesse est magistralement délivrée par François Sureau, avocat et écrivain, auteur du 8e ouvrage de cette collection. Il opère un diagnostic chirurgical et lance une alerte concernant l’une des mamelles de la République française : la liberté.
Il n’est pas le premier à explorer ce champ et à relever les diverses « atteintes et traverses » subies par cette « étincelle que l’homme avait reçue ou s’était donnée » et que « tout depuis les origines du monde [conspire] à éteindre ». À la différence de ceux qui l’ont précédé dans cet exercice, il ne se contente pas d’aligner des constats et d’établir le procès des pouvoirs concernés. Il commence même par rejeter une part importante des responsabilités sur le citoyen, devenu un « individu réclamant des droits pour lui et des supplices pour les autres. […] Les gouvernements n’ont pas changé » dans leur impatience de la liberté, mais « c’est le citoyen qui a disparu ». Néanmoins, il rappelle ensuite que, depuis 20 ans, les gouvernements ont été incapables « de doter, de commander, d’organiser leurs polices » et se sont contentés de « restreindre drastiquement les libertés pour conserver les faveurs du public et s’assurer de leur vote ».
S’il comprend que le terrorisme ait pu justifier « les atteintes les plus spectaculaires aux grands principes », il relève qu’en dehors de ce contexte, « le législateur a préféré doter l’État du moyen de contrôler la participation individuelle de chacun à une manifestation », convoquant en l’espèce les dernières dispositions adoptées pour faire face aux excès des manifestations de gilets jaunes. Il reproche de même au Conseil constitutionnel de n’avoir « pas vraiment fait obstacle » à ces politiques répressives et de se porter complice du refus de payer le prix de la liberté, « apanage d’un citoyen soucieux de bâtir une société meilleure et non pas seulement le privilège d’un individu soucieux de sa jouissance personnelle ».
Pour lui, cette posture signe « la mort de la société politique », tout en laissant croire que « la répression pénale des symptômes » suffira à éteindre la violence sociale. Mais il ne tient pas les citoyens et gouvernements comme seuls acteurs du « mépris des droits », et dénonce « les auteurs du vingtième siècle » qui, à l’exception de quelques-uns – Camus, Paulhan, Mauriac ou Aron – ont « épousé la cause des totalitarismes de droite ou de gauche ». Cette sévère analyse s’achève sur le constat, partagé avec Simone Weil, d’un « monstre social [qui] nous dévore sans que nous parvenions jamais à le nommer », comme le démontre le projet du Parlement de voter « une loi imposant l’immatriculation des vélos »… Plus de gouvernement, plus de citoyens, plus d’antagonisme entre le citoyen et l’État.
Ce qui soutenait la démocratie « disparaît, privé d’objet, remplacé par l’antagonisme entre les groupes et les individus, par cette lutte de tous contre tous ». Et le pire pourrait advenir avec l’apparition de plus en plus fréquente, dans la gestion de l’ordre républicain, d’acteurs privés d’intelligences artificielles aux côtés des acteurs publics. Sans état d’âme, ils risquent de ne pas hésiter entre remplacer le chemin de « l’amour de la liberté » et construire l’autoroute de « la servitude consentie ».




