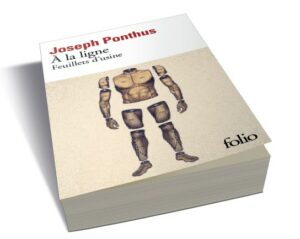
Récit existentiel d’une expérience destructrice du corps, découverte du monde de l’usine par un travailleur social qui, jusque-là, encadrait une jeunesse ne rêvant pas d’être encadrée, A la ligne est un livre magnifique. On le lit d’une traite, comme un roman passionnant. Ce n’est pas un roman, contrairement à ce qu’indique le texte en quatrième de couverture. Pourtant bien imprimé au-dessous du titre et voulu comme tel par l’auteur Joseph Ponthus, ce sont des feuillets, composant une chronique quasi quotidienne du travail ouvrier. Sa poésie puissamment évocatrice vous laisse assommé par la révélation de la souffrance et les hoquets de drôlerie.
Joseph Ponthus, éducateur, ne trouve pas de boulot dans son métier. Il a besoin de sous pour vivre, il embauche dans l’industrie agro-alimentaire. Il embauche « à la ligne », dans l’usine. Ce sera une usine de poissons à Lorient, puis un abattoir dans le Morbihan. C’est du brutal.
Ce qu’on lit, c’est la description d’une condition ouvrière qu’on avait oubliée au milieu des années 80. Depuis cette époque, les forçats du salariat ont surtout été exploités dans le tertiaire, centres d’appels, salles de marché, open space à cloisons de verre et organisations à plafond du même matériau. Retrouvant les bienfaits du panoptique des frères Bentham, les superviseurs y sont omniprésents, distribuant via les processus informatisés directives et consignes dans un délire régulateur et monitorant. L’œil qui voit tout est déjà au-dessus de nos têtes.
Pour les usines, le capitalisme avait mis ses espoirs de profit dans les robots. Jamais en grève mais souvent en panne ; toujours d’accord mais rarement enthousiaste, le robot s’avéra imparfait. Finalement tout comme nous. Après de nombreux tâtonnements, le manager dû réintroduire de vraies jambes et de vrais bras dans le ballet de la production et, prolongeant ceux-ci, de vraies mains dans le cambouis. Un savant équilibre entre robotisation et présence humaine s’avéra plus efficace pour assurer durablement la productivité.
On croyait qu’avec les délocalisations, toutes nos usines avaient foutu le camp en Asie en général et en Chine en particulier, donnant du boulot, des salaires et des troubles musculo-squelettiques aux prolétaires-de-tous-les-pays-unissez-vous mais qui préfèrent rouler en BMW plutôt que chanter les lendemains qui chantent. En fait, des usines, il en reste encore dans notre vieux pays. N’ayant pas la chance d’être intérimaires de l’industrie agro-alimentaire, on est étonnés d’apprendre, innocents que nous sommes, qu’il existe – à Lorient et ailleurs – des lieux où des gueux sidérés se font exploiter de la belle façon.
C’est dans cet univers industriel bien actuel avec des morceaux de misère dedans que notre guide Joseph Ponthus constate, non pas la mort de la classe ouvrière, mais celle de sa conscience de classe. Corollaires : plus de combat social, plus de rapport de forces générateur de partage de la valeur ajoutée, plus de recherche même douloureuse de l’équité. Retour au XIXème siècle.
« Ce n’est pas du Zola mais on pourrait y croire » – la formation littéraire de l’auteur le sauve. En égouttant du tofu, il pratique le sarcasme du lettré, l’indignation du rebelle, l’auto-ironie du tendre. Ca l’aide à tenir. Le regard distancié est un puissant antidote à la douleur morale, à défaut d’un anti-inflammatoire apaisant les douleurs articulaires. Mais comment faire comprendre, ressentir, la nouvelle condition ouvrière ? Joseph Ponthus cite avec un à-propos saisissant et une justesse confondante – ça sert donc, la littérature ! – les auteurs qu’il connait et qu’il aime. Tour à tour convoqués pour éclairer les situations vécues, Apollinaire, Dumas, La Bruyère ou Trenet se succèdent, mais aussi les vedettes populaires dont les chansons, les sketches ou l’évocation des exploits aident à tenir la cadence : le Johnny et la Sylvie, Julien Doré, Fernand Raynaud, Zidane… Marcel (Proust, pas Hamon) a même droit à quelques considérations bien senties. Citer l’Odyssée dans une usine de poissons peut éventuellement le faire, mais le Vicomte de Bragelonne, c’est infiniment élégant. Nous apprenons aux dernières pages que Pontus de Tyard, membre de la Pléiade, ami de Ronsard et du Bellay, est un ancêtre de Joseph Ponthus. Il arrive donc que bon sang ne sache mentir ; fort justement comme souligné, « Qu’incessamment en toute humilité / Ma langue honore et mon esprit contemple ».
Ponthus nous raconte avec une verve poignante la séparation des individus sur la chaîne de production, à cause ou plutôt grâce aux horaires décalés, sur des postes semi-automatisés. Suffisamment autonomes pour être quasi-seuls toute la journée – quitte à courir partout ; suffisamment dépendants de machines défaillantes pour ne pas pouvoir s’octroyer par instants les petits relâchements de l’esprit et du corps. Elles sont loin, les lignes souvent peu automatisées d’antan, qui offraient des espaces de liberté mesurés mais réels. Pas le rêve, mais une zone de confort qu’on préservait avec l’expérience du geste, l’entraide des collègues, la bienveillance de certains agents de maîtrise. Ils n’étaient pas encore passés par les formations à la gestion industrielle, du juste à temps au lean management.
Résultat de ces chouettes innovations, le nouveau serf est trop crevé pour réfléchir, pour échanger, pour s’organiser, dans l’incapacité de seulement songer à lutter. Quant à se plaindre… Si l’intérimaire l’ouvre, l’agence ne lui proposera pas de réembauche. Un rêve de congressiste à Davos. Il n’y a donc pas que chez Apple en Chine, ou chez Amazon partout dans le monde qu’on bosse dur pour pas un rond. Un libéralisme comme on l’aime, avec des sandwichs néerlandais* juteux et des petits noirs bien serrés.
Un staccato d’angoisse – Vais-je être embauché ? Vais-je assurer sur la ligne de production ? Vais-je terminer ma journée sans me casser le dos définitivement ? Vais-je être réembauché ? – comme si vous y étiez. En fait, c’est lui qui y est. C’est ça qui est bien avec la littérature, on n’a pas besoin d’y être ; il suffit d’avoir un écrivain bien placé, capable de cuire du bulot à la tonne et d’écrire un témoignage bouleversant.
Ce livre est un grand livre. D’une densité poétique inattendue dans un récit d’expérience ouvrière ; introspection d’un homme qui sait réfléchir, même si le rattrapage du retard accumulé sur le planning de décorticage des crabes ou de nettoyage de l’abattoir des bovins lui laisse bien peu de temps pour le fignolage des phrases. Il écrit en arrivant chez lui, en ayant oublié, parce qu’il est trop fatigué, la moitié de ce qu’il avait en tête d’écrire. Il fait court, il va « à la ligne ». Et, peut-être aussi pour cette raison, c’est splendide.
La débauche / Quel joli mot / Qu’on n’utilise plus trop sinon au sens figuré / Mais comment comprendre / Dans son corps / Viscéralement / Ce qu’est la débauche / Et ce besoin de se lâcher se vider se doucher pour se laver des écailles de poissons mais l’effort que ça coûte pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après huit heures de ligne
Dans ce journal mélangeant expressionisme poétique et réalisme gore, on en apprend un rayon sur les variétés de crevettes et les techniques d’équarrissage des vaches. Une vache, c’est lourd, quand bien même carcasse pendue au croc d’un rail d’abattoir. Re-re-triées, les crevettes qui ont chacune une destination spécifique ont pour noms Coaxial, Ishida, Multivac, Arbor, Bizerba. Bizarre, on dirait de la tringlerie informatique ou des termes d’ingénierie climatique.
Vu le livre que je referme à regret – j’aurais bien aimé lire plus longtemps les souffrances et les joies de Ponthus, quelle indécence chez le lecteur ! – tous ces textes qu’il n’a pas écrits parce qu’il les a oubliés, il va les retrouver plus tard, c’est sûr. Sûr qu’on sera là pour les lire.
PS Quand ces lignes ont parus initialement dans Rebelle(s), le magazine papier, Joseph Ponthus était encore de ce monde. Il est mort en des suites d’un cancer, à 42 ans. Si la littérature peut sauver de l’épuisement et du désespoir, elle ne peut pas réparer l’usure du corps. On a la chance d’être encore là, mais on ne lira pas les lignes oubliées de Joseph Ponthus.
*Le « sandwich néerlandais » est une méthode d’optimisation fiscale basée sur des accords d’imposition entre les états. Les entreprises ayant des activités en France installent leurs sièges sociaux aux Pays-Bas et y remontent leurs profits, d’où ces derniers repartent ensuite vers des holdings de contrôle situées dans les Antilles Néerlandaises, paradis fiscal. Le taux d’imposition y est (beaucoup) plus bas qu’en France. Les profits réalisés chez nous étant déjà imposés au paradis ne peuvent pas être imposés par le fisc français. Grâce à ce met prisé des financiers, le gain final est supérieur au quart des bénéfices.




