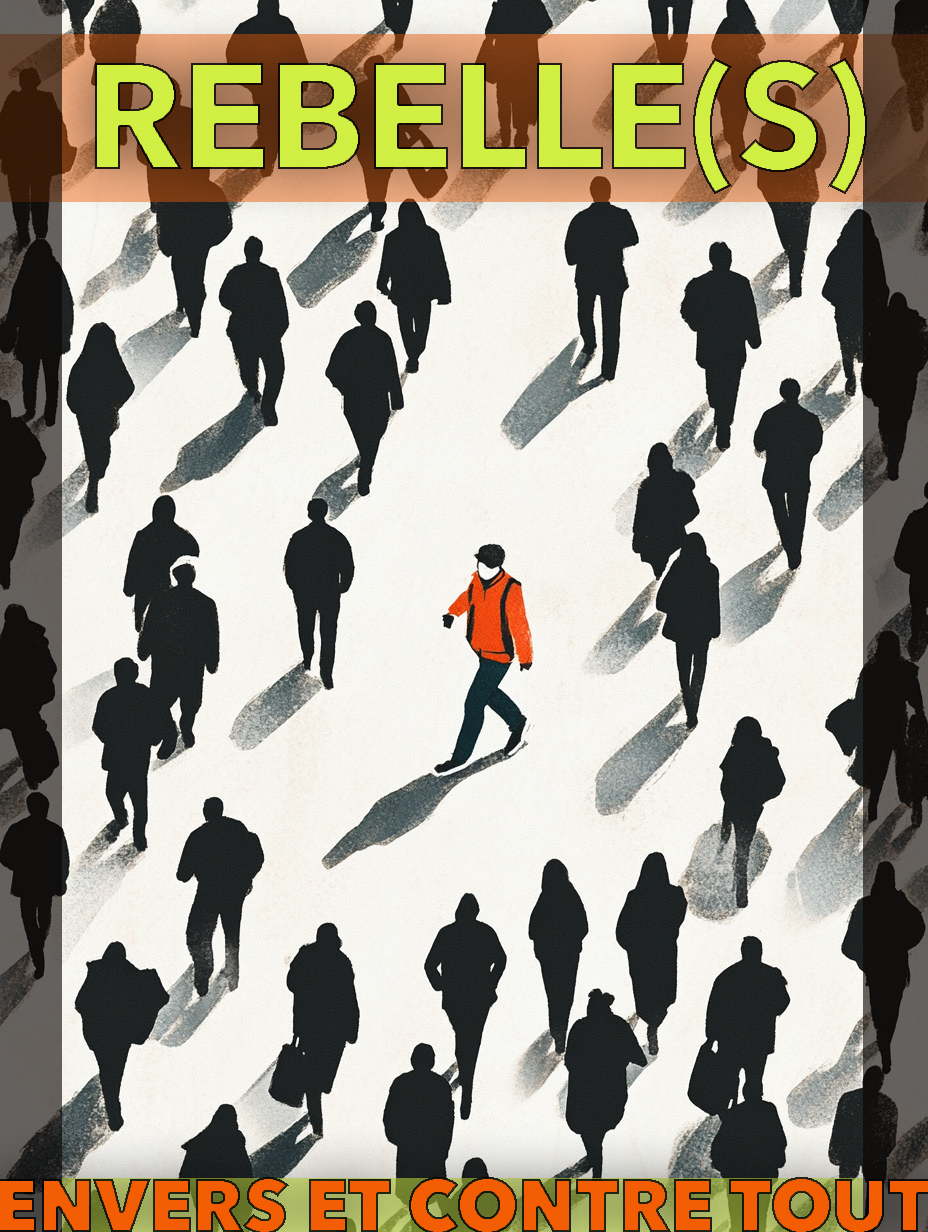S’il y en a un pour qui l’argent n’est pas synonyme d’existence, c’est bien le Péguy de 1913. Dans son essai « L’argent », publié dans les Cahiers de la quinzaine, il s’insurge contre la perte de sens entraînée par le culte de la finance : la France paye les conséquences de l’année 1902, qui fut celle du changement radical.
S’il y en a un pour qui l’argent n’est pas synonyme d’existence, c’est bien le Péguy de 1913. Dans son essai « L’argent », publié dans les Cahiers de la quinzaine, il s’insurge contre la perte de sens entraînée par le culte de la finance : la France paye les conséquences de l’année 1902, qui fut celle du changement radical.
Vous avez dit radical? Je dis : des radicaux. Car c’est après leur victoire aux législatives que ces derniers, par souci d’égalité démocratique, arasèrent brutalement notre culture séculaire, selon Péguy, d’abord en amputant l’enseignement des humanités classiques, avant de sortir la tronçonneuse en 1905 pour séparer ce que nous savons tous. À partir de ce moment, le peuple vendit son âme pour s’acheter une peau de bourgeois. Ces ouvriers et ces paysans qui depuis toujours prenaient plaisir à leur travail et s’y rendaient en chantant, ces travailleurs qui mettaient leur honneur à parfaire l’ouvrage sans demander rien à personne. Ils se sont laissés corrompre par la bourgeoisie, la grosse. « C’est parce que la bourgeoisie s’est mise à traiter comme une valeur de bourse le travail de l’homme que le travailleur s’est mis, lui aussi, à traiter comme une valeur de bourse son propre travail ». Les politiciens ont infecté les esprits en inventant « le sabotage et la double désertion »: celle du travail, celle de l’outil. Ceux qui ont ainsi infiltré le pouvoir, ce sont des « éléments intellectuels purs, purement bourgeois ». Et l’auteur de s’en prendre à Jaurès, ce « traître par essence », qui a trahi « le socialisme au profit des partis bourgeois ».

N’intervenons pas ici. En revanche, difficile de ne pas s’interroger, quand on a lu Zola et parcouru les historiens, devant la nostalgie de Péguy envers la situation d’autrefois : « (…) comment ne pas regretter la sagesse d’avant (…). On ne peut se représenter (…) cette bonne humeur, générale, constante (…) et ce climat de bonheur. (…) On vivait alors. On avait des enfants. Ils n’avaient aucunement cette impression que nous avons d’être au bagne. » Fichtre! me dis-je en revoyant le regard terrible des enfants sur certaines photos, qui nous les montrent descendant travailler au fond du puits minier…
Mais aussitôt, abandonnant ma robe de procureur, j’endosse celle d’avocat devant les dernières pages, si visionnaires: « Le modernisme consiste à ne pas croire soi-même pour ne pas léser l’adversaire qui ne croit pas non plus. » Sidérant de vérité! Au contraire, continue-t-il, « la liberté consiste à croire. Et à admettre (…) que l’adversaire croit. » Une dernière pépite: « Le modernisme est un système de politesse. La liberté est un système de respect .» En bon journaliste il plaide, enfin, pour sa revue, et le voilà encore criant de vérité: « Une revue n’est vivante que si elle mécontente chaque fois un bon cinquième de ses abonnés. (…) quand on s’applique à ne mécontenter personne, on tombe dans le système de (celles) qui perdent des millions, ou qui en gagnent, (…) à ne rien dire. » Vous ne croyez pas qu’aujourd’hui, le Charles, c’est dans Rebelle(s) qu’il écrirait ?
Patrick Le Divenah