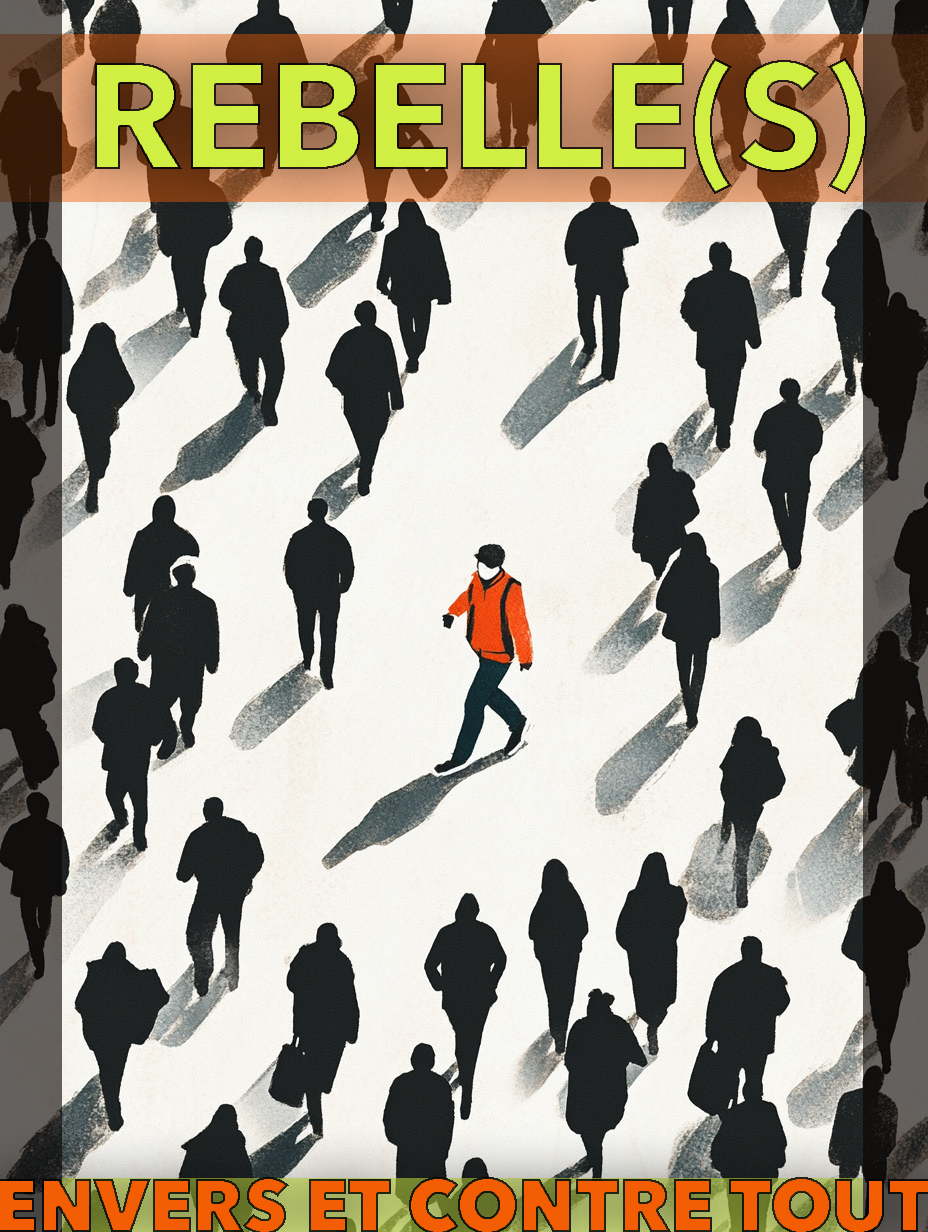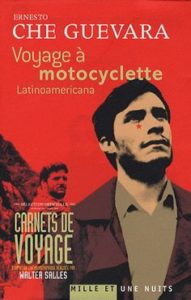
Deux jeunes médecins argentins peu argentés – deux amis – prennent la route en décembre 1951 pendant l’été austral pour traverser l’Amérique Latine à la rencontre des peuples du continent. Alberto Granado, le propriétaire de la moto qui les porte – nommée Poderosa, « la Vigoureuse » – dispose déjà d’une conscience politique aiguisée et d’une expérience militante mouvementée. Ernesto Guevara, le lecteur fervent de Lorca et de Neruda n’est pas encore devenu le « Che » et rêve surtout d’une quête initiatique à la Kérouac, dans la foulée des flamboyants et dépenaillés clochards célestes de la Beat Generation.
Le titre du livre de Guevara Voyage à motocyclette est fallacieux. Tout d’abord la Poderosa, une Norton 500 Model Inter 1939 bicylindre à boîte de vitesse Burman rend définitivement l’âme à la 43ème des 169 pages du récit, le 27 février 1952, soit 60 jours précisément après le début d’un voyage de 204 jours (l’année 1952 est bissextile) qui se termine à Caracas sur la mer des Caraïbes le 26 juillet 1952. Ensuite, ayant constaté que seul le premier tiers du périple fut motorisé, l’honnêteté nous oblige également à souligner que si l’Argentine et une partie du Chili ont bien été traversées en motocyclette, ces contrées l’ont aussi été en vol plané.
En effet, à cause du déséquilibre entraîné par un siège passager situé trop en arrière du centre de gravité du bloc moteur, on ne compte pas le nombre de sorties de route de la Poderosa ayant occasionné des chutes plus ou moins spectaculaires mais souvent à grande vitesse et se concluant toujours par de douloureuses contusions. Granado et Guevara sont des durs-à-cuire, des durs au mal passablement inconscients. L’adieu rapide à la fidèle et pétaradante rossinante fut donc pour les deux compères une chance à plusieurs titres car sur un tel engin ils auraient fini par mettre prématurément un terme à leur existence d’aventuriers. Ainsi devenus des vagabonds non motorisés, ils furent aussi contraints de « plonger dans le peuple », se confondant avec la plèbe des autocars et des camions, poursuivant à dos de mule ou en radeau comme l’écrit Ramon Chao dans sa belle et éclairante postface.
Sans le prestige de la Norton 500 et à court de fonds trop tôt dépensés, d’aristocrates crottés mais fringants les voilà transformés en loquedus qui doivent mendier leur pain et le gîte. D’une étape à l’autre, ils rencontrent tour à tour des notabilités locales qui reconnaissent quelquefois deux des leurs sous les oripeaux de routards, des miséreux qui les accueillent sans cérémonie, des plus ou moins pauvres qu’il leur arrive de gruger sans vergogne afin de manger.
Ils rêvent tous deux un temps de l’île de Pâques, où le climat est idéal, les femmes idéales, la nourriture idéale, le travail idéal (il n’y en a pas). Il s’avère qu’aucun bateau n’y va avant six mois. Ils renoncent. Asthmatique, Guevara est souvent malade et son ami Granado lui fait régulièrement des piqûres d’adrénaline. Malgré de nombreuses alertes, il survit. Finalement c’est un costaud, il a une « fragile santé de fer ». Leurs diplômes de médecin leur ouvrent bien des portes, et d’abord celles des hôpitaux, hospices et léproseries rencontrées sur leur chemin, ce qui leur permet principalement de gagner leur vie et accessoirement d’acquérir de l’expérience professionnelle auprès de quelques personnages d’exception.
Souhaitant visiter une mine de cuivre au Chili, ils y rencontrent un couple d’ouvriers communistes miséreux et pathétiques que dans une évocation à la tonalité quasi-religieuse Guevara rend comme exemplaire de la vie terrible des pauvres gens. Le bonhomme change, son regard se déprend de sa seule recherche de l’aventure romantique et il nous fait sentir cette mue avec sensibilité et sans pathos, tout en relevant les potentialités économiques et l’état sanitaire de chaque pays traversé, en scientifique qu’il est de formation. Il s’intéresse et nous intéresse à l’histoire des villes, des peuples, à l’acculturation des indiens toujours à l’œuvre après pourtant des siècles de destruction culturelle et de violences physiques. Sans qu’il ait besoin d’en rajouter, Cuzco, Lima passent ainsi sous nos yeux entre analyse historique et constat social. La prise de conscience se fait peu à peu, au cours de leur pérégrinations et à la faveur des rencontres innombrables qu’ils font, des expériences foisonnantes que le destin jette sous leurs pieds.
A la fin de sa première traversée du continent, Guevara le rêveur romantique – ce qui ne l’empêche pas d’être pragmatique – est également devenu un révolté qui réfléchit. Le pli est pris. Il reprendra ses voyages avec d’autres buts et ne s’arrêtera jamais. Il demeurera un éternel chercheur de la transformation du monde par la création d’un homme nouveau. Comme le lui dit sa mère adorée après qu’il devint ministre à Cuba : « oui tu seras encore un étranger, cela semble être ta destinée perpétuelle ».
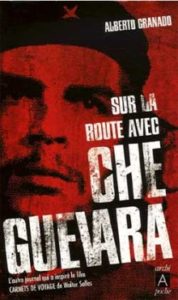
Après le beau livre d’Ernesto « Che » Guevara, il est intéressant de lire le récit qu’Alberto Granado fait de cette odyssée, bien après, en 1978. Granado participa à la réalisation du film « Carnets de voyage » du Brésilien Walter Salles, sorti en 2004 et récompensé par de nombreux prix.
Bien qu’introduit par une préface sans intérêt qui sent bon le prêchi-prêcha de l’apparatchik communiste statufié que Granado est devenu à Cuba, plus convenu mais plus enjoué, agrémenté de quelques photos de l’aventure, le texte est complémentaire de celui de Guevara.
Rythmé et balisé dans le temps – les dates et les lieux y sont clairement précisés – le carnet a la facture classique du récit d’aventures de voyage dans la veine des collections spécialisées d’Arthaud ou de Flammarion qui nous tinrent jadis en haleine. Aucun épisode n’est oublié ou occulté, celui de la léproserie de San Pablo au Pérou, central dans le livre de Granado comme dans le film de Salles mais rapidement évacué par Guevara dans son Voyage à motocyclette est l’occasion de ressentir et comprendre l’attention bienveillante et la sollicitude de grand frère que Granado fait montre pour son ami Guevara.
Le recul du temps et la position politique et sociale que Granado a acquise depuis lors expliquent probablement les fréquentes et lourdingues leçons de morale qui émaillent le livre, mais le gars y croit et a objectivement quelques raisons d’y croire. Son regard est souvent ironique et plus chaleureux que celui de Guevara. Il n’a peur de rien, est des deux compagnons le leader pour ce qui est des risques à prendre, des folies à entreprendre. Les descriptions des conditions fréquemment apocalyptiques de la nature et de la vie sur la route sont réjouissantes, surtout quand on en prend connaissance dans le confort d’un fauteuil de lecture, ce qu’à vous, ami lecteur, je souhaite de tout cœur.
Eric Desordre