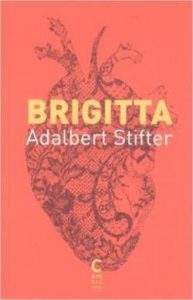
S’il est peu connu des Français, l’Autrichien Adalbert Stifter (1805-1868) est un classique dans les pays germaniques. Bien que contemporain de romantiques estampillés pur sucre tels les frères Grimm ou le peintre Caspar David Friedrich, il est toutefois considéré comme un des représentants majeurs de la période Biedermeier du repli sur la sphère privée et la vie familiale. Cette époque fatiguée des révolutions, contre-révolutions et autres guerres napoléoniennes s’épanouit entre le Congrès de Vienne et 1848. Rarement considérés comme romantiques – les historiens de la littérature n’aiment rien tant que les tiroirs où ranger les œuvres – les écrits de Stifter recèlent pourtant beaucoup de cette âme orageuse dont l’acte de naissance fut d’abord allemand. Sachant qu’il s’est suicidé, on peut également supposer que le bonhomme fut bien plus tourmenté que ses réflexions sur la douce loi de la probité et des habitudes domestiques pouvaient le laisser penser. En tout état de cause, qu’il se montre romantique à ses heures ou contempteur des idéaux bourgeois, ce ne sont pas les lubies politiques quelque peu plan-plan de Stifter qui lui valent la postérité mais ses romans. En particulier L’Arrière saison ou L’Homme sans postérité (justement), et le livre qui nous intéresse ici : Brigitta.
Jeune allemand faisant son tour d’Europe, le narrateur de Brigitta voyage comme, bien né, on voyageait au mitan du dix-neuvième siècle. C’est à dire avec suffisamment d’argent et d’entregent pour être assuré d’être accueilli, tantôt dans quelque auberge napolitaine, tantôt chez une notabilité locale hospitalière et polyglotte. C’est en se promenant sur les pentes du Vésuve qu’il fait connaissance du Major, un être d’exception sous le charme duquel il tombe aussitôt. Le Major a la prestance et les manières d’un prince et le sombre secret qui semble lui être attaché ajoute à une séduction d’autant plus grande qu’elle n’est pas recherchée. Figure d’une noblesse d’esprit et de comportement, il fait tourner la tête de toutes les femmes d’Italie sans s’attacher à aucune, et partout ailleurs en Europe où ses pas de nomade doivent l’avoir guidé. Les deux hommes se trouvent avoir en commun passion scientifique et goût littéraire. Une amitié naît.
Quand le Major s’apprête à rejoindre ses terres de Hongrie qu’il quitta il y a bien longtemps, il propose à son ami de venir à l’occasion découvrir ce pays ; le jeune homme pourra rester à demeure son invité le temps qu’il lui plaira. Célibataire et libéré des contingences, celui-ci se décide donc un matin à partir vers l’Est pour une sorte de quête en malle-poste. « Je me baladais à travers une puszta* aussi somptueuse que déserte, comme seule la Hongrie peut nous en offrir. Au début, mon âme toute entière fut saisie par la grandeur du spectacle : l’air caressant frémissait autour de moi à l’infini, la steppe embaumait, et l’éclat de la solitude se glissait partout et par-dessus, mais le lendemain et les jours suivants ce fut la même chose, rien de nouveau jamais à l’horizon, strictement rien, seul l’anneau très étroit à l’intérieur duquel le ciel et la terre s’étreignaient, alors mon esprit s’accoutuma, mon œil fut tellement gorgé de néant qu’il succomba, comme s’il était chargé de matière… »
Fasciné par ce qu’il devine d’irréductible sur ce bord du monde, il repousse sans arrêt le terme de son arrivée. Atteignant enfin après une pérégrination sous hypnose à travers la steppe un Château d’Argol perdu, il y rencontre fortuitement une cavalière qu’il pense d’abord être une intendante de la commanderie. Fort laide, cette femme irradie une force qui ne manque pas de le troubler. L’apparition s’avérera être Brigitta, maîtresse du domaine voisin de Maroshely, où avec trempe elle expérimente de nouvelles techniques de cultures et d’élevage, s’attirant le respect de toute la société alentour, y compris celui du Major. Une relation mystérieuse lie manifestement le Major et Brigitta. Les ressorts de leur attention l’un pour l’autre ne seront révélés au lecteur que vers la fin de l’histoire.
Brigitta est un récit d’apprentissage pour le narrateur, qui prend conscience de l’impermanence de la beauté physique et de la possibilité du maintien des liens amoureux au travers du temps. Il est peu de tels tableaux où est dépeinte une forme de conjugalité aussi indéfectible que singulière. Avec ce court roman, Stifter nous offre une plongée en eau profonde, la découverte progressive, non seulement d’un éden d’avant l’automobile, d’avant le chemin de fer même, mais aussi de l’apparente étrangeté d’un amour peu banal, le sort n’ayant pas offert à chacun de semblables atouts à la naissance : la grâce et l’attachement des siens pour l’un, la laideur et la désaffection maternelle pour l’autre. Il n’y a pas que la différence d’âge qui soit une mesure de la distance entre deux êtres.
Eric Desordre
* la steppe




