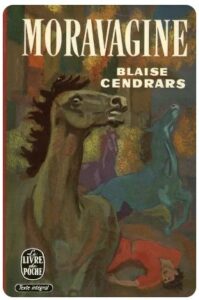
Voici un roman contre la morale, la raison, l’ordre social, l’amour, les femmes, la révolution, la politique, la religion, les hommes, le monde, la vie, Dieu, le roman, le bon goût. Voici Moravagine, publié par l’écrivain suisse Frédéric Louis Sauser, dit Blaise Cendrars, en 1926.
Voici un livre qui célèbre la jubilation dans le Mal, le meurtre gratuit, le viol, l’imposture, la délation, la manipulation, clame la haine des femmes (dès le titre, explicite selon l’auteur lui-même : « Mort-à-vagin »), met en scène avec joie la folie, les pulsions instinctives, le désordre, l’action, le mouvement, le voyage, la vitesse, la machine, la modernité – sans le moindre souci moral.
Voici un ouvrage qui chante la négation de toute valeur humaine, de toute idée, de toute réalité, nie le nihilisme même :
« Notre âme était dévastée. Il y avait longtemps que nous ne croyions plus à rien, même pas à rien ». Ici les héros sont des tueurs sans états d’âme, « les pionniers d’une génération moderne vouée à la mort ».
Voici un conte de l’horreur où sévit un génie du mal qui tient à la fois de Mr. Hyde, de Jack l’Eventreur, de Maldoror et de ces personnages diaboliques du romantisme noir, du roman gothique.
« Si tu veux vivre, tue… Sois seul contre tous, jeune homme, tue, tue, tu n’as pas de semblable, il n’y a que toi de vivant, tue jusqu’à ce que les autres te raccourcissent, te guillotinent, te garrottent, te pendent »
«Il n’y a pas de vérité. Il n’y a que l’action. »
« La vie c’est le crime, le vol, la jalousie, la faim, le mensonge, le foutre, la bêtise, les maladies, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, des monceaux de cadavres. Tu n’y peux rien, mon vieux, tu ne vas pas te mettre à pondre des livres, hein ? »
Rappelons brièvement l’intrigue : le narrateur, que Cendrars nomme par jeu Raymond la Science (allusion à d’autres criminels anarchistes célèbres, la bande à Bonnot) vient de terminer ses études de médecine psychiatrique et est employé dans le sanatorium du docteur Stein, réservé à des patients de la haute société. Parmi eux est interné secrètement, dans un pavillon privé, Moravagine, dernier héritier de la couronne hongroise. Il a étranglé et éventré, à l’âge de dix-huit ans, la jeune fille qu’il aimait et qui lui annonçait son départ définitif.
Le jeune docteur Raymond est fasciné par Moravagine, se lie d’amitié avec lui, décide de le faire évader, de ne plus s’en séparer, afin d’observer un « grand fauve humain », « l’activité de l’instinct ».
La suite du roman raconte les aventures sanglantes des deux personnages à travers le monde, de Berlin, où Moravagine se révèle le vrai nom de Jack l’Éventreur, à Moscou où ils prennent une part active à l’agitation révolutionnaire, pour le plaisir de tuer, de dénoncer, de trahir, de faire exploser le monde ; puis on les retrouve aux États-Unis d’Amérique, où le narrateur admire la formidable énergie du capitalisme, un univers régi par le principe irréfutable de l’utilité, plus tard en Amazonie chez les redoutables réducteurs de têtes. Enfin, eux que la violence fascine, vont être servis : les voici plongés dans la Grande Guerre !
Que reste-t-il aujourd’hui de ce roman inclassable, incorrect à tous les égards ?
Moravagine peut être lu comme une fable dont la leçon invisible serait : le monde est si barbare et si cruel que si on y lâchait un fou furieux, Moravagine, dont le plaisir est de tuer, il y serait accueilli les bras ouverts, chez les révolutionnaires russes comme chez les Jivaroz de la jungle amazonienne qui le prennent pour leur dieu. Une variation noire du conte philosophique dont l’archétype reste le Candide de Voltaire, voyage initiatique à travers un monde marqué par le Mal. Céline bientôt reprendra le procédé avec son Voyage au bout de la nuit, où Bardamu, moins naïf que Candide, mais plus candide que le psychopathe de Cendrars, se retrouve seul lucide, seul à imaginer sa mort devant des hommes acharnés à s’entretuer.
Le roman peut être vu aussi comme une œuvre expérimentale représentative d’une époque dominée par un désir de renouvellement formel, esthétique, lasse du monde ancien selon les mots d’Apollinaire, esprit qu’incarnera le surréalisme, avec ses références à Freud, à la libre association des images, au rêve.
Moravagine dit à Rita, qu’il aime et qu’il tuera :
« Tu es aussi belle qu’un tuyau de poêle, lisse, arrondie sur toi-même, coudée. Ton corps est comme un œuf au bord de la mer… Tu es comme un brin d’herbe grossi mille fois. »
Cendrars comme son ami Apollinaire est à l’origine d’une poésie nouvelle, en correspondance étroite avec les peintres d’avant-garde, et sa Prose du Transsibérien est illustrée par Sonia Delaunay.
Moravagine, Cendrars l’a dit, c’est aussi le double de l’auteur, sa part d’ombre, un prétexte narratif pour laisser libre cours à l’Autre (Cendrars cite le mot célèbre de Nerval : Je suis l’Autre), à tous les délires des pulsions agressives. Le rire de Moravagine, par-delà le bien et le mal. Une danse macabre qui unit les hommes et les continents. Le surréalisme découvre le Rimbaud d’Une saison en enfer et Lautréamont.
Rimbaud : « Je n’ai jamais été de ce peuple-ci ; je n’ai jamais été chrétien ; je suis de la race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les lois ; je n’ai pas le sens moral, je suis une brute »
Moravagine : « Je ne suis pas de votre race. Je suis du clan mongol […] Tremblez si je sors de vos murs comme de la tente d’Attila, masqué […] et si avec mes mains d’étrangleur, mes mains rougies par le froid, je force le ventre aigrelet de votre civilisation »
Les Chants de Maldoror exaltent aussi le crime, en particulier le meurtre raffiné de jeunes êtres innocents, et le mépris de l’homme, cette bête fauve ; Lautréamont imagine un Créateur qui se repaît de cadavres humains pourris, les pieds trempés dans une mare de sang, assis sur un trône fait d’excréments humains et d’or.
Le livre de Cendrars a quelque chose de cette provocation et de ce renversement des valeurs. Le dadaïsme déjà avait donné le ton : « dada : protestation aux poings de tout son être en action destructrice » (Tristan Tzara, Manifeste Dada, 1918). On sait que dans son Manifeste du surréalisme (1924), Breton définit cet art nouveau comme la « dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale » et dans le Second Manifeste (1930), il nie la distinction du bien et du mal, affirme « le dogme de la révolte absolue, de la soumission totale, du sabotage en règle », qu’il illustre par la fameuse formule :
« L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule. »
Le traumatisme de la Première Guerre mondiale a joué un rôle dans cette rébellion contre toutes les valeurs sociales. Cendrars s’est engagé, comme Céline, comme Bardamu ; il y a laissé un bras et sans doute bien des illusions. Ironiquement, la première partie du roman, qui voit l’évasion de Moravagine du sanatorium, s’intitule L’esprit d’une époque…
Ce qui peut heurter cependant le lecteur d’aujourd’hui à la lecture de ce livre fou, ce n’est pas sa cruauté, mais certains développements qui sentent leur âge, leur époque, à propos des femmes et des juifs, idées déjà douteuses en raison d’un pluriel toujours abusif. Que les femmes, par essence, en raison de leurs organes mêmes, et les juifs, par essence, en raison de leur religion, soient des êtres masochistes, voilà qui, même derrière le masque moravaginien de la folie, reste difficile à lire de nos jours. On pouvait écrire ainsi dans les années 20, où les milieux anarchistes n’étaient parfois pas exempts d’antisémitisme, où le baroudeur voit la femme et l’attachement qu’elle suscite comme un obstacle à la libre errance du héros solitaire et viril.
Quand tu aimes il faut partir (Bernard Lavilliers, autre amoureux des mots et des voyages, a aimé donner voix à ce vers de Cendrars)
Mais sans s’en douter Cendrars a peint, en creux, à travers ses diatribes contre l’amour et les souffrances absurdes qu’il inflige (et dont les femmes s’accommodent si bien selon lui, étant faites pour la douleur, et par conséquent maîtresses du jeu), un portrait très lyrique et même romantique de la passion amoureuse, digne des traits de l’amour courtois :
« Ces cris, ces plaintes, ces douces alarmes, cet état d’angoisse des amants, cet état d’attente, cette souffrance latente, sous-entendue, à peine exprimée, ces mille inquiétudes au sujet de l’absence de l’être aimé, cette fuite du temps, ces susceptibilités, ces sautes d’humeur, ces rêvasseries, ces enfantillages, cette torture morale où la vanité et l’amour-propre sont en jeu, l’honneur, l’éducation, la pudeur, ces hauts et ces bas du tonus nerveux, ces écarts de l’imagination, ce fétichisme, cette précision cruelle des sens qui fouaillent et qui fouillent, cette chute, cette abdication, cet avilissement, cette perte et cette reprise perpétuelle de la personnalité, ces bégaiements, ces mots, ces phrases, cet emploi du diminutif, cette familiarité, ces hésitations dans les attouchements, ce tremblement épileptique, ces rechutes successives et multipliées, […], cette mélancolie incurable, cette apathie, cette profonde misère morale, ce doute définitif et navrant, ce désespoir… »
Ce portrait clinique de l’état amoureux possède déjà les traits des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes (1977) mais ici le désordre et l’instabilité prennent la forme brute de mille symptômes d’une hystérie humiliante, ce que traduit l’accumulation des substantifs, procédé cher à Cendrars (le passage, bien plus long, vaut d’être lu en entier).
Car Moravagine est aussi, malgré la posture nihiliste et le sarcasme, le livre d’un poète. Et du bourlingueur Cendrars, qui découvre la Russie à dix-huit ans. En témoigne le remarquable portrait de Moscou :
« Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière » (la suite, ici aussi, est admirable).
Ainsi cette histoire racontée par un fou, qui nous dit que « l’existence est idiote, imbécile, vaine, n’a aucune raison d’être » et que « la vie est inutile », reste tout de même et presque malgré l’auteur, une célébration dionysiaque du monde, avec ses odeurs, ses plantes, ses machines, ses paysages, ses corps, les trains trépidants qui le traversent et dont la prose transsibérienne de Cendrars tente d’imiter le rythme effréné, résolu, entreprenant, prose échevelée et changeante d’un grand livre baroque et picaresque dominé par la mort et le néant, le mouvement et la fuite, le travestissement, non seulement des personnages mais surtout de l’auteur derrière des masques multiples (jusqu’à l’apparition facétieuse, à la fin du livre, dans un rôle minime, d’un aviateur nommé… Blaise Cendrars !).




